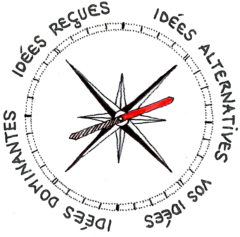Thomas Coutrot
Extrait du livre, Jalons vers un monde possible, Le Bord de l’eau éditions, 2010 (chap 7)
A lire les chapitres précédents, on pourrait s’imaginer la transformation sociale comme un long fleuve tranquille. La société civile démocratique encercle progressivement l’état et le capital. Elle instaure sa participation directe aux décisions et son contrôle sur les pouvoirs, par la mobilisation des citoyens et des électeurs et la construction d’un système juridique authentiquement démocratique. Elle dépasse graduellement le capitalisme en construisant le contrôle citoyen sur les biens communs – la finance, la nature, l’emploi décent – par une accumulation de réformes sociales et démocratiques radicales, qui donnent forme à un modèle social alternatif, le « socialisme civil ».
Pas de réforme sans (menace de) révolution
Cette version idyllique n’est malheureusement pas plausible. Les pouvoirs et les ressources économiques sont aujourd’hui concentrées comme jamais dans les mains de couches ultra-privilégiées qui ne se laisseront pas faire. L’histoire est suffisamment riche d’expériences en la matière pour ne pas laisser place au doute : les classes dominantes renoncent sans hésitation à l’Etat de droit lorsqu’elles considèrent menacés leurs intérêts fondamentaux. Et pourtant, une sortie civilisée de la crise globale suppose trois bifurcations fondamentales, dans le rapport à la nature, l’accès aux ressources et les choix sociaux de production: il faut renoncer à la croissance économique indéfinie, redistribuer radicalement les richesses et réduire le temps de travail, réguler les décisions d’investissement, public et privé, en fonction de critères sociaux et écologiques démocratiquement débattus, le critère du profit devenant secondaire. Ces bifurcations nous entraînent loin du capitalisme, qui implique au contraire accumulation illimitée de richesses, la concentration permanente des revenus et des pouvoirs, le droit exclusif des propriétaires du capital à décider de l’orientation des investissements en fonction du seul taux de profit.
La possibilité, voire la grande probabilité d’une réaction violente des classes dominantes face à une remise en cause de leur domination, pose le problème classique de la révolution. Comment espérer fonder une société démocratique et pluraliste à partir d’un affrontement violent qui tend par nature à abolir la démocratie et le pluralisme?
Depuis la fin du XIXe siècle cette question divise le mouvement ouvrier. Les réformistes sont gradualistes, légalistes et hostiles à toute forme de violence ; les révolutionnaires croient à la nécessité de ruptures avec l’ordre juridique existant et du recours à la violence contre la résistance des classes dominantes.
Les réformistes jugent possible le dépassement (ou la régulation) du capitalisme grâce à une série de réformes progressistes, se succédant au cours d’une longue période de temps, par des moyens principalement institutionnels et électoraux, et aboutissant soit – dans l’optique social-démocrate classique – à marginaliser la propriété privée des moyens de production et à établir un contrôle social sur l’économie, soit – pour le social-libéralisme – à réguler démocratiquement le fonctionnement du capitalisme. Les révolutionnaires croient illusoires ces perspectives et jugent inévitables les révolutions : des épisodes critiques, d’une durée limitée, au cours desquels s’opèrent des affrontements entre classes et des ruptures institutionnelles.
Que nous a appris l’histoire ? Nulle part le capitalisme n’a été renversé ou dépassé par un «dîner de gala », comme disait Mao. Même d’un point de vue purement réformiste, la régulation du capitalisme, par exemple le New Deal nord-américain ou la mise en œuvre du programme du Conseil national de la Résistance en France, n’ont été possibles qu’à la faveur de conflits et d’affrontements sociaux majeurs – à commencer par le précédent menaçant de la révolution russe[1].
La restauration du capitalisme dans les pays d’Europe de l’Est confirme cet enseignement de l’histoire : là encore, il a fallu des révolutions pour renverser les régimes bureaucratiques héritiers de 1917. On ne transforme pas profondément les structures sociales – on ne dépossède pas une classe dominante de son pouvoir de domination – sans rupture institutionnelle majeure. Mais répétons-le, même dans une perspective réformiste, on ne bride pas sérieusement le pouvoir du capital sans passer par des luttes sociales de grande ampleur, qui culminent dans des crises politiques aiguës, de type révolutionnaire, constituant les individus et groupes sociaux en peuple. Les vraies réformes se font par ou sous la menace de la révolution, c’est la grande supériorité des révolutionnaires que de l’avoir compris. La transformation sociale n’a jamais été et ne sera jamais un long fleuve tranquille.
Illégalisme et non-violence
Par définition une révolution signifie une rupture brutale de l’ordre juridique. Les réformistes sont légalistes : les changements institutionnels doivent selon eux être réalisés dans le respect de l’ordre juridique existant, dans la mesure où il a été établi démocratiquement. Pour eux, toute autre attitude ouvre la voie à l’arbitraire et à la dictature. Ils condamnent donc le recours des mouvements sociaux et des citoyens à la désobéissance civique et aux actions illégales. Ils excluent non seulement le recours à des coups d’États institutionnels (comme l’instauration de la Ve République par de Gaulle), mais aussi, en cohérence avec leur gradualisme, toute intervention directe du peuple qui viserait la transformation des institutions par des voies non constitutionnelles.
À l’inverse, les révolutionnaires refusent de cantonner les formes de lutte et les modalités de transformation institutionnelle au seul registre de la légalité, et lui opposent celui de la légitimité. Ils considèrent que le droit, même établi selon des procédures formellement démocratiques, est avant tout une cristallisation à un moment donné des rapports de force sociaux : dans une société régie par le capitalisme, le droit est capitaliste, notamment parce qu’il sanctuarise la propriété capitaliste (la liberté d’entreprendre, qu’invoque parfois le Conseil constitutionnel contre des textes restreignant l’arbitraire patronal[2]). Si une loi est manifestement injuste et illégitime au regard de ses effets sociaux, des actions illégales s’attaquant à ces effets peuvent s’avérer nécessaires. Si les rapports de force sociaux évoluent brusquement (comme c’est par définition le cas dans les épisodes révolutionnaires) les forces sociales progressistes ne peuvent s’autolimiter à la stricte légalité sans précipiter leur défaite.
L’Histoire plaide donc, de mon point de vue, pour une approche critique du légalisme. Toutefois la condition sine qua non du recours à l’action extra-légale est la légitimité des objectifs visés et des méthodes employées aux yeux d’une très grande majorité de la population. Ainsi, les avortements clandestins ou les expériences du type Lip dans les années 1960-70, les occupations de logements vides, les fauchages de plants OGM ou l’hébergement de sans-papiers aujourd’hui, sont des pratiques illégales mais comprises par l’opinion publique. Les objectifs doivent être légitimes mais les modes d’action aussi: la question de la violence est à et égard décisive.
Personne ne conteste le droit à un gouvernement progressiste légalement élu de défendre, y compris par la force, l’ordre constitutionnel contre des putschistes d’extrême-droite. La discussion porte sur la violence illégale, celle qui n’est pas exercée par l’Etat mais par des acteurs sociaux privés, même issus du camp populaire. Les réformistes, adversaires de l’action extra-légale, le sont a fortiori de l’action violente. Les révolutionnaires, eux, se veulent eux aussi cohérents : si l’on vise des transformations profondes de l’ordre social, si on reconnaît que la violence structurelle du système capitaliste ne peut être surmontée qu’à l’occasion d’intenses mobilisations et de graves crises sociales, si l’on admet le recours à l’action extra-légale quand elle est clairement nécessaire et légitime, alors on peut s’attendre à des réactions violentes des groupes sociaux dont la domination est menacée, y compris à des actions illégales des forces armées. Le cas du Chili d’Allende est encore présent dans les mémoires. Cela justifie que le peuple prenne les armes pour défendre la révolution. Ce que l’on appelle la guerre civile.
Cette apparente cohérence est pourtant très contestable. Il faut certes éviter une naïve confiance dans le légalisme des dominants, mais la question de la violence est la pierre d’achoppement de toute stratégie de transformation sociale. Celle-ci est un double processus de construction de sujets démocratiques et de constitution de l’unité populaire ; d’émancipation individuelle et collective. Dans cette optique le recours à la violence est toujours néfaste. Il pousse à la suspension du jugement personnel et des droits démocratiques, à la fusion aveugle dans la discipline militaire, à l’identification aux chefs, au culte de la virilité. Plus fondamentalement encore, la violence fait obstacle (pour reprendre la terminologie de Mouffe et Laclau) au processus de « construction d’équivalences » entre les différentes « positions de sujet » présentes dans le mouvement social ; en d’autres termes, elle provoque nécessairement la division au sein du peuple. Ainsi elle marginalise les femmes, dont la participation massive est au contraire à la fois une condition et un signe caractéristique de tout mouvement émancipateur. Enfin la violence populaire – même exercée contre un ennemi clairement responsable de l’agression – conduit à la constitution de milices et de tribunaux d’exception, source inévitable de dérives autoritaires et étatistes.
Accoucheuse ou fossoyeuse ?
Il ne s’agit pas, bien au contraire, de condamner la résistance contre des factieux qui violeraient la légalité démocratique. Dans ce type de situation, l’expérience historique montre que la mobilisation populaire est la seule manière de pousser les forces armées à se diviser. La division de l’armée face à une énorme mobilisation de rue, pour l’essentiel pacifique, a été la clé de la révolution iranienne de 1979, tout comme de l’échec du putsch de hauts militaires vénézuéliens contre Chavez en 2002. Reste que cette résistance doit se définir et apparaître aussi clairement que possible comme non-violente, en défense des valeurs et de la légalité démocratiques menacées par des forces illégitimes. La fin ne justifie pas les moyens : non seulement pour des raisons morales, mais aussi – et indissociablement – pour des motifs d’efficacité, il faut cultiver la plus grande méfiance envers les rhétoriques guerrières ou militaires, l’apologie de la violence des opprimés contre les oppresseurs, l’éloge de l’«accoucheuse de l’Histoire» (Engels). La première Intifada palestinienne, celle des enfants qui lançaient des cailloux contre les tanks et des femmes qui les soutenaient, a ébranlé la domination coloniale et le consensus de la société israélienne. Les attentats terroristes aveugles et la deuxième Intifada, virile et armée, ont au contraire soudé la population israélienne et provoqué une catastrophe pour les Palestiniens. L’hégémonie de la société civile démocratique ne peut se construire que par l’argumentation, la persuasion, la conquête des cœurs et des esprits, non par la coercition. La force morale de la non-violence revendiquée, la puissance du nombre pacifique, sont les armes les plus efficaces pour diviser, affaiblir et démoraliser les adversaires de l’autonomie populaire.
Les révolutions, nécessaires, ne peuvent être durablement émancipatrices que non violentes. Mais que peut-on attendre au juste d’une révolution ? La mythologie du « Grand Soir », ridée d’un basculement rapide vers une nouvelle société qui sortirait armée de pied en cap des décombres de l’ancienne, n’est aujourd’hui plus défendable, ni vraiment défendue par personne.
Pour les sociaux-démocrates allemands du début du XXe siècle, comme Kautsky, les monopoles capitalistes organisaient la socialisation des forces productives, qui tomberaient comme des fruits mûrs dans le panier du socialisme. Il n’en est rien : les monopoles géants, capitaliste ou non, n’ont rien d’émancipateur. La démocratisation de la société ne résultera pas de son évolution spontanée. Elle ne peut résulter que d’un long cheminement, combinant changement par en haut et par en bas : des avancées institutionnelles vers une meilleure maîtrise collective du développement social, et des innovations à la base dans les rapports sociaux élémentaires. Les révolutions ne peuvent servir de raccourcis. Leur rôle est de cristalliser les rapports de forces sociaux émergents dans de nouvelles institutions.
La révolution démocratique vient de loin
«C’est seulement lorsque « ceux d’en bas » ne veulent plus et que « ceux d’en haut » ne peuvent plus continuer de vivre à l’ancienne manière, c’est alors seulement que la révolution peut triompher. » Lénine avait raison, mais pour qu’une révolution ne se retourne pas en nouvelle oppression, il faut une troisième condition : que «ceux d’en bas» aient déjà commencé à inventer de nouvelles manières de faire société, susceptibles de fonder un nouvel ordre social. La transformation sociale suppose la maturation de nouveaux rapports avec la nature, avec l’économie, avec la politique ; de nouveaux rapports entre les sexes, entre les groupes sociaux, entre les nations… Des rapports fondés sur la reconnaissance de l’autre et le respect de sa liberté, sur l’égalité, sur la fraternité avec les contemporains, proches ou éloignés, et avec les générations à venir.
Les flambées révolutionnaires sont l’occasion d’expérimenter ces rapports avec une intensité sans égale qui laisse aux participants des souvenirs inoubliables. Mais pour qu’ils se stabilisent une fois la passion révolutionnaire retombée, il faut des constructions institutionnelles. C’est ce qu’on fait nos parents et (arrière-) grands-parents, en édifiant le suffrage universel, la sécurité sociale, le droit du travail, les droits des femmes… Sans attendre les crises aiguës, ces rapports se construisent tous les jours dans les luttes sociales. Du moins quand celles-ci s’inspirent de la grammaire de la justice démocratique, et non des passions tristes du racisme ou du nationalisme… Ils se construisent dans les initiatives du commerce équitable ou du logiciel libre, dans la votation citoyenne pour La Poste, dans les coopératives d’habitat écologique, dans les permanences du Réseau Éducation sans frontières, dans les résistances des enseignants et des jeunes contre la marchandisation de l’école et la privatisation des savoirs…
Ces acteurs apprennent à se représenter leurs initiatives comme des pierres apportées à la construction d’un autre monde, un monde possible. Ils savent qu’il n’y aura de « lendemains qui chantent » dont les fondations ne soient posées dès aujourd’hui. La bourgeoisie a pris plusieurs siècles pour édifier son hégémonie économique, culturelle et sociale avec ses compagnies commerciales, ses réseaux financiers, ses entreprises idéologiques (celles des philosophes du libéralisme et des Lumières), avant de renverser, difficilement, la domination aristocratique. Le capitalisme a longtemps occupé une place subordonnée dans la société féodale puis absolutiste, quand les souverains emprisonnaient les financiers auxquels ils ne pouvaient pas rembourser leurs prêts. Le capitalisme n’est devenu le mode de production dominant qu’au XVIIIe siècle en Angleterre, au XIXe siècle en Europe continentale, après que la bourgeoisie eut accédé au pouvoir politique. En France, la révolution de 1789 n’a débouché qu’en 1871 sur l’établissement définitif d’une république.
Aujourd’hui comme hier, les révolutions politiques sont nécessaires et souvent inévitables, mais elles ne font que ponctuer des processus de beaucoup plus longue haleine, ceux de la révolution démocratique. Celle-ci a commencé avec l’affirmation de la bourgeoisie contre la domination des élites aristocratiques. Mais « croit-on qu’après avoir détruit la féodalité et vaincu les rois, la démocratie s’arrêtera devant les bourgeois et les riches [3] ? » La révolution démocratique continue à travailler en profondeur nos sociétés, à s’y frotter aux logiques capitaliste, étatique, nationaliste…
La révolution en actes
Autant les révolutions sont nécessaires, en tant que points de résolution provisoire des tensions accumulées, autant le messianisme révolutionnaire est puéril, qui prétend garder les mains propres jusqu’au basculement final à partir duquel rien ne sera plus comme avant. Che Guevara disait: «Le devoir d’un révolutionnaire est de faire la révolution.» En actes, pas seulement en paroles. Les révolutionnaires ne sont pas obsédés par les mains propres : ils prennent des risques, font des paris, se plantent, se font parfois marginaliser, parfois récupérer ou intégrer. Mais leurs pratiques impures, dans les entreprises, dans les quartiers, dans les campagnes, dans les institutions, nourrissent la créativité et l’autonomie populaires, les convergences entre mouvements sociaux, entre mouvements sociaux et politiques, bref, l’apprentissage collectif de la société civile démocratique.
Ainsi, au Brésil, le principal courant (trotskiste) de la gauche du Parti des travailleurs (PT), Démocratie socialiste, s’est divisé à propos de la participation au gouvernement de Lula. Tous critiquaient le pacte passé par Lula avec les élites traditionnelles, rurales et urbaines, qui limitait drastiquement les possibilités de réforme agraire et de redistribution des richesses. Cependant, ils en ont tiré des conclusions divergentes. Les uns ont décidé de quitter le PT et de dénoncer sa politique de collaboration de classe. Les autres (la majorité) ont choisi de rester dans le PT, et pour certains d’entrer au gouvernement, afin d’utiliser les marges de manœuvre malgré tout disponibles. Ils se sont engagés aux côtés de Paul Singer, le secrétaire d’État à l’économie solidaire, qui a animé la structuration et la popularisation de l’économie solidaire au Brésil. Ils ont travaillé avec Marina Silva, la ministre de l’environnement, qui a mené une énergique lutte contre l’agrobusiness et la déforestation de l’Amazonie, avant de démissionner quand elle a vu son action bloquée par Lula en défense des lobbies exportateurs.
Il y a toujours un grave danger de dérive opportuniste à taire ses divergences au nom d’une solidarité gouvernementale : le soutien ne doit pas exclure la critique. Mais la posture révolutionnariste n’est guère moins néfaste que l’opportunisme qu’elle dénonce : à projeter dans un avenir lointain et indéterminé la construction d’un nouveau monde, à se cantonner dans un discours au mieux condescendant, au pire dénonciatoire, sur ces pratiques émancipatrices partielles « qui ne renversent pas le système », elle stérilise l’énergie transformatrice de militants de grande valeur, énergie qui serait précieuse dans l’expérimentation et la construction de ces nouveaux rapports sociaux. Au plan local, des collectivités territoriales progressistes peuvent améliorer la vie des gens avec des services publics locaux de qualité, favoriser les initiatives solidaires en matière de production, de consommation, de culture… Les budgets participatifs, trop rarement mis en œuvre de façon audacieuse, peuvent être une formidable école de démocratie. Même au plan national, on peut participer utilement – comme au Brésil – à des gouvernements réformistes ou progressistes qui n’ont pourtant pas rompu avec le capitalisme. Les avancées de la gauche en Amérique Latine mettent à mal les schémas de l’orthodoxie léniniste : Hugo Chavez ou Evo Morales mènent indiscutablement des politiques favorables aux intérêts populaires, mais sans avoir exproprié le grand capital ni rompu avec le marché mondial. Ils s’appuient sur les mobilisations sociales pour avancer vers la construction de services publics, la socialisation de secteurs de l’économie, la réforme foncière et agraire.
Peut-être devront-ils demain aller plus loin dans la rupture avec le capitalisme, mais ils ont eu jusqu’à présent la sagesse de ne pas chercher à forcer les rythmes. Le référendum perdu par Chavez a ainsi été exemplaire : la population – y compris de larges secteurs populaires plutôt pro-chavistes – a refusé le saut dans l’inconnu, un renforcement du pouvoir personnel et une socialisation hâtive de l’économie. Chavez s’est incliné, pour éviter une épreuve de force sans doute victorieuse militairement mais politiquement désastreuse. Même avec ses travers – personnalisation excessive, étatisme et bureaucratisme rampants – la révolution bolivarienne se conçoit comme un processus long, chaotique et sans fin prédéterminée : le « socialisme du XXe siècle » tente de s’inventer en marchant.
De nouveaux objets politiques
Le néolibéralisme a mené ses premières expérimentations sociales en Amérique latine dans les années 1970 – Chili de Pinochet, Argentine de Videla – avant de s’imposer en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, puis dans le monde. Aujourd’hui, c’est à nouveau l’Amérique latine qui expérimente un réformisme radical et démocratique, des formes nouvelles d’organisation. Ainsi en Bolivie : ni parti d’avant-garde, ni mouvement social traditionnel, mais fusion originale des deux, le Mouvement vers le socialisme (MAS) est un OVNI politique, un « parti-mouvement », dont de larges secteurs des couches populaires, jusqu’ici exclus de la scène politique, se sont emparés pour défendre leurs droits et faire valoir leurs exigences. Le mouvement ouvrier, sous l’influence du léninisme, avait construit et théorisé une muraille de Chine entre mouvements sociaux et partis politiques : les premiers, supposés par nature corporatistes («trade-unionistes » disait Lénine) et mono-thématiques, devraient laisser aux seconds la vision d’ensemble, la cohérence stratégique et la conquête du pouvoir. La CFDT autogestionnaire des années 1965-75 avait déjà remis en cause ce schéma.
L’essor du mouvement altermondialiste et les expériences latino-américaines montrent que l’idée du parti d’avant-garde est totalement dépassée. De nouvelles formes d’articulation entre lutte sociale et lutte politique, entre mouvements et partis, de nouveaux objets politiques sont à inventer et à construire, pour de nouvelles stratégies de transformation sociale. À la « guerre de mouvement » insurrectionnelle prônée par Lénine, Gramsci opposait la « guerre de positions » de longue durée, au cours de laquelle la classe ouvrière et son parti gagneraient l’hégémonie sur la société civile. Je trouve préférable d’éviter le vocabulaire militaire : mais l’hégémonie de la société civile démocratique ne pourra résulter que d’une longue marche, faite d’essais, d’erreurs, d’avancées et de reculs dont nul ne peut prévoir la durée ni les rythmes.
- Les réformistes qui ont le mieux réussi – les sociaux-démocrates scandinaves – ont conquis sur le plan national, suite à des luttes sociales souvent virulentes, des institutions plus égalitaires et plus solidaires mais qui demeurent dépendantes de structures économiques capitalistes. Immergées dans la mondialisation néolibérale, ces institutions sont aujourd’hui soumises à la corrosion impitoyable de la concurrence et de la loi du profit maximum. La Norvège seule résiste… grâce à son pétrole et son refus d’intégrer l’Union européenne. ↑
- En janvier 2002, au nom de la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel annulait une disposition d’une loi de la gauche plurielle interdisant les « licenciements boursiers », c’est-à-dire les licenciements décidés pour préserver ou améliorer la cote de l’entreprise en Bourse. ↑
- Selon la célèbre prédiction de Tocqueville, dans l’introduction de De la démocratie en Amérique. ↑