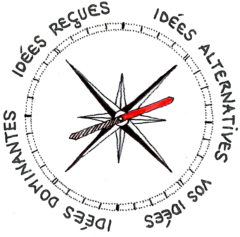Pierre Joseph Proudhon
ou « recherches sur le principe du droit et du gouvernement », Premier mémoire, 1840. Chronologie et introduction par Emile James, professeur à la Faculté de Droit et Sciences économiques de Paris, édité par Garnier Flammarion en 1966, Paris.
Extraits
Historique de la propriété (page 76)
Le peuple enfin consacra la propriété… Dieu lui pardonne, car il n’a su ce qu’il faisait. Voilà cinquante ans qu’il expie une misérable équivoque. Mais comment le peuple, dont la voix, dit-on, est la voix de Dieu, et dont la conscience ne saurait faillir, comment le peuple s’est-il trompé ? Comment, cherchant la liberté et l’égalité, est-il retombé dans le privilège et la servitude ? Toujours par imitation de l’ancien régime.
Autrefois la noblesse et le clergé ne contribuaient aux charges de l’État qu’à titre de secours volontaires et de dons gratuits ; leurs biens étaient insaisissables même pour dettes: tandis que le roturier, accablé de tailles et de corvées, était harcelé sans relâche tantôt par les percepteurs du roi, tantôt par ceux des seigneurs et du clergé.
Le mainmortable, placé au rang des choses, ne pouvait ni tester ni devenir héritier; il en était de lui comme des animaux, dont les services et le croît appartiennent au maître par droit d’accession. Le peuple voulut que la condition de propriétaire fût la même pour tous ; que chacun pût jouir et disposer librement de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Le peuple n’inventa pas la propriété: mais comme elle n’existait pas pour lui au même titre que pour les nobles et les tonsurés, il décréta l’uniformité de ce droit.
Les formes acerbes de la propriété, la corvée, main-morte, la maîtrise, l’exclusion des emplois ont disparu; le mode de jouissance a été modifié: le fond de la chose est demeuré le même. Il y a eu progrès dans l’attribution du droit; il n’y a pas eu de révolution.
Historique de la propriété (pages 113 à 117)
Ecoutez le professeur de Rennes, le savant Touilliers [ndlr. cité par Proudhon] :
[…] « L’agriculture fut une suite naturelle de la multiplication du genre humain et l’agriculture, à son tour, favorisa la population, et rendit nécessaire l’établissement d’une propriété permanente; car qui voudrait se donner la peine de labourer et de semer, s’il n’avait la certitude de recueillir ? »
Il suffisait, pour tranquilliser le laboureur, de lui assurer la possession de la récolte: accordons même qu’on l’eût maintenu dans son occupation territoriale, tant, que par lui-même il aurait cultivé ; c’était tout ce qu’il avait droit d’attendre, c’était tout ce qu’exigeait le progrès de la civilisation. Mais la propriété! la propriété! le droit d’aubaine sur un sol que l’on n’occupe ni ne cultive ; qui avait autorité pour l’octroyer ? qui pouvait y prétendre ?
« L’agriculture ne fut pas seule suffisante pour établir la propriété permanente; il fallut des lois positives, des magistrats pour les faire exécuter ; en un mot, il fallut l’état civil. »
« La multiplication du genre humain avait rendu l’agriculture nécessaire ; le besoin d’assurer au cultivateur les fruits de son travail fit sentir la nécessité d’une propriété permanente, et des lois pour protéger. Ainsi c’est à la propriété que nous devons l’établissement de l’état civil. »
Oui, de notre état civil, tel que vous l’avez fait, état qui fut d’abord despotisme, puis monarchie, puis aristocratie, aujourd’hui démocratie, et toujours tyrannie.
« Sans le lien de la propriété, jamais il n’eût été possible de soumettre les hommes au joug salutaire de la loi ; et, sans la propriété permanente, la terre eût continué d’être une vaste, forêt. Disons donc, avec les auteurs les plus exacts, que si la propriété passagère, ou le droit de préférence que donne l’occupation, est antérieure à l’établissement de la société civile, la propriété permanente, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est l’ouvrage du droit civil. — C’est le droit civil qui a établi pour maxime qu’une fois acquise, la propriété ne se perd point sans le fait du propriétaire, et qu’elle se conserve même après que le propriétaire a perdu la possession ou la détention de la chose, et qu’elle se trouve dans la main d’un tiers.
« Ainsi la propriété et la possession, qui, dans l’état primitif, étaient confondues, devinrent, par le droit civil, deux choses distinctes et indépendantes ; deux choses qui, suivant le langage des lois, n’ont plus rien de commun entre elles. On voit par là quel prodigieux changement s’est opéré dans la propriété, et combien les lois civiles en ont changé la nature. »
Ainsi la loi, en constituant la propriété, n’a point été l’expression d’un fait psychologique, le développement d’une loi de la nature, l’application d’un principe moral : elle a, dans toute la force du mot, créé un droit en dehors de ses attributions ; elle a réalisé une abstraction, une métaphore, une fiction ; et cela sans daigner prévoir ce qui en arriverait, sans s’occuper des inconvénients, sans chercher si elle faisait bien ou mal : elle a sanctionné l’égoïsme ; elle a souscrit à des prétentions monstrueuses ; elle a accueilli des vœux impies, comme s’il était en son pouvoir de combler un gouffre sans fond et rassasier l’enfer. Loi aveugle, loi de l’homme ignorant, loi qui n’est pas une loi ; parole de discorde, de mensonge et de sang. C’est elle qui, toujours ressuscitée, réhabilitée, rajeunie, restaurée, renforcée, comme le palladium des sociétés, a troublé la conscience des peuples, obscurci l’esprit des maîtres, et déterminé toutes les catastrophes des nations. C’est elle que le christianisme a condamnée mais que ses ignorants ministres déifient, aussi peu curieux d’étudier la nature et l’homme, qu’incapables de lire leurs Écritures. Mais enfin quel guide la loi suivait-elle en créant le domaine de propriété ? quel principe la dirigeait ? quelle était sa règle ? Ceci passse toute croyance : c’était l’égalité.
L’agriculture fut le fondement de la possession territoriale, et la cause occasionnelle de la propriété. Ce n’était rien d’assurer au laboureur le fruit de son travail, si on ne lui assurait en même temps le moyen de produire pour prémunir le faible contre les envahissements du fort, pour supprimer les spoliations et les fraudes, on sentit la nécessité d’établir entre les possesseurs des lignes de démarcation permanentes, des obstacles, infranchissables. Chaque année voyait se multiplier le peuple et croître l’avidité des colons : on crut mettre un frein à l’ambition en plantant des bornes au pied desquelles l’ambition viendrait se briser. Ainsi le sol fut approprié par un besoin d’égalité nécessaire à la sécurité publique et à la paisible jouissance de chacun. Sans doute le partage ne fut jamais géographiquement égal ; une foule de droits, quelques-uns fondés en nature, mais mal interprétés, plus mal encore appliqués, les successions, les donations, les échanges d’autres, comme les privilèges de naissance et de dignité, créations illégitimes de l’ignorance et de la force brutale, furent autant de causes qui empêchèrent l’égalité absolue.
Mais le principe n’en demeura pas moins le même : l’égalité avait consacré la possession, l’égalité consacra la propriété.
Il fallait au laboureur un champ à semer tous les ans: quel expédient plus commode et plus simple pour les barbares, au lieu de recommencer chaque année à se quereller et à se battre, au lieu de voiturer sans cesse, de territoire en territoire, leur maison, leur mobilier, leur famille, que d’assigner à chacun un patrimoine fixe et inaliénable ?
Il fallait que l’homme de guerre, au retour d’une expédition, ne se trouvât pas dépossédé par les services qu’il venait de rendre à la patrie, et qu’il recouvrât son héritage : il passa donc en coutume que la propriété se conserve par la seule intention, nudo ammo , qu’elle ne se perd que du consentement et du fait du propriétaire.
Il fallait que l’égalité des partages fût conservée d’une génération à l’autre, sans qu’on fût obligé de renouveler la distribution des terres à la mort de chaque famille : il parut donc naturel et juste que les enfants et les parents, selon le degré de consanguinité ou d’affinité qui les liait au défunt, succédassent à leur auteur. De là, en premier lieu, la coutume féodale et patriarcale de ne reconnaître qu’un seul héritier, puis, par une application toute contraire du principe d’égalité, l’admission de tous les enfants à la succession du père, et, tout récemment encore parmi nous, l’abolition définitive du droit d’aînesse.
Mais qu’y a-t-il de commun entre ces grossières ébauches d’organisation instinctive et la véritable science sociale? Comment ces mêmes hommes, qui n’eurent jamais la moindre idée de statistique, de cadastre, d’économie politique, nous donneraient-ils des principes de législation ?
La loi, dit un jurisconsulte moderne, est l’expression d’un besoin social, la déclaration d’un fait; le législateur ne la fait pas, il la décrit. Cette définition n’est point exacte: la loi est la règle selon laquelle les besoins sociaux doivent être satisfaits j le peuple ne la vole pas, le législateur ne l’exprime pas : le savant la découvre et la formule.
Mais enfin la loi, telle que M. Ch. Comte a consacré un demi-volume à la définir, ne pouvait être dans l’origine que l’expression d’un besoin et l’indication des moyens d’y subvenir ; et jusqu’à ce moment elle n’a pas été autre chose. Les légistes, avec une fidélité de machines, pleins d’obstination, ennemis de toute philosophie, enfoncés dans le sens littéral, ont toujours regardé comme le dernier mot de la science ce qui n’a été que le vœu irréfléchi d’hommes de bonne foi, mais de peu de prévoyance.
Ils ne prévoyaient pas, ces vieux fondateurs du domaine de propriété, que le droit perpétuel et absolu de conserver son patrimoine, droit qui leur semblait équitable, parce qu’il était commun, entraîne le droit d’aliéner, de vendre, de donner, d’acquérir et de perdre ; qu’il ne tend, par conséquent, à rien moins qu’à la destruction de cette égalité en vue de laquelle ils l’établissaient : et quand ils auraient pu le prévoir, ils n’en eussent tenu compte ; le besoin présent l’emportait, et, comme il arrive d’ordinaire en pareil cas, les inconvénients furent d’abord trop faibles et passèrent inaperçus.
Ils ne prévoyaient pas, ces législateurs candides, que si la propriété se conserve par la seule intention, nudo anima, elle emporte le droit de louer, affermer, prêter à intérêt, bénéficier dans un échange, constituer des rentes, frapper une contribution sur un champ que l’intention se réserve, tandis que le corps est ailleurs occupé.
Ils ne prévoyaient pas, ces patriarches de notre jurisprudence, que si le droit de succession est autre chose qu’une manière donnée par la nature de conserver l’égalité des partages, bientôt les familles seront victimes des plus désastreuses exclusions, et la société, frappée au cœur par l’un de ses principes les plus sacrés, se détruira d’elle-même par l’opulence et la misère.
Définitions (pages 85-87)
Le droit romain définit la propriété, jus utendi et abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur, le droit d’user et d’abuser de la chose, autant que le comporte la raison du droit. On a essayé de justifier le mot abuser, en disant qu’il exprime non l’abus insensé et immoral, mais seulement le domaine absolu. Distinction vaine, imaginée pour la sanctification de la propriété, et sans efficace contre les délires de la jouissance, qu’elle ne prévient ni ne réprime. Le propriétaire est maître de laisser pourrir ses fruits sur pied, de semer du sel dans son champ, de traire ses vaches sur le sable, de changer une vigne en désert, et de faire un parc d’un potager ; tout cela est-il, oui ou non, de l’abus? En matière de propriété, l’usage, et l’abus nécessairement se confondent.
D’après la Déclaration des droits, publiée en tête de la constitution de 93, la propriété est « le droit de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. »
Code Napoléon art. 544 : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ».
Ces deux définitions reviennent à celle du droit romain : toutes reconnaissent au propriétaire un droit absolu sur la chose ; et, quant à la restriction apportée par le Code, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ; elle a pour objet, non de limiter la propriété, mais d’empêcher que le domaine d’un propriétaire ne fasse obstacle au domaine d’un autre propriétaire : c’est une confirmation du principe, ce n’est pas une limitation.
On distingue dans la propriété : 1° La propriété pure et simple, le droit nominal, seigneurial sur la chose, ou, comme l’on dit, la nue propriété ; 2° La possession, dit Duranton, est une chose de fait, et non de droit. Toullier : « La propriété est un droit, une faculté légale ; la possession est un fait. » Le locataire, le fermier, le commandité, l’usufruitier, sont possesseurs; le maître qui loue, qui prête à usage ; l’héritier qui n’attend pour jouir que le décès d’un usufruitier, sont propriétaires. Si j’ose me servir de cette comparaison, un amant est possesseur, un mari est propriétaire.
Cette double définition de la propriété, en tant que domaine et en tant que possession, est de la plus haute importance; et il est nécessaire de s’en bien pénétrer, si l’on veut entendre ce que nous aurons à dire.
De la distinction de la possession et de la propriété sont nées deux espèces de droits : le jus in re, droit dans la chose, droit par lequel je puis réclamer la propriété qui m’est acquise, en quelques mains que je la trouve; et le jus ad rem, droit à la chose, par lequel je demande à devenir propriétaire. Ainsi le droit des époux sur la personne l’un de l’autre est jus in re ; celui de deux fiancés n’est encore que jus ad rem. Dans le premier, la possession et la propriété sont réunies ; le second ne renferme que la nue propriété. Moi qui, en ma qualité de travailleur, ai droit à la possession des biens de la nature et de l’industrie, et qui, par ma condition de prolétaire, ne jouis de rien, c’est en vertu du jus ad rem que je demande à rentrer dans le jus in re.
Cette distinction du jus in re et du jus ad rem est le fondement de la division fameuse du possessoire et du pétitoire, véritables catégories de la jurisprudence, qu’elles embrassent tout entière dans leur immense circonscription. Pétitoire se dit de tout ce qui a rapport à la propriété ; Possessoire de ce qui est relatif à la possession. En écrivant ce factum contre la propriété, j’intente à la société tout entière une action pétitoire ; je prouve que ceux qui ne possèdent pas aujourd’hui sont propriétaires au même titre que ceux qui possèdent ; mais au lieu de conclure à ce que la propriété soit partagée entre tous, je demande que, par mesure de sûreté générale, elle soit abolie pour tous. Si je succombe dans ma revendication, il ne nous reste plus, à vous tous prolétaires, et à moi, qu’à nous couper la gorge : nous n’avons plus rien à réclamer de la justice des nations : car, ainsi que l’enseigne dans son style énergique le Code de procédure, article 26, le demandeur débouté de ses fins au pétitoire, n’est plus recevable à agir au possessoire. Si, au contraire, je gagne mon procès : alors il nous faudra recommencer une action possessoire, à cette fin d’obtenir notre réintégration dans la jouissance des biens que le domaine de propriété nous ôte. J’espère que nous ne serons pas forcés d’en venir là ; mais ces deux actions ne pouvaient être menées de front parce que, selon le même Code de procédure, le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés.
L’injustice de la propriété (pages 98-99)
Reid, traduction de M. Jouffroy, tome VI, p. 363, [ndlr. ainsi cité par Proudhon] :
« Le droit de propriété n’est point naturel, mais acquis ; il ne dérive point de la constitution de l’homme, mais de ses actes. Les jurisconsultes en ont expliqué l’origine d’une manière satisfaisante pour tout homme de bon sens. — La terre est un bien commun que la bonté du ciel a donné aux hommes pour les usages de la vie ; mais le partage de ce bien et de ses productions est le fait de ceux-ci : chacun d’eux a reçu du ciel toute la puissance et toute l’intelligence nécessaires pour s’en approprier une partie sans nuire à personne.
« Les anciens moralistes ont comparé avec justesse le droit commun de tout homme aux productions de la terre, avant qu’elle ne soit occupée et devenue la propriété d’un autre, à celui dont on jouit dans un théâtre ; chacun en arrivant peut s’emparer d’une place vide, et acquérir par là le droit de la garder pendant toute la durée du spectacle, mais personne n’a le droit de déposséder les spectateurs déjà placés. — La terre est un vaste théâtre que le Tout-Puissant a disposé avec une sagesse et une bonté infinie pour les plaisirs et les travaux de l’humanité tout entière. Chacun a droit de s’y placer comme spectateur, et d’y remplir son rôle comme acteur, mais sans troubler les autres. »
Conséquences de la doctrine de Reid
1. Pour que la partie que chacun peut s’approprier ne fasse tort à personne, il faut qu’elle soit égale au quotient de la somme des biens à partager, divisée par le nombre des copartageants ;
2. Le nombre des places devant être toujours égal à celui des spectateurs, il ne se peut qu’un seul spectateur occupe, deux places, qu’un même acteur joue plusieurs rôles ;
3. A mesure qu’un spectateur entre ou sort, les places se resserrent ou s’étendent pour tout le monde dans la même proportion : car, dit Reid, le droit de propriété n’est point naturel, mais acquis ; par conséquent il n’y a rien d’absolu, par conséquent la prise de possession qui le constitue étant un fait contingent, elle ne peut communiquer à ce droit l’invariabilité qu’elle n’a pas. C’est ce que le professeur d’Edimbourg semble avoir compris lorsqu’il ajoute :
« Le droit de vivre implique le droit de s’en procurer les moyens, et la même règle de justice qui veut que la vie de l’innocent soit respectée, veut aussi qu’on ne lui ravisse pas les moyens de la conserver : ces deux choses sont également sacrées… Mettre obstacle au travail d’autrui, c’est commettre envers lui une injustice de la même nature que de le charger de fers ou de le jeter dans une prison, le résultat est de la même espèce et provoque le même ressentiment. ».
Ainsi, le chef de l’école écossaise, sans aucune considération pour les inégalités de talent ou d’industrie, pose a priori l’égalité des moyens de travail, abandonnait ensuite aux mains de chaque travailleur le soin de son bien-être individuel, d’après l’éternel axiome : Qui bien fera, bien trouvera.
Ce qui a manqué au philosophe Reid, ce n’est pas la connaissance du principe, c’est le courage d’en suivre les conséquences. Si le droit de vivre est égal, le droit de travailler est égal, et le droit d’occuper encore égal. Des insulaires pourraient-ils, sans crime, sous prétexte de propriété, repousser avec des crocs de malheureux naufragés qui tenteraient d’aborder sur leur côte? L’idée seule d’une pareille barbarie révolte l’imagination. Le propriétaire, comme un Robinson dans son île, écarte à coups, de pique et de fusil le prolétaire que la vague de la civilisation submerge, et qui cherche à se prendre aux rochers de la propriété. Donnez-moi du travail, crie celui-ci de toute sa force au propriétaire ; ne me repoussez pas, je travaillerai pour le prix que vous voudrez. — Je n’ai que faire de tes services, répond le propriétaire en présentant le bout de sa pique ou le canon de son fusil. — Diminuez au-moins mon loyer. — J’ai besoin de mes revenus pour vivre. — Comment pourrai-je vous payer, si je ne travaille pas ? — C’est ton affaire. Alors l’infortuné prolétaire se laisse emporter au torrent, ou, s’il essaie de pénétrer dans la propriété, le propriétaire le couche en joue et le tue.