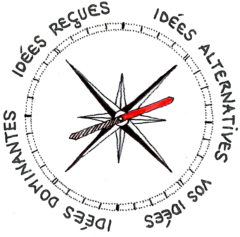Raphaël
Beaucoup de groupes radicaux ancrent leurs projets politiques dans la petite échelle du quotidien et des luttes locales d’une part, et dans l’échelle immense, presque abstraite, des principes éthiques d’autre part. Mais ils évitent comme un tabou ce qui se trouve entre les deux : la question importante, à la fois concrète et planétaire, d’un projet de société. Voici une invitation à relever le défi.
Un syndicat social-démocrate organise une « action symbolique » pour « alerter les médias » sur les dangers de telle réforme libérale mise en oeuvre par le gouvernement. Sous l’oeil des caméras, en pleine ville, les gens sont conviés à venir déposer une fleur sur un cercueil en carton, le « cercueil de nos acquis sociaux » ; au passage ils sont invités à signer une pétition. Un anarchiste passe par là, frémit, mais comme il est d’une humeur pimpante il prend le temps de parler à un militant du syndicat, une fois n’est pas coutume. Le traitant de réformiste, il lui explique qu’il fait fausse route, que son action n’a aucun poids, qu’il ne s’attaque pas assez aux problèmes de fond de cette société. La discussion aboutit aux trois inévitables répliques suivantes :
– J’ai compris, rien de ce que nous proposons n’est assez radical. Mais vous, au fond, vous proposez quoi?
– Une société sans classes, sans Etat, sans patrie ni frontières, sans argent, sans école, sans genres, sans armée, sans oppression, sans…
– Oui non mais d’accord, mais je veux dire, concrètement, elle fonctionnerait comment cette société ? »
Ici il peut y avoir subitement un glaçon dans la gorge. Généralement, les réponses cachent mal nos lacunes :
– « je ne suis pas stalinien donc je n’ai aucune recette à donner, on verra petit-à-petit en s’auto-organisant » ;
– ou « nous n’avons même pas les mots pour dire ce que pourrait être cette nouvelle société, parce que notre cerveau est complètement façonné par la société pourrie d’aujourd’hui » ;
– ou encore, si le courant passe très bien, « viens boire une bière, on va en causer toute la nuit ».
Le débat est donc abandonné, ou poursuivi sur un mode privatisé, nébuleux et presque oisif. En clair, nous n’avons pas vraiment de réponse. Aujourd’hui personne parmi les révolutionnaires n’a de réponse.
Nous avons été échaudé·e·s par ce que des partis « communistes » ont pu faire avec des « projets de société », et nous n’osons plus entrer en matière. Réaction d’humilité, besoin de reprendre notre souffle : nous avons appris la leçon, nous savons maintenant les dangers totalitaires d’une passion pour un idéal de société. Fort·e·s de cette prudence, de toutes manières profondément inscrite dans la conscience collective contemporaine, nous sommes pourtant mûr·e·s pour remettre nos imaginations en marche.
Nous avons besoin de projets de société crédibles. Pour évoquer ce vers quoi nous voulons tendre, nous donnons souvent une liste de valeurs (entraide, autogestion, autonomie, émancipation et compagnie) : mais nous ne sommes pas que des philosophes. Nous avons aussi besoin de montrer que ces valeurs peuvent s’incarner, et c’est bien pour cela que nous avons développé toutes sortes de petites alternatives, squats, cantines ambulantes, infokiosques, jardins collectifs… Il nous reste maintenant un pas à franchir : un changement d’échelle. Il nous reste à penser comment ces valeurs peuvent, parce que nous sommes persuadé·e·s qu’elles le peuvent, être le noyau d’une organisation sociale plus large, voire planétaire. Penser cette globalité, c’est penser l’organisation avec l’Autre, aussi lointain et abstrait soit-il : c’est le lieu même de la question politique. Sans stratégie ni projet global de société, nous surfons en rond entre nos envies immédiates et nos éthiques aériennes : cela ne nous suffit plus.
Nous avons quelques pistes. Le fédéralisme libertaire, dans l’Espagne de 36, a pu fournir un aperçu de ce que pouvait donner l’autogestion au-delà de ma maison, au-delà de ma fac occupée, au-delà de mon campement activiste.
Il y a aussi Bolo’bolo, un livre qui du fond des années 80 s’autorisait l’imagination d’une société organisée en petites collectivités très diverses, après la chute du capitalisme.
A chacun de nos groupes aujourd’hui de questionner ces pistes. Et de reprendre le flambeau.
De notre côté, par exemple, nous pouvons dire que nous ne voulons pas abolir le principe d’organisation en société, ni le machinisme en soi. Nous nous réjouissons d’affronter plus finement ces questions et d’en aborder beaucoup d’autres qui pendent à la vision d’une autre société. Les moyens de subsistance seraient-ils garantis pour tous et toutes, peu importe le travail fourni par chacun·e ? Comment établirait-on la liste des quelques tâches indispensables à la survie de la société, et à répartir malgré tout de manière équitable ? Que se passera-t-il face à quelqu’un·e qui ne veut pas les faire ? Comment les conflits seront-ils accompagnés, par quel moyen essaierons-nous de les résoudre ? Y aura-t-il des sanctions ? A quelle échelle pratiquerons-nous la démocratie directe ? Y aura-t-il encore des villes ? Comment serons nous relié·e·s aux autres collectivités ? Aurons-nous des biens, par exemple, à nous transmettre entre collectivités ? Les compterons nous, garderons-nous une monnaie d’échange ? Que ferons-nous si une autre collectivité veut développer l’énergie nucléaire, ou toute autre chose qui menace les collectivités alentour ?
Dans notre groupe, nous comptons faire ce travail de précision. Nous viendrons peut-être prochainement avec la proposition noir sur blanc d’un autre modèle de société. Nous ne le ferons pas en disant : « adoptez notre programme, c’est le meilleur ». Nous le ferons en disant : « voici la balle que nous lançons au monde et en particulier à tou·te·s les révolutionnaires, à vous de la renvoyer avec vos contre-projets. Nous amenons de la matière pour que ce débat-là avance ». Parce que ce qui compte le plus à nos yeux, c’est un type de réflexion où nos grands principes se mettent à l’épreuve de la réalité, qui est globale. Et la meilleure garantie contre les tentations totalitaires de tout modèle de société, c’est que chaque groupe de 5 personnes sur cette Terre développe ce type de réflexion, de créativité.
On nous dit : « moi j’ai une famille à nourrir vous savez ». Cette formule est une alerte, parce qu’elle nous met en face du vécu, des besoins les plus concrets, de sécurités matérielles, morales, affectives. Nous devons pouvoir montrer que nous savons, que nous pouvons répondre à ces besoins, dès aujourd’hui dans nos formes de lutte, mais aussi demain dans nos projets de société. Que contrairement aux idées reçues, une vision élevée de l’être humain est intimement liée à la considération de ses préoccupations les plus ras-de-terre. Que « l’utopie » dans laquelle nous osons nous aventurer est même plus efficace que ce qui existe aujourd’hui. Nous sommes prêt·e·s à entrer dans ce débat à coups de chiffres. Les artistes des mathématiques et de la prospective sont souvent refoulé·e·s au contact de milieux politiques qui siègent fièrement, exclusivement dans le monde des belles-lettres et des grands sentiments ; nous ne voulons pas les laisser aux ONG et à l’écologie technicienne, nous voulons les accueillir, nous avons des études enthousiasmantes à partager avec elles et eux.
Notre baluchon est bourré de propositions en or : il devient urgent de les travailler et d’oser les porter avec aplomb.