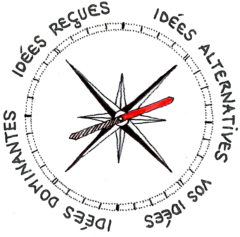Tony Andréani In: « Dix essais sur le socialisme du XXIème siècle », Le Temps des cerises, 2011, pp. 37-76.
Le socialisme ne fait plus recette. Mais le capitalisme non plus : face aux piètres performances du capitalisme néo-libéral, à la stupéfiante montée des inégalités qu’il a provoquée, tant au sein des pays qu’entre les pays, aux dégâts sociaux et environnementaux qu’il a engendrés, un puissant mouvement anti-capitaliste a pris son essor dans les dernières années. Mais ce mouvement ne sait pas où il va : il lui manque cruellement des perspectives, un horizon. Or les recherches sur le socialisme, si elles ont décliné sur le plan historique, du fait de la disparition de la majeure partie de leur objet de référence, avec l’effondrement du bloc soviétique et la fin de l’expérience yougoslave, sont restées vivaces sur le plan théorique, même si elles ont connu un certain essoufflement avec la perte de tout enjeu politique immédiat. L’objet de cet article est d’en retracer succinctement le parcours, à destination d’un lecteur français qui a été presque privé d’information, tant le centre de ces recherches s’était déplacé vers le monde anglo-saxon, et tant la conjoncture intellectuelle y était défavorable dans notre pays (à la surprise des historiens, notamment anglais, des idées). Ces recherches théoriques ont pris la forme d’essais politico-philosophiques, mais surtout de tentatives pour élaborer des “ modèles ” de socialisme, dans la continuité d’une tradition qui remonte au siècle dernier.
Qu’est-ce qu’un modèle ?
Il nous faut d’abord préciser ce que “ modèle ” veut dire. Le modèle peut être un régime social de référence, dont on se propose de s’inspirer tout en l’améliorant. Il y eut ainsi, du côté du socialisme qui se disait réel, le “ modèle soviétique ”, le “ modèle cubain ”, le “ modèle chinois ”, le “ modèle yougoslave ”, pour ne pas parler d’un “ modèle albanais ” qui eut quelques adeptes. Ce n’est pas de cela que nous voulons parler ici, mais de modèles qui visent à représenter un nouveau système social, un système qui soit cependant historiquement réalisable – ce qui le différencie des conceptions utopiques. Il empruntera naturellement de nombreux traits aux systèmes existants : on reprend ici l’idée de Marx que le nouveau émerge déjà dans l’ancien – une des leçons fondamentales du matérialisme historique.
En second lieu le “ modèle ”, s’il doit être plus qu’une représentation simplifiée de l’existant (on sait que Marx, mais d’autres aussi, ont produit des théories du capitalisme en général, de ses tendances, de ses stades, sans jamais se limiter à l’une de ses configurations particulières), s’il doit fournir les grandes lignes d’une société différente, ne peut être qu’une “ esquisse ”, une “ figure stylisée ”, une “ maquette ” de cette société. On lui demande seulement de fournir les structures de base, les principales institutions, de manière à ce qu’elles constituent un tout cohérent et viable[1] – ce qui ne veut pas dire harmonieux, dénué de contradictions, d’effets pervers, de difficultés diverses. Il est donc exclu d’entrer dans le détail (même s’il est bon de donner, ici ou là, des illustrations, ou d’envisager tel dispositif plus concret), d’abord parce que ce serait trop compliqué, ensuite parce que la réalité, dans sa complexité, sera toujours différente des attentes. Si les modèles se veulent expérimentaux, ce n’est pas parce qu’on pourrait les appliquer (les circonstances historiques sont toujours particulières), mais parce que, en tant que clefs de lecture, ils doivent être soumis à l’épreuve du réel. C’est l’expérience qui dira leur pertinence, à condition qu’elle ne soit pas étouffée par le dogme, et c’est en fonction d’elle qu’il faudra réviser le modèle, voire en changer.
En troisième lieu le modèle est d’abord économique, mais en en un sens large du terme. Les théoriciens s’écartent tous plus ou moins d’une conception purement économique, issue de la théorie néo-classique (qui voit les marchés comme un ensemble de “mécanismes ” , auxquels il suffirait de fixer quelques règles), et ils peuvent être considérés comme des “ institutionnalistes ” – d’où certains rapprochements avec les néo-institutionnalistes qui continuent à travailler dans le cadre néo-classique, en particulier ceux des théories de la firme (théorie contractualiste, théorie des droits de propriété, théorie de “ l’agence ”), auxquels il leur arrive d’emprunter des concepts – en les retournant contre leurs auteurs, partisans convaincus du capitalisme. Cette fixation sur l’économie s’explique par le fait que l’objectif est de reconstruire la base économique du socialisme, un nouveau “ mode de production ”, comme dirait Marx, d’abord parce qu’elle est la clef de tout le reste, ensuite parce que là se situe le principal défi du capitalisme, celui de l’efficience. Mais les préoccupations philosophiques, qu’elles soient de nature morale, de nature juridique, ou de nature anthropologique, sont toujours présentes, car l’efficience doit être mise au service de valeurs différentes de celles du capitalisme et supérieures à elles. On le voit bien en particulier chez les auteurs anglo-saxons : ils sont tous partie prenante d’un vaste débat sur la justice, qu’ils tentent de renouveler.
Enfin les recherches sur les modèles présentent un caractère “ constructiviste ”, voire volontariste. Si elle doivent beaucoup, ainsi qu’on le verra, à Hayek, dont les objections sont prises au sérieux, elles s’opposent à lui, non seulement parce qu’il est un chantre du capitalisme, mais encore parce qu’il est un adversaire de tout interventionnisme (et de la démocratie elle-même comme pouvoir potentiellement illimité), susceptible, selon lui, de conduire à la dictature, de fausser le mouvement spontané de l’histoire et la sélection naturelle du meilleur système. Alors que le capitalisme se développe et se transforme comme de lui-même, les institutions et les régulations venant toujours après coup, le socialisme correspond à une volonté, pour paraphraser Marx, non seulement d’interpréter le monde, mais de le transformer. L’idée même de modèle suppose qu’il n’y pas de fatalité historique, remet en cause le nécessitarisme historique que l’on trouve dans certains écrits ou certaines formulations de ce dernier. L’idée est bien plutôt que l’histoire offre des champs de possibles à telle époque donnée, qu’il faut les découvrir et les exploiter. Le grand drame des modélisateurs est que, jusqu’à présent, ils sont restés, sauf dans les pays déjà socialistes, bien loin des centres de pouvoir, et sans grande influence sur les forces politiques organisées…
Un champ de recherches déserté sur le Vieux Continent
La notion même de “ modèle ” de socialisme est à peu près étrangère à la tradition intellectuelle française. Le fait est assez curieux, de la part d’un pays qui, au dix-neuvième siècle, a été particulièrement fécond en projets de socialisme (pensons à tous les socialismes “ utopiques ”, qui furent parfois l’œuvre de simples ouvriers). C’est peut-être parce que cette tradition a été surtout politique, peu préoccupée de théorie économique, et aussi parce que, sous l’influence d’un parti communiste puissant, la gauche radicale a été longtemps fascinée par le modèle soviétique, avant de le jeter par dessus bord[2]. Quoiqu’il en soit, les références françaises sont pratiquement absentes dans l’imposante littérature sur les modèles de socialisme, et la grande ébullition politique et intellectuelle faisant suite au Mai 68 français n’a accouché en la matière que de souris.
En fait on a beaucoup discuté dans les pays continentaux de l’Ouest européen du meilleur modèle social de capitalisme, mais c’est surtout dans les pays du bloc soviétique et dans les pays anglo-saxons que l’on a vu fleurir les modèles de socialisme à proprement parler. Dans les premiers, après les débats des années 20, et une fois le “ système soviétique ” mis en place, la question était essentiellement de le “ réformer ” pour le rendre plus efficient, au fur et à mesure que les signes de blocage devenaient plus manifestes. Tout effort pour le changer radicalement était considéré comme hérétique – c’est ainsi que le système yougoslave fut voué aux gémonies jusqu’à la perestroïka. Aujourd’hui les recherches semblent au point mort en Russie et dans l’Est européen, sous l’effet du traumatisme politique. Dans les pays anglo-saxons l’objectif était tout autre : il fallait innover, trouver un système qui combinât efficience, justice et démocratie. Si les auteurs américains ont été les plus productifs et les plus inventifs, c’est peut-être parce que le pragmatisme propre à leur culture, leur souci de s’appuyer sur des études empiriques et l’influence de la philosophie analytique, qui obligeait à ne pas se payer de mots, ont poussé dans la voie du réalisme. C’est peut-être aussi parce que le système universitaire états-unien ouvrait, en dépit ou à cause de son caractère concurrentiel, plus d’espaces pour des recherches d’une certaine qualité technique, et parce qu’une vieille tradition du débat académique restait vivace. On peut également trouver d’autres raisons, notamment le fait que c’est au cœur de la plus grande métropole capitaliste que les ressorts du capitalisme étaient les plus visibles et ses maux les plus sensibles. La vitalité des recherches britanniques s’explique sans doute par des raisons du même ordre, mais aussi parce que les échanges y ont été soutenus avec les collègues américains.
Aujourd’hui un rapprochement encore timide s’exerce entre les chercheurs occidentaux et les chercheurs des pays encore socialistes (Chine, Vietnam, Cuba essentiellement). On constate un intérêt réciproque, et un petit courant d’échanges. Mais il se pourrait bien que la crise des systèmes de type socio-démocrate européens, sous les coups de boutoir du “ modèle anglo-saxon ” de capitalisme, réveille dans les pays du Vieux Continent des interrogations sur le socialisme hier encore considérées comme hors de propos…
Nous commencerons par un bref survol chronologique des modélisations jusqu’aux années 70, pour donner ensuite une idée des problèmes posés et des types de réponses que les modèles contemporains, dans leur différentes “ familles ”, ont essayé de leur apporter.
La NEP, modèle ou compromis ?
La Nouvelle Politique Economique, décrétée en Mars 1921 pour surmonter le désastre économique et les résistances issues du “ communisme de guerre ”, dessine un ensemble d’institutions qui anticipe le “ socialisme réalisable ” que l’économiste Alec Nove préconisera 60 ans plus tard[3] et le socialisme de marché tel qu’il existe aujourd’hui en Chine ou au Vietnam. Les réquisitions dans les campagnes sont remplacées par un impôt en nature. Les entreprises industrielles, bancaires et commerciales, qui ont été toutes étatisées, retrouvent légalement une autonomie de gestion. Le marché est rétabli tant pour les biens de production que pour les biens de consommation. Les coopératives de production sont encouragées. Mais ce n’est pas tout : la petite entreprise privée est autorisée (à condition d’employer moins de 20 personnes), ainsi que l’attribution de baux à des capitalistes nationaux et de concessions à des capitalistes étrangers[4]. On a donc des formes multiples de propriété. S’agissant des contrats passés par l’Etat avec des capitalistes, Lénine considère qu’ils relèvent d’un capitalisme d’Etat : un capitalisme, parce qu’ils laissent place au profit privé, mais un capitalisme d’Etat, parce que l’Etat ouvrier leur confère un caractère “ aux trois quarts ” socialiste dans la mesure où il contrôle le processus et l’articule à un plan, qui ne joue cependant qu’un rôle subordonné. La question posée par la NEP est de savoir s’il ne s’agit que d’un “ recul stratégique ” et d’une courte “ transition ” imposée par les circonstances.
A vrai dire la plupart des théoriciens bolcheviks, dont les grands dirigeants politiques, sont persuadés que cette transition doit mener à une forme d’économie totalement différente du capitalisme, qui sera “ organisée selon un plan conscient ” et d’où la loi de la valeur aura disparu. Une économie, qui, étant commandée et administrée, pour employer des termes qui seront utilisés plus tard par les analystes du système soviétique, sera délivrée des maux de l’économie capitaliste et du fétichisme des rapports marchands. La NEP n’est donc pas un “ modèle de socialisme ”, qui aurait une stabilité et une dynamique propre pour une longue période historique[5]. Mais ils voient cette transition différemment. Pour un Préobrajenski elle correspond à une période de conflit entre deux régulateurs, la loi de la valeur et le principe de planification, le second devant s’imposer à la première de manière à réaliser une “ accumulation primitive socialiste ” (un prélèvement sur l’agriculture, ou encore un échange inégal, destiné à financer l’industrie lourde entièrement étatisée). C’est Boukharine et son école qui voient plutôt une combinaison entre le plan et le marché, devant respecter des équilibres, une combinaison qui annonce l’idée d’une planification incitative plus que directive. Certes pour eux, comme pour Préobrajenski, le problème vient de ce que l’économie ne peut pas être encore entièrement étatisée, et que de ce fait les deux secteurs, celui de l’économie d’Etat et celui de l’économie privée, sous ses formes diverses, doivent communiquer par le marché. Mais ils pensent que l’on peut orienter le marché. Car le secteur d’Etat occupe “ les positions dominantes ” dans l’industrie, et joue ainsi un “ rôle dirigeant ”[6] : exactement ce que disent aujourd’hui les dirigeants chinois. En s’appuyant sur lui, l’Etat peut “ influencer ” le marché de diverses manières : en fixant le prix de ses produits, ce qui a des effets sur toutes les autres branches de l’économie, en jouant sur ses réserves pour modifier les conditions de l’offre, en exerçant un contrôle des prix sur le secteur privé etc. Ainsi l’Etat soviétique “ exerce son influence sur le jeu spontané des rapports économiques du marché en mettant à profit les lois même du marché et en les contraignant à jouer conformément à ses intentions ” (souligné par les auteurs)[7].
On ne peut toutefois parler, avec cette dernière école (qualifiée alors de “ droitière ”), de modèle de socialisme de marché, ou bien il faut parler d’un modèle foncièrement bâtard : le secteur d’Etat, lui, est administré. Sans doute existe-t-il entre les établissements d’Etat (par exemple ceux qui construisent des locomotives et ceux qui sont chargés du transport par voie ferrée) des échanges en termes de prix, mais il ne s’agit là que d’une “ enveloppe ” résultant de ce qu’ils sont tributaires d’autres marchandises. Et les auteurs ne voient pas l’intérêt de la grande autonomie conférée aux entreprises (autonomie financière, indépendance de gestion, choix des fournisseurs et des clients, poursuite d’une rentabilité, financement par le crédit), qui sera rapidement restreinte à la fois par des concentrations imposées sous forme de “ trusts ” et par des restrictions de la liberté de commerce. Il y a pourtant tout lieu de penser que c’est cette autonomie qui a favorisé un redémarrage économique, bien plus que les affermages et concessions, qui n’ont joué qu’un rôle mineur[8].
Le modèle de planification intégrale
On ne trouve donc pas, même chez les dirigeants bolcheviks de la NEP les plus favorables à l’utilisation des rapports marchands, de véritable théorie d’un socialisme de marché[9]. Le modèle qu’ils ont tous en vue, c’est un modèle de planification directive et un modèle où la loi de la valeur sera remplacée par une “ loi de la dépense de travail ”. Le passage brutal à l’étatisation complète, ou du moins à la collectivisation (les Kolkhozes relèvent non de la propriété d’Etat, mais de la propriété collective), à la planification impérative et aux transferts administratifs entre les unités de production (souvent constituées en monopoles), passage lié moins aux inquiétudes suscitées par un développement capitaliste resté modeste (les koulaks ne représentaient que 5% des familles) qu’aux résistances à la commercialisation de paysans soucieux de relever d’abord leur niveau de consommation, passage lié aussi aux luttes de pouvoir au sein de l’appareil, ne correspond donc pas à un changement radical de cours. Les raisons invoquées pour justifier l’étape de la NEP ont été surtout la faible socialisation des forces productives et l’isolement de l’URSS, la révolution mondiale n’étant pas au rendez-vous (thématique développée surtout par les trotskystes).
Quant à l’objectif à atteindre, les choses n’étaient pas parfaitement claires. Fallait-il fonder le calcul économique sur les valeurs d’usage (contrairement à ce que Marx avait clairement dit) ? Fallait-il le fonder sur un calcul en termes de dépenses de travail (ce que Marx préconisait sans aucun doute, pour en finir avec les rapports marchands), ce qui n’aurait pas forcément exclu l’existence d’échanges en valeurs-travail, mais aurait entraîné la suppression de la monnaie et le remplacement des salaires par la distribution de “ bons de travail ”[10] ? Ou bien fallait-il fixer des “ prix ” en termes d’exigences politiques, censées refléter les besoins de la société ? C’est la dernière voie, on le sait, qui fut suivie : l’Etat prolétarien a décidé de tout : de la hiérarchie des besoins, de la hiérarchie des salaires, de l’affectation des ressources, des priorités (dont la fameuse priorité en faveur de l’industrie lourde), et finalement des prix, qui sont devenus pour la plupart totalement administrés (fixés par le Plan d’Etat). Et comme cette planification impérative ne pouvait fonctionner qu’à l’aide de mesures physiques (les “ balances matières ” ), transcrites dans un système de prix ne jouant pas de rôle actif, mais seulement un rôle de comptabilisation, on a eu une économie très politique articulée autour de ces mesures. Seule la consommation, dans la mesure où elle n’était plus un système de rationnement, comportait, du côté de la demande, quelque chose d’un rapport marchand.
La conception sous-jacente à ce modèle, qui s’est concrétisé sous la forme de ce qu’on a appelé le système soviétique, est une conception organiciste : toutes les unités de production (on ne peut plus vraiment parler d’entreprises) devaient fonctionner comme les rouages d’une vaste machinerie. Les travailleurs devaient être motivés non plus par quelque intérêt personnel, mais par un haut niveau de “ conscience socialiste ”. L’économie pourrait être commandée comme une seule entreprise, comme une sorte de cartel géant, ce qui devait mettre fin à l’opacité et aux secousses du marché.
Ce modèle de planification intégrale aura, nous le verrons, une descendance aujourd’hui sous la forme des modèles de planification démocratique.
Le modèle “ occidental ” de planification concurrentielle
Pendant les années 30 on voit se développer un tout autre modèle, mais hors de l’Union soviétique, où tout débat, du moins public, a été étouffé par Staline, s’érigeant en seul maître à penser. Il ne s’agit plus de concevoir un socialisme qui utilise transitoirement certains rapports marchands, mais un socialisme de marché, au sens plein du terme, qui mette en œuvre la plupart des rapports marchands (ceux du marché de marchandises, mais aussi du marché du travail et du capital), en faisant jouer au plan le rôle du maître d’œuvre (à la place du fictif commissaire priseur walrassien) : d’où l’expression, en apparence paradoxale, que j’utilise ici de “planification concurrentielle ”. Ce modèle est connu comme étant le modèle “ Lange-Lerner ”, du nom de ses principaux contributeurs.
Sur le plan de la théorie économique, ces auteurs prennent leurs distances par rapport à Marx. Ils soulignent en particulier le rôle joué par le capital-argent (si celui-ci n’était pas rare, dit Lange, la théorie marxienne de la valeur-travail serait alors suffisante[11]). Ils se réfèrent plutôt à la théorie néo-classique, cherchant comme elle à résoudre le problème d’une allocation optimale des ressources. Or le plan pourrait la réaliser mieux que le marché, en fixant les prix d’équilibre par tâtonnement, en lieu et place des ajustements par le marché, qui seraient beaucoup plus lents. Si le Bureau central de planification procède par une méthode d’essais et d’erreurs, il n’a pas à effectuer le calcul de millions d’équations simultanées. Il annonce des prix, les entreprises (publiques et concurrentielles) y réagissent en l’informant de leurs offres, de leurs demandes et de celles qui leur sont adressées, et le Bureau les ajuste de manière à réaliser l’équilibre ex ante (chaque entreprise a fait son calcul en minimisant le coût unitaire des produits et en fixant le volume de sa production de manière à égaliser le prix et le coût marginal, ce qui revient, conformément à la théorie néo-classique, à maximiser le profit). Le plan fait mieux que le marché parce qu’il agit plus vite et parce qu’il dispose de toutes les informations à la fois.
S’agit-il seulement de remplacer les fonctions du marché ? Le plan a aussi d’autres fonctions : il fixe directement le taux d’accumulation à long terme[12] (une décision qui ne dépend donc plus du choix d’épargne des ménages), puis il répartit le capital entre secteurs et entreprises par l’intermédiaire de taux d’intérêt fixés de façon à équilibrer l’offre et la demande de capital, et il détermine aussi en partie la répartition des revenus (c’est ainsi qu’une part des profits est distribuée aux travailleurs), pour la rendre à la fois plus juste et plus rationnelle.
Ce modèle a suscité des critiques de Hayek sur lesquelles nous reviendrons (oubli que le marché est un processus non seulement d’information, mais aussi de découverte et d’apprentissage pour les entreprises, défauts de contrôle, de stimulation et d’esprit entrepreneurial). On pourrait imiter le marché, mais non se substituer à lui. Les économistes marxistes[13] ont émis des critiques de style opposé, concernant surtout les décisions d’investissement : n’y avait-il pas une contradiction entre la fixation directe du taux d’accumulation et la remise aux entreprises de ces décisions ? N’était-il pas plus efficace de les prendre centralement ?
Le modèle “ Lange-Werner ” était très théorique, en particulier s’agissant de la simulation du plan par le marché (le tâtonnement, notait Hayek, serait interminable en raison des changements qui interviennent constamment dans l’économie)[14]. Il aura cependant une descendance, comme nous le verrons, dans les modèles de socialisme de marché, proposés beaucoup plus tard, qui utiliseront aussi l’appareil théorique néo-classique et préconiseront, à des fins d’allocation efficiente, un marché du capital, notamment sous la forme d’un marché d’actions. Dans les faits la question se pose aujourd’hui à propos de la réforme chinoise, réforme complexe, mais dont une des directions possibles pourrait être celle d’un socialisme d’Etat lointain parent du modèle langien de planification concurrentielle.
Le modèle décentralisé
Au tournant des années 60, alors que le 20° Congrès du Parti communiste de l’URSS a ouvert les vannes de la critique du stalinisme et rouvert ainsi le champ de la discussion, un grand nombre d’économistes remettent en cause le modèle centraliste d’économie administrée, et se mettent à élaborer un autre modèle, que l’économiste polonais Wlodzimierz Bruz propose d’appeler “ décentralisé ”. L’ouvrage qu’il publie en 1960[15] est sans doute le plus représentatif de cet aggiornamento théorique, présenté par l’auteur lui-même comme la recherche d’un nouveau “ modèle ”, dans le même sens que celui que nous utilisons ici. Quels sont ses caractéristiques principales ?
Il s’agit cette fois d’une véritable combinaison du plan et du marché. Le plan garde toute son importance au niveau des grands choix collectifs (proportions entre accumulation et consommation et entre consommation individuelle et consommation collective, orientation des investissements par branches et au niveau géographique, structure de l’emploi et productivité du travail, volume et structure des échanges avec l’étranger). Mais il n’agit de manière directe que dans la mesure où il répartit un fonds national d’investissement. Sinon il agit de manière indirecte, à l’aide de ces leviers économiques que sont la politique des prix et des salaires, de l’impôt et du crédit, des tarifs douaniers et des devises. Le marché est rétabli pour tous les biens de production et pour le travail, mais c’est un marché réglementé du fait de ces actions et orientations données par le plan. Il n’y a pas de marché du capital, et en particulier par de circulation du capital entre les entreprises et entre les branches, même pas de marché du crédit à proprement parler, puisque qu’il est lui aussi réglementé. Les prix jouent à nouveau un rôle actif, mais ils sont contrôlés, au moins dans les cas où il y a des monopoles et où les préférences globales l’exigent (ce qui se fait, dans ce dernier cas, par la politique fiscale). Ainsi peut-on dire que l’on se sert de certains mécanismes de marché, mais que ce n’est plus la “ loi de la valeur ” qui commande le fonctionnement de l’économie : on peut obtenir de toutes autres proportions que celles qui résulteraient des forces spontanées du marché.
L’autre volet de ce modèle, qui en est la conséquence logique, est que les entreprises retrouvent une grande autonomie de gestion : elles prennent toutes les décisions qui ne sont pas directement dictées par le plan (la plupart des indices cessent d’être obligatoires), elles sont gérées selon le principe de la rentabilité, elles gardent une partie de leurs profits pour l’intéressement de leurs membres et pour leur autofinancement, versant l’autre au fonds central d’investissement. Cette grande autonomie rend possible une large participation des travailleurs à la gestion.
Quel sera le destin de ce modèle, qui connaît à l’époque bien des variantes, mais dont ce sont là les grandes lignes ?
Les projets de réforme qui furent mis en oeuvre en Union Soviétique vers le milieu des années 60 se limitèrent à des aménagements du système existant, destinés à rendre une certaine autonomie aux entreprises et à les sortir de leurs conflits paralysants avec une administration toute puissante. Le courant représenté par l’économiste Liberman avait préconisé une réduction du nombre d’indices imposés à celles-ci pour les ramener à deux : un indice de la valeur de la production vendue (et non plus de la production tout court) et un indice de rentabilité. La réforme de l’entreprise qui sera adoptée en 1965 n’ira pas aussi loin : elle ajoutera à ces deux indices six autres indices, ne laissant aux entreprises que la détermination de leur détail. L’objectif était de pousser l’entreprise à adopter un plan “ tendu ”, au lieu de se garder toutes sortes de marges de manœuvre, de l’inciter à faire des bénéfices et de motiver leurs membres en leur en laissant une part sous forme d’un “ fonds de stimulation ”. La réforme fut un échec d’abord pour des raisons politiques et sociales : le droit n’a pas suivi, et l’administration s’est empressée de récupérer dans les faits les pouvoirs perdus, quand elle n’a pas tout simplement saboté la réforme. Mais elle fut un échec pour des raisons plus profondes : que pouvait signifier la production vendue alors que les fournisseurs, les clients, les prix, restaient fixés administrativement, que le système de “ bons ” et de “ transferts ” était conservé ? Que pouvait signifier la rentabilité, quand le capital n’était pratiquement pas rémunéré (en dehors d’un intérêt très bas) ? Que pouvait signifier le fonds de stimulation alors que l’essentiel des bénéfices restait prélevé par l’Etat ? L’autonomie est ainsi restée largement contrainte et la rémunération des travailleurs indépendante des résultats.
C’est dans d’autres pays du bloc soviétique que, malgré le coup d’arrêt donné à des réformes audacieuses par la répression sanglante, en 1968, du nouveau cours politique en Tchécoslovaquie, le modèle décentralisé connut une certaine réalisation, et surtout en Hongrie, avec la mise en place, longuement préparée, du “ nouveau mécanisme économique ”. En Union soviétique il faudra attendre la perestroïka pour que le modèle soit largement repris par des conseillers de Gorbatchev. Je n’ai pas la place pour examiner les raisons du succès partiel et de l’échec final de ces réformes qui se voulaient de grande ampleur[16]. Disons, en deux mots, que le modèle ou bien a été introduit de façon incohérente (ce fut le cas en Union soviétique), ou bien n’a pas été mis en œuvre avec assez de détermination, ou encore a fait surgir des difficultés imprévues (ce fut le cas en Hongrie, où les “ marchandages ” avec l’administration économique et la “ concurrence administrative ” ont continué sous des formes nouvelles). En fait l’histoire a montré que, indépendamment des conditions sociales et politiques, qui ont pesé d’un grand poids, il était encore trop centraliste. L’histoire des réformes en Chine, pourtant conduites de façon plus cohérente et beaucoup mieux maîtrisée, le confirmera.
Mais on peut dire aussi que le modèle décentralisé fut l’annonciateur de la grande famille des modèles théoriques autogestionnaires, lesquels iront, comme nous le verrons, beaucoup plus loin dans la décentralisation et mettront en œuvre un principe de maximisation beaucoup plus radical : celui non de la maximisation du revenu du capital (d’Etat), mais de la maximisation des revenus du travail.
A cet égard on pourrait invoquer un quatrième modèle, précisément le modèle autogestionnaire, d’autant plus qu’il aurait un référent bien concret, le système yougoslave. Si je ne le fais pas, c’est que les auteurs les plus importants qui ont inspiré ou critiqué ce système (je pense notamment à Milovan Djilas et à Edvard Kardelj) n’ont pas produit, me semble-t-il, de véritable modèle, au sens retenu ici. La Yougoslavie fut sans aucun doute un modèle (au premier sens du terme) tout à fait passionnant, et qui a donné lieu à d’excellentes études, mais les modèles théoriques autogestionnaires se sont développées plutôt vers la fin de l’expérience elle-même et après son arrêt définitif. Il en sera donc question plus loin.
Avant de poursuivre, il nous faut faire le point sur les problèmes laissés pendants par le modèle centralisé et, dans une moindre mesure, par les deux autres modèles. C’est la résolution de ces problèmes qui va sous-tendre la recherche théorique de “ nouveaux modèles de socialisme ”.
Des problèmes d’efficience non résolus
Je commencerai pas exposer ces problèmes d’efficience, qui ont un caractère général. Mais l’efficience n’a d’intérêt qu’au regard des finalités du socialisme. Je donnerai plus loin un aperçu des interrogations à leur sujet.
Le premier problème mal résolu était celui de l’efficience allocative en ce qui concerne les biens de consommation, mais aussi les biens de production. Si un marché véritablement concurrentiel (ce qui n’est jamais le cas en économie capitaliste) peut en principe la résoudre pour les biens courants, l’efficience allocative des investissements est une autre affaire, car il s’agit de les sélectionner en fonction d’un futur toujours incertain (la prise en compte de l’incertitude est le point fort du keynésianisme par rapport au marxisme). La sélection se fait, en économie capitaliste, selon le critère de la maximisation du taux de profit (actuel et à venir) – et aujourd’hui selon la maximisation de la valeur actionnariale, telle qu’elle est estimée par les acteurs du marché financier. Or la planification intégrale a échoué, du moins pour les investissements de “ modernisation ”, parce qu’elle ne pouvait ni prendre toutes les décisions, devant de fait en laisser une partie aux entreprises, ni obtenir les bonnes informations, les entreprises n’ayant pas intérêt à les fournir, ni prévoir le futur (notamment le changements des goûts et des techniques). La planification “ concurrentielle ”, de son côté, en laissant les entreprises prendre entièrement leurs décisions (sauf en matière de prix), n’était pas en mesure de les éclairer sur l’avenir en jouant, au-delà d’un rôle de commissaire priseur, un rôle de coordination, faute, contrairement à ce que pensait Lange, d’une information suffisamment poussée. Quant au modèle décentralisé, il butait sur la difficulté des rapports entre l’administration économique et les entreprises, rapports à la fois de connivence et de conflit, voire de collusion-corruption autour de l’affectation directe d’une part du fonds d’investissement ou de l’utilisation des leviers économiques (taux d’intérêt, subventions, fiscalité, contrôle des prix etc.). C’est ici que la propriété d’Etat représentait un obstacle, dans la mesure où l’Etat jouait une multitude de rôles : celui d’un propriétaire soucieux de la rentabilité des fonds investis, mais aussi celui d’un régulateur des rapports sociaux, soucieux de ménager des intérêts divers, et peu disposé notamment à des restructurations, alors que l’actionnaire capitaliste n’a pas de tels soucis. D’où l’idée qu’il fallait confier la sélection des investissements des entreprises à d’autres instances publiques qu’à celle d’une administration économique, voire promouvoir d’autres formes de propriété sociale que celle de la propriété d’Etat. Chaque modèle proposera ici sa solution.
Le deuxième problème mal résolu était celui de la motivation des agents, de “ l’efficience motivationnelle ”. Il se posait à deux niveaux. D’abord à celui des dirigeants d’entreprise : comment faire en sorte que les dirigeants veillent à la fois à l’intérêt de leur mandant (en l’occurrence, s’agissant d’entreprises publiques, celui de l’Etat) et à celui des membres de l’entreprise, au lieu de poursuivre leur propre intérêt (problème que la théorie de “ l’agence ” pensait résolu par la surveillance exercée par le “ gouvernement d’entreprise ” exercé par les actionnaires – et ceci bien à tort, comme l’histoire récente du capitalisme actionnarial l’a montré) ? Ensuite au niveau de la collectivité de travail dans son ensemble : comment remobiliser les travailleurs ? En répliquant les méthodes capitalistes du type bâton/carotte, ou autrement ? Le modèle de planification intégrale avait échoué, parce que, le plan étant finalement imposé de l’extérieur et ne pouvant de ce fait être intériorisé par les travailleurs, seule restait la première méthode, et qu’elle était moins opérante dans un système qui était censé représenter ces derniers que dans le système capitaliste. Le modèle de planification concurrentielle n’avait pas de solution de rechange à proposer, puisqu’il présupposait que les managers seraient des fonctionnaires loyaux appliquant strictement les règles générales qui leur étaient imposées et que la distribution des dividendes sociaux serait faite par l’Etat, après prélèvement des bénéfices. Le modèle décentralisé allait plus loin : il préconisait qu’une large partie des profits revienne directement aux travailleurs des entreprises et pointait en direction d’une direction élue. Mais il n’allait peut-être pas assez loin pour que les travailleurs se sentent responsables et impliqués dans leur travail (“ intéressés ”, au sens où ils verraient “ le bout de leurs actes ”) et en recueillent suffisamment le fruit.
Le troisième problème mal résolu était celui de ce qu’on pourrait appeler l’efficience dynamique. On peut le décomposer en deux aspects distincts.
Le premier aspect réside dans la nature du processus d’information : il ne s’agit pas seulement de montrer qu’il y a des “ asymétries d’information ”, comme ce sera le leitmotive de la “ révolution informationnelle ” en économie (ceux qui détiennent plus d’information ont intérêt à la garder pour eux ou à la monnayer, où l’on retrouve le problème motivationnel), mais encore de souligner, après Hayek, que l’information a le plus souvent un caractère tacite, qui ne se révèle aux agents qu’à travers des processus d’apprentissage et de découverte. Le modèle de planification intégrale et le modèle de planification concurrentielle ignorent tout bonnement le problème, le modèle décentralisé n’y fait qu’allusion.
Le second aspect du problème est celui de l’esprit d’entreprise et de la recherche d’innovations. C’est sans doute le principal argument en faveur de la propriété privée et du capitalisme. Pourquoi monte-t-on une entreprise, pourquoi cherche-t-on à créer de nouveaux produits ou à améliorer les anciens (même si on le fait faire par d’autres, par exemple par des services de recherche-développement) ? Sans doute parce qu’on cherche à s’enrichir, mais aussi parce que le processus créatif est source d’un plaisir particulier, un plaisir plus durement conquis quand il se conjugue avec la responsabilité économique (à la différence de l’activité “ gratuite ” du bricoleur, par exemple, ou de celle du pur chercheur scientifique). Le modèle de planification intégrale n’apporte aucune réponse à ce problème, parce que les entreprises n’ont pas intérêt à prendre des risques et aussi parce que les novations dérangent les calculs et les routines de l’administration. Le modèle de planification concurrentielle ignore le problème : les managers y sont des sortes d’ingénieurs sociaux, axés sur la rentabilité immédiate. Le modèle décentralisé ne lui attache pas assez d’importance.
Retour sur les buts du socialisme
Ce bref retour sur les buts du socialisme s’impose pour signifier que l’efficience n’est pas un but en soi, qu’elle n’a de sens que relativement aux objectifs du socialisme. Ceux-ci paraissaient clairement définis par les classiques du marxisme : l’égalité dans la répartition (“ à chacun selon son travail ”), la maîtrise du développement (“ un plan concerté ”), une économie rationnelle (à la fois efficace et transparente, délivrée des fétichismes), un développement de l’individu intégral (grâce au dépérissement de la division du travail), la résorption de l’Etat (ou encore : de la spécialisation dans les fonctions administratives). Or il est apparu que ces buts étaient soit largement utopiques, soit plus ou moins contradictoires entre eux. Il se pourrait même que le socialisme se soit fourvoyé en poursuivant la disparition de contradictions indépassables, et que sa véritable finalité soit bien plutôt de rendre leur mouvement dialectique positif, au lieu que l’un des pôles en vienne à détruire l’autre[17]. Quoiqu’il en soit, chaque modèle de socialisme est conduit à proposer sa propre échelle de priorités parmi les valeurs du socialisme. Un mouvement général s’est pourtant fait jour : la démocratie était la pierre angulaire, ce qui permettait à la fois de promouvoir ces valeurs et de gagner en efficience. Mais quelle démocratie ?
Nous ne parlerons pas ici des problèmes politiques. Il faut cependant dire qu’ils sont intimement liés aux problèmes économiques. Pendant longtemps la gauche marxiste a cru que toutes les travers du système soviétique (le plus proche du modèle centralisé) disparaîtraient avec la démocratisation politique, soit sous une forme proche des démocraties occidentales, soit sous une forme spécifique (en particulier celle, illustrée par la révolution chinoise, d’une meilleure liaison du Parti avec “ les masses ”, voire d’une irruption de celles-ci dans le processus politique). On ne voyait pas que la planification “ intégrale ” entraînait nécessairement l’hypertrophie du pouvoir de la bureaucratie et, finalement, la toute puissance d’un parti-Etat. Inversement un modèle qui ferait une place trop grande aux forces du marché au détriment des choix collectifs ne peut qu’aboutir à une démocratie vidée de sa substance. La question posée aujourd’hui, de manière plus ou moins explicite, par les nouveaux modèles de socialisme, c’est de trouver une démocratie plus vivante, plus réelle, et forcément assez différente des démocraties libérales (impliquant notamment un autre équilibre des pouvoirs). Mais la démocratie politique ne peut progresser qu’à deux conditions : 1° que soit clairement défini ce qui relève des choix collectifs et ce qui relève des choix individuels. La divergence sera profonde à cet égard entre les modèles, et 2° qu’elle repose sur une démocratie économique et sociale. Ici encore il y aura toute un éventail de positions, entre la simple participation aux décisions et l’autogestion.
Il me reste à donner un aperçu des modèles contemporains, forcément très rapide (il faudrait au moins deux ou trois pages pour exposer l’essentiel de chaque modèle sans le dénaturer) et selon un classement quelque peu arbitraire (car la gamme est diverse, et plusieurs modèles pourraient être considérés comme mixtes)[18].
Les modèles de planification démocratique intégrale
Les auteurs de ce courant se proposent de rejeter le marché et de revenir à un système de planification intégrale, mais avec une double différence avec le modèle bureaucratique : c’est la démocratie économique qui décidera (de manière plus ou moins détaillée selon les modèles) de l’allocation des biens de consommation, des biens de production et du travail, de façon à réaliser les équilibres adéquats, et elle le fera à travers un calcul en unités physiques et en heures de travail, ou en coûts d’opportunité.
Ernest Mandel[19] a ainsi soutenu que, une fois les grandes proportions de l’économie décidées démocratiquement au niveau central, les biens de consommation pourraient être choisis et leur quantité déterminée par des conseils de consommateurs (décidant par exemple des modèles de chaussures) et par des conseils de producteurs (évaluant leurs coûts en travail), les uns et les autres confrontant, sans passage préalable par la monnaie et l’échange, leurs demandes et leurs offres, si bien que la production effective ne dépendrait plus de l’achat et de la vente (au reste tous les biens de base seraient distribués gratuitement). Le schéma permettrait de résoudre d’un coup tous les problèmes d’efficience. Il n’est, hélas, pas convaincant, car d’une part cette procédure démocratique serait d’une extrême lourdeur et représentait un coût social exorbitant, sans compter les conflits d’intérêts qu’elle pourrait engendrer, et d’autre part elle ne remplacerait pas bien le marché (c’est le plus souvent en faisant que l’on découvre des biens ou des possibilités productives, et non a priori ; les demandes minoritaires ne seraient jamais satisfaites).
Albert et Hahnel[20] ont proposé une procédure semblable à celle imaginée par Lange : un Bureau de Facilitation de l’Itération annoncerait des prix (des coûts d’opportunité) pour toutes les biens, ressources et types de travail, mais cette fois ce sont non des managers et des clients, mais des conseils de consommateurs et des conseils de travailleurs qui feraient leurs offres et leurs demandes, les révisant jusqu’à ce qu’elles soient acceptées par tous les partenaires et que le plan puisse ainsi les fixer avant production. Le but de cette démocratie participative est de mettre en évidence tous les aspects des biens que le marché dissimule (leurs effets externes, par exemple sur l’environnement ; les conditions sociales dans lesquelles ils ont été produits). Enfin la distribution se ferait en nature (droits à un panier de biens). Le projet répond bien au problème de l’efficience dynamique (en démocratisant le marché, en le socialisant, on accroît ses fonctions de coordination et de révélation), mais il se heurte à l’objection de la lourdeur et du coût du processus. En outre son efficience motivationnelle est douteuse, faute de concurrence et de liberté dans la formation des prix (ceux-ci sont fixés par le plan).
Enfin Cockshott et Cottrell[21] proposent un modèle d’économie “ à la Marx ”, c’est-à-dire reposant à la fois sur des valeurs-travail et sur la distribution de “ bons de travail ”. Le plan détermine les valeurs-travail des produits par ordinateur : les auteurs assurent que les gros ordinateurs actuels, capables d’effectuer 10 puissance 12 multiplications par seconde, permettent de calculer une liste de valeurs-travail quotidiennement et de préparer un plan prospectif chaque semaine. Des prix continuent à être utilisés par le plan (ainsi qu’un calcul de l’état des stocks), mais comme indicateurs des rapports offre/demande dans le court terme, permettant d’ajuster les valeurs-travail à plus long terme pour réaliser l’équilibre. C’est tout ce qu’il reste du tâtonnement langien. La décision démocratique n’intervient ici que pour les grandes allocations (accumulation, consommation personnelle, consommation collective), par exemple sous la forme d’un vote direct sur l’ampleur des dépenses de santé, ou sous la forme d’un choix entre des variantes pré-équilibrées du plan.
Le modèle est séduisant, mais il ne dit pas grand chose sur ce qui se passe dans les entreprises (tout comme le modèle néo-classique originel, pour lequel elle est une “ boite noire ”). Il prévoit un système de surveillance, de récompenses et de sanctions pour assurer qu’elles se conforment au plan. Ici encore l’efficience motivationnelle est problématique : les travailleurs ne peuvent mesurer le résultat de leurs efforts en jouant sur les coûts et les prix. L’efficience dynamique est négligée. Quant à l’efficience allocative, elle serait obtenue par l’application d’un principe de minimisation des coûts en travail. Mais celle-ci suppose des travailleurs parfaitement consciencieux, en l’absence d’un mécanisme de crédit avec intérêt, qui contraint à économiser les ressources et à choisir les investissements les plus efficaces et les moins coûteux. Or, si l’on réintroduit l’intérêt, c’est tout le système des valeurs-travail qui s’écroule, puisqu’il suppose que le capital argent ne soit pas rémunéré. Ce système n’est pas théoriquement impossible, mais il semble, de ce fait, pour longtemps hors de portée.
Les modèles fondés sur la rentabilité financière et la distribution égalitaire des profits
Les modèles précédents sont en fait profondément différents du modèle langien, car ils n’utilisent le marché que comme une procédure d’aide à la planification, alors que celui-ci simulait un marché concurrentiel, où chaque entreprise est gérée de manière à maximiser le taux de profit. Les modèles de socialisme de marché dont nous allons parler maintenant abandonnent la planification directe des prix et acceptent intégralement le marché concurrentiel. S’ils se réclament du socialisme, c’est sur trois points : 1° la forme privilégiée de la propriété ou bien reste la propriété d’Etat ou bien devient une propriété sociale (une propriété directe des citoyens) ; 2° l’objectif socialiste de l’égalité est atteint à travers une distribution relativement égalitaire des profits (où l’on retrouve le “ dividende ” social de Lange) ; une certaine planification incitative est nécessaire en ce qui concerne les investissements à long terme et pour la maîtrise des externalités.
Il n’est pas possible d’entrer dans le détail de ces modèles, d’autant plus que certains sont mixtes. On se contentera de donner une idée très sommaire des deux modèles qui ont fait référence dans le débat.
Pranab Bardhan[22] a proposé que les entreprises d’Etat soient constituées en sociétés par actions, chacune pouvant acquérir des actions d’une autre au sein d’un groupe lui-même lié à une banque, qui monte pour elles des consortiums de crédit. Chaque entreprise retire des dividendes des actions qu’elle possède et les distribue à ses travailleurs. Les profits de la banque reviennent en grande partie au gouvernement central, pour y alimenter la fourniture de biens publics, tels que l’éducation et la santé. Pourquoi cette structure institutionnelle, inspirée du capitalisme nippon ? Pour résoudre le problème de l’efficience motivationnelle, en assurant la surveillance des managers par des actionnaires publics, mais différents de l’Etat (les autres entreprises et la banque, dont des représentants siègent au conseil d’administration de l’entreprise), et celui de l’efficience allocative, par les biais du marché du crédit et de la maximisation de la rentabilité financière.
John Roemer[23] a proposé un autre système de propriété : tous les citoyens reçoivent des bons ou coupons, qu’ils convertissent ensuite en parts de fonds mutuels, lesquels achètent ou vendent des actions des entreprises (publiques) de leur choix, sur un marché financier qui fonctionne en coupons. Les actions ne servent pas à financer les entreprises – tout leur financement vient soit de l’autofinancement soit du crédit bancaire – mais à conférer à leurs détenteurs un droit sur les dividendes. Ce système diffère de la propriété capitaliste en ce que chaque citoyen possède le même nombre de bons et qu’il ne peut les vendre contre de la monnaie, ni les transmettre par héritage. Il peut en revanche échanger des parts d’un fonds mutuel, reconverties en coupons, contre des parts d’un autre fonds mutuel, en fonction de la performance de ces fonds, et donc des revenus qu’ils peuvent leur procurer. Ici encore il s’agit de résoudre le problème de l’efficacité motivationnelle (les managers sont surveillés par les fonds d’investissement et le cours des “ actions ” sert de signal aux banques pour l’attribution de crédits) et de l’efficacité allocative (par l’impératif de la rentabilité financière, mesurée par le montant des dividendes et le cours des actions).
Avec ces modèles nous nous trouvons devant un socialisme de marché au sens le plus fort du terme. La planification serait inutile, selon Roemer, si le marché ne comportait pas des externalités (des “ biens publics ”, tels que les effets diffus de la formation, et des “ maux publics ”, tels que la pollution) et s’il pouvait prévoir des prix futurs. Quand elle est nécessaire, elle prendra la forme d’une planification incitative, agissant par des leviers indirects, tels que les taux d’intérêt ou la fiscalité. Ces modèles se servent également de mécanismes capitalistes pour assurer l’efficience, puisqu’ils recourent à un marché financier, limité dans celui de Bardhan (il ne s’effectue qu’au sein des groupes d’entreprises), généralisé (mais ancré dans une monnaie très spécifique, celle des bons) dans celui de Roemer.
On se demandera d’abord si l’on n’est pas ainsi plus proches d’un “ capitalisme populaire ” que du socialisme (un capitalisme où l’actionnariat salarié n’occuperait plus un strapontin dans le “ gouvernement d’entreprise ”, mais toutes les places, via des médiations qui, du reste, représenteraient, comme dans le capitalisme, une forte ponction sur le revenu national). Si égalisation il y a, elle ne se situe qu’au niveau de la distribution : la répartition des pouvoirs, des fonctions et des tâches, des salaires (dans un marché du travail classique) – les rapports de production au sens strict de Marx – reste inchangée.
Dès lors c’est l’efficience elle-même qui peut être mise en doute. En admettant qu’il y ait une bonne incitation des managers, dûment surveillés par les conseils d’administration ou les fonds mutuels, ce ne sera pas le cas pour les autres salariés, qui restent à l’écart des décisions (les auteurs, qui pensent que l’autogestion est inefficace, n’admettent tout au plus qu’une “ participation ”). Le conflit management/personnel est à peu près inévitable, car ce dernier aura bien du mal à penser qu’il retrouve le fruit de ses efforts dans les dividendes qu’il retire du fonctionnement d’autres entreprises que les leurs ou de bons placés également ailleurs. L’efficience allocative sera par là même minée de l’intérieur, car on a toutes chances de retrouver les technologies sociales du capitalisme, dont l’efficacité est fort réduite. En imitant le capitalisme, on risque fort de ne pas faire mieux que lui. Quant à l’efficacité dynamique, elle restera ce qu’elle est dans le capitalisme, rien de plus, puisque le marché n’y est pas davantage coordonné ou socialisé.
Cela ne veut pas dire que ces modèles soient dénués d’intérêt. Même s’ils ne se sont pas concrétisés, le système des bons (il est vrai mis en œuvre de manière fort différente) n’ayant été qu’une vaste duperie en Russie et dans les pays de l’Est européen, et le modèle “ à la japonaise ” n’ayant pas fait école dans un pays socialiste, ils ne sont cependant pas tout à fait sans rapports avec ce qui se fait par exemple en Chine aujourd’hui, où les autorités ont voulu clarifier et revivifier la propriété étatique en transformant un grand nombre d’entreprises d’Etat en sociétés par actions, ouvertes à des capitaux privés. Mais, si le marché financier venait à y prendre de l’ampleur et si la participation des travailleurs était réduite à la portion congrue, on aurait plus affaire à un capitalisme social qu’au socialisme[24].
Les modèles autogestionnaires
Ce sont les plus nombreux, et il est encore moins possible de les présenter dans le détail[25]. Je me contenterai d’une sorte de classement, plus ou moins arbitraire.
Le point commun à tous les modèles est qu’ils reposent sur la démocratie d’entreprise et qu’ils ne visent plus (du moins principalement) la rentabilité du capital, mais la maximisation des revenus du travail. D’une certaine manière ils renouent avec la tradition coopérativiste du 19° siècle, et tournent ainsi le dos au socialisme étatique, mais ils peuvent se réclamer du socialisme dans la mesure où la planification démocratique y joue un rôle important et où, en général, ce sont des institutions publiques qui veillent, au moins en partie, à la répartition et à l’efficacité des investissements.
Du point de vue de l’efficience, le point fort des modèles autogestionnaires est l’efficacité motivationnelle : les travailleurs sont mobilisés parce qu’ils travaillent d’abord pour eux, décidant (sous certaines règles générales) de leurs salaires, de leurs conditions de travail, de la durée effective de leur travail, et parce qu’ils voient l’utilité sociale de leur travail, à l’aide des signaux du marché, mais aussi grâce à d’autres procédures. Ce sont eux également qui surveillent les dirigeants qu’ils ont élus – pourvu qu’ils soient dotés d’un certain nombre de capacités pour le faire. Le principe “ un homme, une voix ” est non seulement un facteur de dignité, mais aussi un frein aux comportements rivalitaires et au chacun pour soi (thématisé dans le personnage du free rider des économistes anglo-saxons), en même temps qu’un puissant stimulant à la coopération.
Mais l’efficacité dynamique est aussi la grande supériorité de ces modèles : ils favorisent l’esprit entrepreneurial, malgré certaines limites, ils sont propices à l’innovation, qui profite à toute la collectivité de travail, et, dans la mesure où les entreprises y sont des sujets marchands, ils exploitent les possibilités d’information et de révélation fournies par le marché. Mais, plus intéressant encore, il devient possible de surmonter au moins en partie les effets d’opacité, de mauvaise diffusion et de rétention liés au marché concurrentiel et de rétablir des liens de coopération avec les autres entreprises de la branche et avec les consommateurs, voire avec d’autres acteurs. A cet égard ce sont les modèles proposés par Diane Elson et Pat Devine qui vont le plus loin. On les évoquera brièvement, sans entrer dans l’ensemble de la configuration institutionnelle proposée.
Dans le modèle de Diane Elson[26] des commissions (publiques) des prix servent d’abord à faire circuler l’information détenue par les entreprises (publiques) sur leurs méthodes de production, sur leurs coûts et leurs marges, par l’intermédiaire de réseaux publics d’information auxquelles elles sont obligatoirement affiliées. Cela rend possible une coordination entre les entreprises, et aussi une information du consommateur. Elles peuvent, à partir de là, définir des normes de prix, qui ne sont plus des normes imposées, mais des normes négociées de référence, souffrant des exceptions qui doivent être justifiées. Point de planification a priori donc, mais une régulation en évolution constante. Des commissions des salaires font de même en ce qui concerne les offres et les demandes d’emplois, avec leurs diverses caractéristiques. Enfin des associations de consommateurs informent les consommateurs non seulement de la qualité des produits, mais encore des conditions sociales dans lesquelles ils ont été produits et de leurs effets sur l’environnement (un peu comme le “ commerce équitable ” tente aujourd’hui de le faire). Il s’agit donc pas de réduire le marché à un rôle accessoire d’indicateur, comme dans les modèles de planification intégrale, mais de le “ socialiser ”.
Ces propositions sont du plus haut intérêt, mais ne semblent pas en mesure d’assurer l’efficacité allocative et toute l’efficacité motivationnelle. C’est en effet un Bureau de contrôle des entreprises publiques qui assurerait l’allocation du capital public (porteur d’intérêt), quand l’autofinancement ne suffit pas. Or il semble difficile d’éviter les phénomènes de connivence et de collusion qui ont caractérisé, dans le modèle soviétique, mais aussi dans le modèle décentralisé, les rapports entre l’administration économique et les entreprises, ainsi que les biais d’information venant d’entreprises soucieuses de se ménager les plus grands apports en capital. Le modèle prévoit un corps d’inspecteurs et diverses autres mesures pour éviter ces distorsions dans l’allocation, mais ce genre de contrôles est difficile à opérer et suppose des fonctionnaires particulièrement intègres.
Le modèle de Pat Devine[27] vise à résoudre de telles difficultés en introduisant des représentants des consommateurs, mais aussi des fournisseurs, des autorités locales et des organismes du plan dans les conseils de gestion des entreprises. Non seulement la circulation de l’information se fait ainsi de façon plus directe, mais les contrôles deviennent en quelque sorte internes, au lieu de s’effectuer de façon externe. Quant au Plan, il ne s’élabore ni a priori, ni a posteriori (via des incitations indirectes), mais par une procédure de “ coordination négociée ” à plusieurs niveaux, jusqu’à l’échelon central (les grandes décisions restant cependant du ressort d’une Assemblée parlementaire). L’information fournie par le marché sur la profitabilité des entreprises est utilisée de façon coopérative pour décider de la structure des investissements. Les prix sont axés sur les coûts à long terme, fondés sur le coût du travail, le coût des inputs et une taxe gouvernementale sur le capital décidée centralement.
Le modèle entend ainsi assurer l’efficience allocative (les capitaux vont là où ils sont les plus utiles), l’efficience motivationnelle (grâce à l’autogestion et à la surveillance directe du management au sein des conseils élargis) et l’efficience dynamique (grâce à la coordination négociée). Ce modèle, idéal en ce qui concerne cette dernière forme d’efficience, se heurte cependant à des objections de faisabilité : risques de conflits de pouvoir au sein des conseils de gestion (tels qu’on peut les observer par exemple aujourd’hui dans les mutuelles et coopératives de consommation), extrême lourdeur des procédures, dont le coût social serait élevé.
En fait la grande difficulté des modèles autogestionnaires, avec planification démocratique, se situe ni au niveau de l’efficience motivationnelle, ni à celui de l’efficience dynamique (grandement accrue par rapport au capitalisme, grâce à la socialisation du marché, qui réduit fortement le caractère fétichiste de la marchandise), car les coûts et les lenteurs de la démocratie d’entreprise, ou encore la tendance à assurer plus la stabilité de l’emploi que sa mobilité, sont largement compensés par les avantages. Elle se situe au niveau de l’allocation du capital. Tous les auteurs, ayant pris en compte les obstacles, internes et externes, rencontrés par les coopératives dans leur financement (dont l’obstacle de la répugnance des associés à y risquer leur capital), ont cherché des solutions dans deux voies : un marché des titres de propriété et un marché du crédit.
Pour se procurer des moyens de financement sans faire appel aux deniers publics, les entreprises autogérées pourraient soit instituer un marché des droits d’association (les coopérateurs peuvent vendre et acheter des droits d’entrée, mais uniquement auprès d’autres coopérateurs) – c’est la solution préconisée par Dow et Sertel[28] -, soit faire appel à des apporteurs extérieurs, mais en leur retirant le droit de vote – c’est l’une des sources de financement retenues par Weisskopf[29] – soit encore permettre à leurs membres de prendre des risques en capital dans l’entreprise avec des garanties procurées par le gouvernement – c’est la voie proposée par Bowles et Gintis[30]. On ne peut entrer ici dans le détail de ces modèles, mais les problèmes qu’ils posent est d’une part qu’ils restent axés sur la rentabilité financière, comme dans le capitalisme, et qu’ils engendrent nécessairement de ce fait un conflit chez les travailleurs eux-mêmes entre le désir d’accroître les revenus de leur capital et celui d’améliorer leurs salaires (où l’on retrouve cette schizophrénie propre à toutes les formes de capitalisme populaire), d’autre part qu’ils tendent à accroître les inégalités aussi bien entre les travailleurs d’une même entreprise qu’entre ceux des entreprises en concurrence, celles mieux dotées en capital se trouvant en meilleure position.
C’est pourquoi une seconde catégorie de modèles axe le financement sur le crédit. Une formule peut résumer l’esprit de ces modèles : c’est désormais non le capital qui loue le travail, mais le travail qui loue le capital, en payant une taxe ou un intérêt. La différence est grande avec les autres modèles. D’une part, il n’y a plus de marché financier, même sous des conditions restrictives. D’autre part les travailleurs peuvent se guider sur un seul principe : maximiser le revenu de leur travail, après avoir acquitté un droit prédéterminé, quelle qu’en soit la forme, sur le capital, au lieu d’un rendement variable. C’est dans ce sens que vont les modèles de Schweickart[31], de Devine[32], de Fleurbaey[33] ou d’Andréani[34]. L’autofinancement des entreprises y est supprimé (ce qui bloque les possibilités d’accumulation privée du capital), les crédits y sont distribués par des banques publiques ou des banques autogérées, qui réalisent la socialisation de l’investissement et la surveillance des entreprises, une articulation au plan se faisant de diverses manières.
Pour conclure
Cette brève histoire des modèles de socialisme voulait montrer qu’ils ont un long passé, que les principales orientations étaient déjà amorcées pendant la longue période du “ socialisme réel ”, que les recherches ne se sont nullement arrêtées avec l’écroulement du système soviétique, et qu’elles manifestent une réelle progression, en tirant les leçons de l’histoire et en exploitant des acquis de la théorie économique, y compris sous sa forme dominante, pro-capitaliste (il y a des choses à retenir du modèle néo-classique en ce qui concerne les problèmes d’allocation, des choses à retenir de l’école autrichienne, et particulièrement de Hayek, en ce qui concerne l’efficience dynamique, et des choses à retenir de la théorie informationnelle en ce qui concerne l’efficacité motivationnelle). Les modèles actuels, dans leur diversité et leur hétérogénéité, ont fait avancer la cause théorique du socialisme, en matière d’économie, sans parler du vaste continent des études politiques et philosophiques. Mais ils n’offrent évidemment aucune solution clef en mains à ce qui pourrait être le grand défi de ce siècle. Il faut les considérer bien plutôt comme des “ outils de pensée ”[35] et comme des “ grilles de lecture ”, permettant de mieux comprendre et analyser ce qui se passe dans les pays encore socialistes, dans les quelques voies alternatives que l’on peut repérer dans les pays capitalistes, et de mettre en chantier enfin les solutions concrètes qu’il est possible de dégager aujourd’hui, dans un contexte rendu plus difficile par la grande ouverture des économies (la principale limite des modèles est, actuellement, qu’ils sont conçus, pour des raisons méthodologiques, en économie fermée, n’offrant que de faibles indications sur la connexion ou déconnexion partielle avec le marché mondial).
Si l’on devait retenir quelques grandes orientations de la lecture des modèles, on pourrait peut-être dire qu’elle seraient les suivantes : une démocratie politique à la fois plus représentative (l’exécutif étant replacé sous le contrôle des parlements) et plus directe (usage – contrôlé – des procédures référendaires et “ participatives ”), en charge des choix collectifs et décidant des biens sociaux (ceux qui sont produits par des services publics, dont il n’a pas été question ici, mais qui sont au fondement de la citoyenneté politique, de la citoyenneté sociale et de la citoyenneté économique) ; des formes de propriété sociale, qui seraient probablement multiples, sans exclure l’existence de petites entreprises privées, ni même d’un secteur capitaliste, dont la reproduction élargie serait cependant bloquée par diverses mesures juridiques concernant la transmission des biens ; des échange de biens et de services contrôlés à travers la socialisation et la réglementation du marché ; un marché des emplois lui aussi socialisé et réglementé, mais de manière à lui laisser une certaine souplesse ; une planification qui serait pour une part programmatique (dans le cas des services publics) et pour la plus grande partie incitative (on a vu que, si tous les modèles font une place au marché, ceux qui le réduisent à une fonction de signalisation sont aujourd’hui probablement irréalistes) ; un système de financement plus ou moins décentralisé, qui ne soit plus sous la coupe directe de l’Etat (c’est ici qu’il y a une vraie divergence entre les modèles qui admettent un marché des titres de propriété et ceux qui le rejettent, entre ceux qui trouvent leur principe d’efficience dans la rentabilité financière et ceux qui le trouvent dans la maximisation des revenus du travail) ; un engagement des consommateurs, soit par le biais d’associations sans doute soutenues par l’Etat, soit sous forme d’une participation à la gestion des entreprises ; la restauration d’un espace public, où puissent se mener les grands débats de société et s’élaborer un nouveau type de civilisation.
Notes de bas de page
- C’est ici qu’une modélisation mathématique peut avoir son utilité : bien définir le choix des variables, s’assurer de la solidité des inférences, éventuellement découvrir des difficultés ou des propriétés insoupçonnées. ↑
- Notons également que la France n’a pas produit de système social original, pouvant servir de “ modèle ” (au premier sens du terme) de capitalisme : le “ New Deal ” est venu des Etats Unis, la Suède a inventé l’Etat social, la Grande Bretagne a été le plus loin dans les nationalisations, les Allemands ont produit le modèle social “ rhénan ”. On peut se demander si notre meilleure innovation n’a pas été la “ planification à la française ”, sous l’égide du Commissariat général au Plan… ↑
- Alec Nove, The Economics of Feasible Socialism, Allen &Unwin, 1983, publié sous le titre Le socialisme sans Marx, L’économie du Socialisme réalisable, Economica, Paris, 1983. ↑
- D’autres formes de propriété sont également prévues : contrats avec l’Etat aux termes desquels le propriétaire lui verse une part de sa production, sociétés d’économie mixte. En fait seuls l’affermage et les concessions connurent un certain développement. L’affermage permettait à d’anciens propriétaires de revenir diriger leur entreprise, en payant un loyer et avec l’obligation de maintenir en état le capital. Mais il fut en même temps pénalisé de diverses manières, et fut supprimé en 1930. Les concessions, accordées exclusivement à des entreprises étrangères, restèrent très limitées et disparurent progressivement (sur les 144 accordées pendant la période de la NEP il n’en restera plus que 11 en 1936). ↑
- Par exemple, lorsque Trotsky dit, dans un discours prononcé en 1922 (“ Rapport sur la nouvelle perspective économique et les perspectives de la révolution ”), que, avec la NEP, “ c’est le marché qui certifie la rentabilité d’une ligne pour l’économie, parce que nous n’avons pas élaboré les méthodes de calcul statistique d’une économie socialiste ” (discours repris dans Le débat soviétique sur la loi de la valeur, Editions François Maspéro, Paris, 1972, p. 63). C’est dix ans plus tard que Trotsky considérera que les besoins doivent s’exprimer non seulement à travers la mesure statistique des commissions du plan, mais encore à travers les forces directes de l’offre et de la demande. ↑
- Lapidus et Ostrovitianov, In “ Du régulateur de l’économie soviétique ”, chapitre 8 du Précis d’économie politique, Moscou, 1927. Texte repris dans Le débat soviétique sur la loi de la valeur, op. cit., p. 243. ↑
- Ibidem, p. 247. ↑
- L’activité industrielle, qui était tombée en 1920 à un indice 13,8 par rapport à une base 100 en 1913, atteint en 1925 l’indice 73. (cf Marie Lavigne, Les économies socialistes, soviétique et européennes, Armand Colin, Paris, 1970, p. 31). La production agricole dépassa en 1927 de 21% son niveau d’avant guerre ( cf ibidem, p. 36). ↑
- Il y a bien, cependant, un groupe d’économistes qui pensent que la combinaison du plan et du marché n’est pas transitoire, mais au coeur du socialisme (dont, semble-t-il, Kondratieff), mais il reste marginal. ↑
- C’est dans ce sens qu’allaient les programmes des partis socialistes avant la Révolution d’Octobre et le communisme de guerre des années 1917-1920. ↑
- Dans le long terme, explique-t-il, les coûts pourraient être réduits aux coûts en travail si l’accumulation du capital était telle que la productivité marginale nette du capital soit égale à zéro, l’intérêt devenant ainsi inutile (Cf On the Economic Theory of Socialism, The University of Minnesota Press, 2° edition 1948, p. 133). ↑
- Dans le court terme, où la quantité de capital est considérée comme constante, le système bancaire public se contente d’ajuster le taux d’intérêt pour équilibrer ce montant avec la demande de capital. ↑
- En particulier Maurice Dobb (On Economic Theory and Socialism, Routledge and Kegan, Londres, 1955), Paul Baran et Paul Sweezy, et Charles Bettelheim. ↑
- Lange avait cependant en vue son application concrète. C’est ainsi qu’il expose, à la fin de son texte, comment pourrait s’effectuer la transition vers le nouveau système (laquelle demanderait du “ courage politique ”) et pourquoi des formes de propriété privée pourraient être conservées et garanties pendant cette transition. ↑
- Traduit et publié en français en 1968 : Problèmes généraux du fonctionnement de l’économie socialiste, Editions François Maspéro, Paris. ↑
- Je m’y suis essayé dans Le socialisme est (à) venir, tome 1, L’inventaire, Editions Syllepse, Paris, 2001, 3° Partie, chapitre 3, § sur “ le laboratoire hongrois ” et § sur l’échec de la perestroïka. ↑
- C’est la thèse que je soutiens dans Le socialisme est (à) venir, tome 1, L’inventaire, op. cit., pp. 105-136, et pp. 233-239 ↑
- Le lecteur ne trouvera que très peu de références en langue française. En dehors de celles qui sont indiquées ci-dessous, il pourra consulter un certain nombre de documents de travail de Tony Andréani, Thomas Coutrot, Michel Husson, Martinu Nieddu, Joël Martine, Michel Lasserre, Catherine Samary etc. sur le site du Groupe d’études “ Un socialisme pour demain ” : http:/hussonet.free.fr ↑
- Ernest Mandel, “ In Defense of Socialist Planning ”, in New Left Review, n° 159, Octobre 1986. De larges extraits de ce texte ont été reproduits en français in Actuel Marx, n° 3, 1° semestre 1988, suivis d’une critique par Alec Nove. ↑
- Cf “ In Defense of Participatory Economics ”, in Science § Society, vol. 66, n°1, Printemps 2002, p. 7-21. ↑
- Paul Cockshott et Allin Cottrell, Towards a New Socialism, Nottingham, 1993. ↑
- Pranab K.Bardhan, “ On Tackling the Soft Budget Constraint in Market Socialism ”, in Market Socialism, The Current Debate, edited par Pranab K. Bardhan and John E. Roemer, Oxford University Press, New York, 1993, p. 145 sq. Cet ouvrage collectif, qui contient 18 contributions, est devenu une référence. ↑
- John Roemer, “ Can There Be Socialism after Communism ”, in Market Socialism, op. cit., p. 89 sq. Article traduit et reproduit in Actuel Marx, n° 14, 2° semestre 1993, dossier Nouveaux modèles de socialisme. Le modèle est repris, à un niveau plus abstrait, dans l’ouvrage de l’auteur A Future for Socialism, Harvard University Press, 1994. ↑
- C’est la question centrale que pose “ l’économie socialiste de marché ” en Chine. Je l’ai évoquée dans un chapitre de Le socialisme est (à) venir, tome 1, L’inventaire, op. cit., p. 221-225, et dans mon introduction à l’ouvrage collectif à paraître Socialisme, autonomie, marché. La croisée des chemins, Editions Le temps des cerises, 2003. ↑
- Le lecteur trouvera une présentation rapide des modèles de Weisskopf, Schweickart, Fleurbaey et Andréani dans mon article “ Le socialisme de marché : problèmes et modélisations ”, du Dictionnaire Marx contemporain, PUF, Paris, 2001. L’ouvrage collectif Markets and Democracy : Participation, Accountability and Efficiency, dirigé par Samuel Bowles, Herbert Gintis et Bo Gustafsson (Cambridge University Press, 1993) offre un vaste recueil d’articles, souvent techniques, sur les problèmes économiques de l’autogestion. ↑
- Diane Elson, “ Market Socialism or Socialization of the Market ? ” in New Left Review, nov-décembre 1988, pp. 3-44. Article repris en partie dans Actuel Marx, n°14, 2° semestre 1993. ↑
- Pat Devine, Democracy and Economic Planning, Polity Press, Oxford, 1998. Cf aussi son article “ Participatory Planning Through Negociated Coordination ”, in Science & Society, repris dans Socialisme, autonomie, marché, La croisée des chemins, op. cit. ↑
- Cf Murat Sertel ed. Workers and Incentives, Amsterdam : North Holland, 1982 ; Gergory K. Dow, “ Democracy versus appropriability : can labour-managed firms flourish in a capitalist word ? ”, in Bowles, Gintis et Gustafsson, Markets and Democracy : Participation, Accountability and Efficiency, op. cit., chapitre 11. ↑
- Cf “ A Democratic Entreprise-Based Market Socialism ”, in Market socialism, The current debate, op. cit., p. 120 sqq. Weisskopf propose de combiner le crédit, l’émission d’actions sans droit de vote, l’investissement des coopérateurs sous forme d’actions (mais également sans droit de vote) avec le système de bons de Roemer. ↑
- Cf “ Reconsiderations ” in Recasting Egalitarianism, New Rules for Communities, States and Markets, dir. Samuel Bowles and Herbert Gintis, edited by Erik Olin Wright, Verso, London-NewYork, 1998. Ces garanties concernent un système d’assurances sociales amélioré et des mesures ouvrant à tous un accès au crédit bancaire et permettant ainsi à chacun d’emprunter l’argent nécessaire à l’achat de parts sociales. Pour élargir les sources de financement, leur modèle prévoit également l’apport de capitaux extérieurs, mais sans droit de vote. ↑
- David Schweickart, Against Capitalism, Cambridge University Press, 1993. Le lecteur pourra trouver des exposés succincts du modèle dans “ Economic Democracy : a Worthy Socialism That Would Really Work, in Science and Society, trad. Française in Actuel Marx, n°14, op. cit., p. 69-87. ↑
- Pat Devine, Democracy and Economic Planning, op. cit. ↑
- Marc Fleurbaey, “ Economic Democracy and Equality : A proposal ”, in Market Socialism, The Current debate, op. cit. ↑
- Tony Andréani, in Tony Andréani et Marc Féray, chap. 9 du Discours sur l’égalité parmi les hommes, Penser l’alternative, L’Harmattan, 1993, in divers articles et in Le socialisme est (à)venir. Tome 2, Les possibles, à paraître aux Editions Syllepse. ↑
- Pour reprendre l’expression de Martinu Nieddu dans “ Socialisme et société de changement technologique rapide ”, in T. Andréani, dir., Socialisme, autonomie, marché. La croisée des chemins, op. cit. ↑