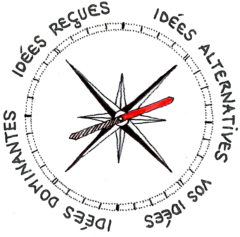Propositions de Tony Andréani
Extrait du chapitre « Les principes directeurs d’un nouveau socialisme », dans le livre « Le socialisme est (a)venir, Tome 1, L’inventaire », Syllepse, 2001.
Une planification programmatique et incitative
Une planification impérative et détaillée correspond à une tâche techniquement insurmontable et socialement porteuse d’effets pervers. L’étude du système soviétique nous en a fourni la preuve. Mais d’autres formes de planification sont nécessaires d’une part pour remédier aux insuffisances des mécanismes marchands, d’autre part et surtout pour fournir aux choix collectifs une instance d’élaboration et des moyens d’effectuation. Ces choix correspondent à de grandes orientations (s’agissant par exemple du temps de travail, du rapport consommation/ épargne) et à toute une série de politiques publiques (des revenus, de la protection sociale, de l’environnement, du logement etc.).
Dans un modèle purement marchand les sujets ne se parlent pas et ignorent les conséquences de leur choix. Dans un modèle purement planificateur, mais démocratique, ils échangent des informations et des idées, ils débattent de possibilités alternatives, et ils prévoient les effets de toutes les décisions qu’ils pourraient prendre. Mais un tel modèle pur est irréalisable. Le socialisme, on a vu pour quelles raisons, ne pourra se passer de rapports offre/demande. Le socialisme devra donc combiner planification et rapports d’échange, ce qui n’a rien d’inconcevable, puisque diverses formes de combinaison ont déjà existé : lois de programme, contrats de plan, planification incitative etc., et ceci de manière à articuler prévisions et contrôle a priori d’une part et ajustements a posteriori d’autre part.
C’est ici que les expériences hongroise, yougoslave et chinoise, de planification indirecte, à l’aide de “leviers économiques ”, sont particulièrement instructives. J’y reviendrai dans le volume suivant, mais, en bref, la première montre que, faute d’une autonomie suffisante des entreprises (avec ses corollaires), le guidage économique est faussé par un “ marchandage autour des régulateurs ”, la seconde montre que le quasi-abandon du plan fait dériver l’économie vers des inégalités qu’on ne peut plus maîtriser, et que la troisième semble parvenir à une combinaison plus efficace du plan et du marché, qui, cependant, n’empêche pas pour le moment une dérive inégalitaire. Ces trois expériences historiques ne sont pas parvenues non plus à clairement distinguer une sphère non marchande ou faiblement marchande d’une sphère marchande, parce qu’elles partaient du modèle soviétique, où cette distinction n’existait pas.
Or la planification ne sera pas de même nature selon qu’elle porte sur des « biens sociaux » ou sur des « biens privés ” (cf infra). Dans le premier cas je préfère parler de planification programmatique que de planification impérative, car il faut laisser aux services publics (administrations mises à part) une certaine autonomie de gestion. Dans le deuxième cas la planification devrait être seulement incitative, pour que les entreprises puissent disposer de leurs propres critères d’efficience. C’est cette planification incitative qui visera l’efficience sociale (en matière d’emploi, de “ coûts sociaux ”, d’aménagement du territoire etc.) et poussera les entreprises à s’y conformer.
Cette planification ne devra pas être confondue avec la politique économique, qui poursuit des objectifs de régulation macro-économique (cf infra).
Mais il faudra aussi que la planification ne soit pas une tâche trop lourde et trop complexe, car elle serait alors trop longue pour tenir compte des changements et des innovation, trop coûteuse en temps et en moyens techniques, trop soumise à des interférences de toutes sortes. C’est ce qui me conduira à critiquer des modèles de socialisme sans doute trop ambitieux.
La maximisation des revenus du travail
Un principe fondamental du socialisme sera, selon moi, la maximisation des revenus du travail.
Cela veut dire tout d’abord que la valeur produite sera distribuée principalement sous forme de revenus, et non sous forme de dotations en nature, sauf, dans une certaine mesure, pour les biens sociaux les plus fondamentaux, qui seront gratuits ou faiblement payants (cf plus loin).
Cela veut dire ensuite que la finalité du système économique est à l’inverse de celle du capitalisme, qui repose sur la maximisation des revenus du capital (argent). Plusieurs modèles de socialisme, on le verra, conservent cet objectif du capitalisme, dans un souci d’efficience, mais se proposent de modifier la distribution du profit, dans un souci d’équité. Je montrerai qu’ils s’enferment ainsi dans la logique du capitalisme. Maximiser les revenus du travail ne réduit pas, sous certaines conditions, l’efficience, bien au contraire.
Le capital-argent continuera en effet à être rémunéré pour les raisons que j’ai déjà évoquées. Une telle rémunération contraint les producteurs à faire un usage économe des biens capitaux et à se préoccuper du coût d’opportunité des investissements (choisir, parmi plusieurs usages alternatifs, celui qui est le plus efficace). Sur ce point central les modèles théoriques sont, on le verra, divergents. Certains acceptent l’existence de capitaux propres, qu’ils viennent de l’Etat, des coopérateurs, ou de particuliers (mais sans que ces derniers aient un pouvoir direct sur la gestion, ce qui serait contraire à l’autogestion), ce qui peut aller jusqu’à admettre aussi l’existence d’un marché financier, plus ou moins circonscrit. D’autres reposent sur un financement uniquement par le crédit ou un système équivalent. J’expliquerai pourquoi cette seconde voie me paraît préférable. Mais il faudra dissocier, dans les deux cas, le pouvoir des apporteurs extérieurs de capitaux de prêt (bureaux administratifs ou de banques, selon les modèles) du pouvoir de gestion, si l’on veut que l’autogestion reste effective.
L’existence d’une rémunération du capital a une conséquence extrêmement importante : les prix s’écartent nécessairement des valeurs-travail, non seulement dans le court terme, mais encore dans le long terme. Du coup c’est la possibilité d’une comptabilité en quanta de travail – la plus proche de l’information parfaite rêvée par les économistes – qui s’évanouit. L’efficience joue contre la rationalité. Mais il est possible, on le verra, d’éclairer aux yeux de tous les processus de formation des prix.
Le système soviétique reposait, en fait, sur une maximisation du capital d’Etat, sur une ponction des profits à des fins de redistribution entre les entreprises, mais aussi sur une maximisation des revenus de ce capital (une “ plus-value sociale ”) destinée à entretenir la bureaucratie de l’Etat et celle du Parti. Cet aspect capitaliste était néanmoins modéré par un système salarial plutôt égalitaire, qui limitait la ponction de ces revenus. Les socialismes historiques de marché vont davantage dans le sens d’une maximisation des revenus du travail. C’était clairement le cas en Yougoslavie, mais avec ce revers propre à l’autogestion fondée sur l’usufruit de la propriété sociale : l’autofinancement crée de grandes disparités entre les entreprises, qui ont un effet cumulatif. Dans le cas hongrois on avait affaire à une sorte de compromis entre les deux principes de maximisation : le “ marchandage autour des régulateurs ” (qui allait, on l’a vu, jusqu’au cas par cas) permettait des pressions dans les deux sens, en faveur des entreprises et de leur autofinancement, ou en faveur de l’Etat via les intérêts versés et l’impôt. Et ce compromis avait des effets pervers, notamment une “ contrainte molle ”. La leçon du socialisme de marché à la chinoise est plus incertaine : il semble qu’il vise à accroître la propriété de l’Etat, via l’autofinancement, mais que la ponction sur les profits soit remplacée par l’impôt et que le prélèvement des intérêts ne soit pas destiné à être négociable entreprise par entreprise. Mais, dans les trois cas, bien qu’il s’agisse d’économies financées surtout par le crédit, laisse ouverte la possibilité d’une accumulation de type capitaliste. Aussi ce problème revêt-il une importance cruciale. J’exposerai dans le volume suivant toutes les raisons qui militent en faveur d’une interdiction de l’autofinancement.
L’expérience des socialismes historiques de marché plaide enfin en faveur d’un système financier dont les fonctions soient clairement différenciées, et qui comporte des banques concurrentes (publiques ou autogérées). Cela permet aux entreprises de diversifier leurs sources de crédit, donc de ne pas être dépendantes d’un monopole. Par ailleurs j’ai souligné les risques d’un recours au marché financier : s’il permet une mobilité du capital, il donne un pouvoir au capital financier qui enclenche la logique de la rentabilité financière et tend à lui soumettre toute l’économie, surtout si le marché du capital est libéralisé et ouvert sur l’extérieur. C’est là que tout menace de basculer, si on ne parvient à le contenir et si on ne trouve pas d’autres solutions.
L’encadrement du marché des emplois
Le socialisme ne pourra se passer d’un marché de l’emploi. Pour deux raisons essentielles. La première est qu’il permet des ajustements entre l’offre et la demande de travail qu’une planification peut infléchir, mais qu’elle ne peut commander a priori. La deuxième est que les travailleurs doivent être libres de choisir leur emploi, d’en changer, d’améliorer ou de modifier leur formation. Le socialisme n’est pas un régime de caserne.
Mais ce marché de l’emploi sera encadré. Le socialisme ne peut abandonner les rémunérations du travail entièrement au jeu du marché, de manière à limiter les inégalités que celui-ci peut engendrer. Diverses procédures ont été proposées dans plusieurs modèles théoriques de socialisme (depuis une grille générale, négociée centralement jusqu’à de simples correctifs légaux). Je les examinerai ultérieurement. Il doit, en second lieu, assurer du travail pour tous, c’est-à-dire ramener le chômage vers un chômage » frictionnel » (ou de mobilité) et l’indemniser. Je montrerai que certaines tendances spontanées d’une économie socialiste (notamment le fait que les travailleurs d’entreprises autogérées peuvent faire des arbitrages entre l’augmentation de leurs revenus ou l’amélioration de leurs conditions de travail et un gain de temps libre) tendraient à résorber le chômage, mais la politique économique (cf infra) devra aussi y veiller. En outre le socialisme devrait disposer de moyens pour ajuster a posteriori la demande et l’offre d’emplois et faciliter les reconversions, s’inspirant notamment de certaines institutions des pays capitalistes qui ont donné de bons résultats.
L’expérience des socialismes historiques de marché est ici plutôt négative : on n’est sorti des échelles “ politiques ” de rémunérations que pour lâcher la bride aux entreprises et au marché.
Des consommateurs impliqués et mobilisés
Les consommateurs du système capitaliste n’ont d’autre pouvoir que leur vote monétaire, toute la régulation publique revenant à l’Etat. Et ils ne savent à peu près rien des « effets externes » de leurs achats sur l’emploi, les conditions de travail, l’environnement etc. Dans une société socialiste ils devraient disposer de cette information et pouvoir peser sur la conception et même sur le prix des produits.
Dans certains modèles théoriques de socialisme les consommateurs interviendraient directement dans la gestion des entreprises en ayant des représentants dans les conseils de direction et dans les différentes instances de la planification. J’expliquerai pourquoi je ne pense pas qu’on puisse aller très loin dans cette voie, pour des raisons de faisabilité et de démocratie (représentativité des représentants, prise en compte des demandes minoritaires). En revanche des associations de consommateurs, financées par l’impôt, mais indépendantes du pouvoir politique, pourraient jouer un grand rôle dans la formation de l’opinion, dans la coopération avec les producteurs, et dans le conseil donné aux autorités publiques.
Des biens sociaux non marchands ou partiellement marchands
La distinction entre » biens sociaux » et » biens privés » me semble fondamentale. Dans le second volume, je soutiendrai que les premiers ont leur fondement dans la citoyenneté, et non dans quelque défaillance du marché. Comme le socialisme trouve sa raison d’être dans la démocratie généralisée, la citoyenneté y devient une notion capitale.
Je proposerai de définir d’abord un certain nombre de biens indispensables à l’exercice de la citoyenneté politique, mais aussi économique et sociale (protection sociale et solidarité sociale), sans laquelle la première est vidée de ses moyens. Ce sont eux qui rendent nécessaire l’existence de services publics de base, fournissant des biens gratuits ou faiblement payants (et par conséquent largement financés par l’impôt).
Je proposerai ensuite de définir une seconde catégorie de biens sociaux, liés à la citoyenneté collective : biens indispensables à l’indépendance nationale, à la sécurité sanitaire et à la protection de l’environnement ; biens d’usage collectif, tels que eau, transports collectifs etc. correspondant au mode de vie ou au standard de vie décidé démocratiquement par la population, sur la base de ses traditions historiques et de son niveau de développement. Ces biens seraient fournis par d’autres services publics, à des prix de marché mais selon les conditions fixées par le cahier des charges résultant de leur » mission « .
Puisqu’il s’agit de services publics, je pense que ces biens ne peuvent être produits que par des administrations, des établissements publics ou des entreprises publiques, impliquant un rôle de l’Etat bien plus important, notamment au niveau de la propriété, que dans le cas des entreprises « socialisées » (le terme prenant un sens différent selon les modèles) du secteur producteur de biens privés. Dans la dernière partie du volume suivant, je proposerai un certain nombre de réformes pour refonder dès maintenant ce secteur, qui garderaient une large validité dans une société socialiste.
Concurrence et coopérations
J’ai soutenu plus haute que concurrence et coopération ne sont pas comme l’eau et le feu, bien qu’elles désignent des comportements souvent opposés, mais qu’elles peuvent se renforcer mutuellement, tout en neutralisant leurs aspects les plus antagonistes. Dans le système capitaliste, on l’a vu, la concurrence est des plus « imparfaites », la coopération entre firmes toujours conflictuelle (rares sont les cas de partenariat véritable), et la non-coordination produit souvent, dans des situations qui sont du type du « dilemme du prisonnier », des résultats sous-optimaux. Dans le système soviétique la coopération était imposée d’en haut et n’empêchait pas l’existence de » marchandages administratifs « . Dans un système socialiste, la coopération serait au contraire à la fois spontanée et organisée démocratiquement.
C’est seulement si les producteurs sont « à armes égales » – mêmes possibilités d’obtenir des capitaux, mêmes capacités d’information, même « encadrement » des conditions d’emploi, de rémunération, et de travail, mêmes rapports avec les consommateurs, même accès à certains biens sociaux (aides à la création d’entreprises, promotion de l’activité économique, recherche fondamentale etc.), que la concurrence devient une vraie concurrence. Inversement c’est seulement si la concurrence est honnête, si les entreprises fournissent les informations demandées, si les comportements de lobbying et de corruption sont éventés et sanctionnés, que la coopération peut porter ses fruits.
Bien que cette coopération soit avantageuse pour les entreprises elles-mêmes, qui sont mieux à même de savoir ce qu’elles font et quels risques elles prennent, bien qu’elle soit parfois spontanée, elle devra être le plus souvent imposée, car chacune, par calcul ou par myopie, poursuit ses intérêts propres, mais elle ne concernera que les aspects généraux de l’activité, les » règles du jeu » si l’on veut. C’est toute la différence avec le système soviétique, et c’est pourquoi j’ai employé le terme « d’organisée ». Toutes les institutions d’une économie socialiste vont dans ce sens, depuis la coopération au sein de branches d’industrie jusqu’à la planification. On peut penser, en particulier, comme cela a été proposé, à des “ réseaux publics d’information ” et à des “ commissions de prix et de salaires ”, fournissant des normes au moins indicatives. Je ne peux en dire plus ici, sauf à entrer dans le détail des modèles.
Une politique de l’humain
Voilà deux termes contradictoires aux yeux de l’ultra-libéralisme (mais non du libéralisme classique), puisque toute politique est coercitive, attentatoire aux libertés, sauf si elle se contente de codifier quelques règles du jeu. De ce qu’il précède on voit cependant ce qu’une telle politique peut signifier.
Aucun centre planificateur ne dictera leurs besoins aux individus, mais ce ne sera pas non plus aux puissances d’argent de le faire. C’est la délibération démocratique qui décidera des biens sociaux, c’est-à-dire des biens qui leur fourniront les conditions de leur autonomie personnelle, le socle de leur vivre en commun, les moyens stratégiques de leur souveraineté populaire, et, par voie de conséquence, de leur négociation avec les autres Etats pour fixer les règles communes nécessaires à la protection de la santé et de l’environnement.
Au delà les individus seront entièrement libres de décider individuellement de leurs biens “ privés ” et de leur sort. Mais, comme je l’ai déjà dit, la société ne se désintéressera pas pour autant des cas individuels. Simplement elle n’interviendra qu’à la demande des individus et dans la mesure de ses moyens.
Une politique de l’humain prend du sens à partir du moment où l’opacité des processus économiques et sociaux peut être en partie dissipée. Certes on ne peut rêver ni à une société transparente, ni à une information parfaite, ni à une capacité de savoir illimitée, si bien que les phénomènes de méconnaissance ne sauraient être éradiqués. Mais l’apprentissage citoyen (avec le développement de ces services publics de base, largement gratuits ou subventionnés, que seront l’éducation et l’information générale) donnera aux individus des moyens pour maîtriser la complexité du monde et celle de la réalité humaine. La notion de “ société de l’information ” ne sera plus un vain mot. Le développement des sciences humaines, sur de meilleures bases empiriques (important sujet que je n’ai pu aborder), et avec un réel souci pédagogique, sera une priorité.
Que pourrait être la nouvelle civilisation? Nous ne pouvons l’anticiper. Il serait tout à fait utile de chercher ce qui, ici où là, se dessine ou se construit en opposition à la société dominée par l’argent et la marchandise. La littérature, la science fiction, l’art rebelle seront sans doute ici de meilleurs éclaireurs de l’avenir que le discours froid de la science. Mais il faut prendre les choses par le commencement, ou encore, comme disait Marx, à la racine, c’est-à-dire dans les conditions socio-économiques de production et dans la forme du politique qui leur correspond. C’est ce travail de recherche qui sera poursuivi dans le volume suivant.
Pour aller plus loin lire le texte d’Andréani présenté sur notre site «la socialisation des marchés».