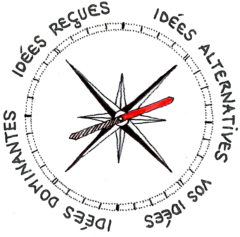Extraits du livre de Thomas Coutrot, « Libérer le travail, Pourquoi la gauche s’en moque et pourquoi ça doit changer», Seuil, 2018
Libérer le travail pour démocratiser la société
Alexis Cukier propose une éclairante synthèse des débats autour des rapports entre travail et démocratie en distinguant « deux modèles de la centralité politique du travail[1]», selon que la liberté du travail est considérée comme le résultat ou comme la condition de la démocratisation des rapports sociaux dans leur ensemble. Le modèle de Marx consiste à « révolutionner les institutions pour démocratiser le travail» : la prise du pouvoir et la destruction de l’État bourgeois, l’abolition de la propriété privée et la socialisation de la production sont les préalables à l’épanouisse- ment de la liberté du travail, qui peut seulement alors devenir « le premier besoin de la vie». Les actuelles coopératives ouvrières, par exemple, n’ont pas de valeur en elles-mêmes comme anticipations d’un travail libéré, mais comme manifestations de l’autonomie politique du prolétariat.
Pour John Dewey en revanche, il faut partir du travail pour transformer les institutions. L’atelier et le bureau doivent devenir des écoles de l’autonomie : le philosophe pragmatiste prône «un modèle d’organisation du travail radicalement démocratique qui implique que tous les travailleurs puissent devenir dans leur activité à la fois dirigeants, managers et ouvriers[2]», car l’activité déployée (ou non) durant le temps du travail joue un rôle décisif sur la formation des compétences des citoyens. Axel Honneth voit lui aussi en Dewey un penseur de la démocratie par le travail : «pour créer l’éthique pré-politique d’une société démocratique, Dewey part de l’idée que seule une forme équitable et juste de la division du travail peut donner à chaque membre de la société la conscience de contribuer avec tous les autres de façon coopérative à la réalisation de buts communs[3]». Christophe Dejours s’inscrit dans ce modèle quand il propose aux dirigeants d’entreprise de réformer l’organisation du travail afin que «le management coopératif offre des espaces pour le développement et l’apprentissage de l’activité déontique [de création de règles] et la pratique concrète de la démocratie[4]».
Avec Dewey on peut affirmer que « le problème ultime de la production est la production des êtres humains libres s’associant avec les autres sur un pied d’égalité[5]». Mais il semble qu’on bute ici sur un cercle vicieux : comment libérer le travail sans changer les institutions qui l’organisent ? Et comment transformer ces institutions si le pouvoir d’agir des citoyens-travailleurs reste atrophié par le travail ? Seule une stratégie dialectique permettra de rendre ce cercle vertueux : il faudra s’appuyer sur les innovations sociales pour conquérir des positions dans les institutions, puis utiliser celles-ci pour renforcer les pratiques démocratiques de travail, ce qui renforcera ainsi la dynamique des changements institutionnels, etc. Il reste que Dewey a sans doute raison contre Marx: l’impulsion doit venir de l’expérimentation à une échelle significative de formes émancipatrices de travail. C’est la voie ouverte par les acteurs sociaux qui portent de nouvelles pratiques du travail vivant.
[…]
Le capitalisme s’étend au-delà de ce qu’il peut contrôler en marchandisant sans trêve les services publics fondamentaux, la monnaie, la terre, le corps humain, la nature en général. Il commande au-delà de ce qu’il peut imposer en se livrant à sa pulsion mortifère vers l’abstraction du travail, ce projet sans cesse relancé de « dévitalisation du travail vivant[6]». Il dépense au-delà de ses propres ressources en épuisant les travailleurs, les liens sociaux et les écosystèmes. L’hubris capitaliste est infiniment plus dévastatrice que celle des régimes oppressifs antiques ou médiévaux, car elle étreint l’ensemble des écosystèmes et menace la vie même.
A la source de ces périls se trouve la question de la démocratie au travail : qui décide quoi produire, comment le produire, au profit de qui ? Le travail doit être libéré de l’étouffante emprise financière pour laisser une chance à la vie. Il ne s’agit pas de «revenir au point de départ», mais d’instituer de nouvelles formes d’organisation du travail plus proches des «fondements essentiels de la vie» pour cesser d’avoir honte de ce que nous faisons au monde.
Autodéfense sociale
Menacée dans ses fondements, la société se défend. Les consommatrices, informées par les lanceurs d’alerte, deviennent plus vigilantes sur les conditions et les conséquences de la production. Les résistant.e.s à l’extraction des énergies fossiles luttent âprement[7]. Les mouvements sociaux apprennent à coopérer: dans la lignée des forums sociaux mondiaux, les négociations climatiques coalisent syndicats, ONG et experts du monde entier. Les organisations syndicales s’engagent dans la critique du productivisme et pour une «transition juste[8]», tandis que les associations environnementales se soucient de reconversions industrielles et de redistribution des richesses. Ensemble elles revendiquent des taxes globales pour réduire les inégalités et financer les investissements verts, demandent que la création monétaire soit mise au service de la transition et pas des banques, promeuvent la réduction du temps de travail, les circuits courts, les alternatives locales et solidaires. Celles-ci font tache d’huile, popularisées par les médias alternatifs[9], des films comme Demain, des initiatives comme Alternatiba. La désobéissance civile devient un mode d’action familier, contre les OGM, l’évasion fiscale ou les combustibles fossiles. Face à l’autoritarisme néolibéral, les manifestations de résistance se durcissent, avec le « cortège de tête » contre la loi Travail ou les Black Blocks. Des intellectuels venus d’horizons divers réfléchissent ensemble à ce que serait une société conviviale où l’on saurait «s’opposer sans se massacrer[10]».
Ça bouge aussi du côté du travail. Avec les «révolutions précaires[11]», les intermittente, s du spectacle inventent et défendent âprement un nouveau modèle d’emploi discontinu avec main- tien – sous conditions – du revenu. D’autres jeunes vont goûter à la simplicité volontaire dans des communautés néorurales ou expérimentent la coopération et la gratuité dans des Zads. Pour se dégager de l’emprise des discriminations et de la soumission au patron, «les jeunes des cités populaires et de la banlieue parisienne font un usage tactique de l’intérim[12]», de l’auto- entrepreneuriat et d’Uber. (Il y a là évidemment une redoutable ambivalence : le mal-travail et les discriminations racistes dégoûtent du salariat certaines franges de la jeunesse et contribuent à légitimer la précarisation…)
En quête d’un travail qui ait du sens, des paysan.ne.s, des hackers, des travailleurs d’entreprises récupérées ou de coopératives, des plates-formes collaboratives, des commoneur.e.s conçoivent, produisent et distribuent des biens et des services de qualité, respectueux de la nature, à des coûts maîtrisés. Largement ignorées des pouvoirs publics, ces initiatives sont pour- tant la clé d’un avenir vivable. Elles démontrent que justice, écologie et efficacité productive peuvent se renforcer mutuelle- ment autour d’un projet partagé et d’un travail de qualité.
Plus près du cœur du salariat, les dégâts du « productivisme réactif[13]» suscitent les revendications syndicales et la mobilisation patronale. L’émotion provoquée par les suicides au travail a suscité des politiques de prévention des risques psychosociaux qui ont limité certains des pires excès. À la demande des syndicats, certaines entreprises créent des espaces de discussion sur le travail, avec parfois des formules vraiment innovantes, par exemple l’élection par les salarié.e.s d’« opérateurs référents », dans l’expérimentation à Renault-Flins animée par Yves Clot et son équipe[14]. D’autres, comme on l’a vu, relancent des équipes autonomes ou même cherchent à «libérer» leurs salarié.e.s. Lassé.e.s de subir les réorganisations, des syndicalistes et des chercheur.e.s mènent des recherches-actions pour reconstruire le pouvoir d’agir des travailleurs.
Pourtant les politiques publiques demeurent timorées, voire franchement néfastes: la jurisprudence sur le «harcèlement managérial » n’est toujours pas inscrite dans le droit du travail, le burn out et la dépression ne sont toujours pas reconnues comme maladies professionnelles, les objectifs chiffrés ne sont toujours pas considérés comme des risques professionnels à combattre, la participation des salarié.e.s aux changements organisationnels ne sont toujours pas promus; l’instance de représentation des salariés consacrée à leur santé au travail (le CHSCT) est supprimée au risque d’affaiblir les capacités d’action et les compétences spécifiques des élus du personnel. Des avancées significatives dans ces différents domaines permettraient pourtant de protéger bien mieux la santé des salarié.e.s, sans aucun effet négatif sur l’efficacité économique – bien au contraire.
Il faut cependant reconnaître que le mouvement syndical, pour l’essentiel, reste déficient sur la question du travail. Certes, une prise de conscience semble s’affirmer: pour Philippe Martinez (CGT), « il faut un syndicalisme de proximité avec les salariés, à l’écoute de leurs préoccupations et des solutions qu’ils proposent pour bien faire leur travail[15]», et pour Laurent Berger (CFDT), «si on veut changer la société il faut commencer par changer le travail[16]». Cependant sur le terrain, hormis quelques recherches-actions isolées, les syndicats peinent à intervenir sur le travail concret, ses conditions, son organisation et ses finalités. Ils restent souvent enfermés dans le «dialogue social» avec un patronat de plus en plus intransigeant, au lieu de rechercher des alliances avec des acteurs extérieurs à l’entre- prise mais directement concernés par ses activités. Quand ils résistent aux réformes néolibérales, ils ne diversifient guère leurs formes d’action, malgré la quasi-disparition des grèves et la faible efficacité des journées d’action et de manifestation.
Pourtant, s’appuyer sur les aspirations sociales à un travail de qualité et prendre vraiment en charge le débat sur ce thème pourrait contribuer à recharger les batteries syndicales. Car de l’énergie sociale, il y en a du côté du travail vivant, autour des dynamiques de la qualité du travail, du travail collaboratif et du care. J’ai avancé l’hypothèse selon laquelle une fécondation réciproque de la pratique (plutôt masculine) du travail collaboratif par l’éthique (plutôt féminine) du care pourrait accoucher d’une politique du travail vivant, et j’en ai proposé des exemples. Une telle politique ne pourra se construire qu’en pensant et en expérimentant de nouvelles formes d’organisation du travail, d’abord à des échelles locales ou sectorielles (mais pas forcément petites comme le montrent Linux ou Buurtzorg). Quelle pourrait être la base sociale d’un tel projet?
La vie, cause commune
Philippe Davezies avance une réponse particulièrement stimulante. Je me permets ici une longue citation car je ne saurais dire aussi bien… «L’approche clinique du travail montre que les salariés ne se résignent pas, qu’ils résistent à l’abstraction de la prescription et à la dépersonnalisation du travail. Cette résistance ne découle pas d’un calcul conscient. Elle est le mouvement même de la vie qui tend à exprimer son potentiel et à déborder les formes qui la contraignent. Face aux lacunes de l’organisation du travail, les salariés répondent par ce qui leur paraît “naturel, évident, non questionnable” parce qu’exprimant leur rapport au monde. Face aux exigences de la situation, c’est leur sensibilité qui s’exprime et qui active les normes et valeurs sociales qu’ils ont incorporées au cours de leur parcours de vie. Ils passent donc leur temps à subvertir la pression à l’accélération et à la standardisation pour réinjecter, dans les interstices que leur laissent les failles de l’organisation, des intérêts qui débordent largement les prescriptions de la direction et des actionnaires. Ils le font dans la discrétion mais cela les conduit parfois à des affrontements violents avec leur hiérarchie. Simplement, cette résistance est individuelle. Située à la rencontre de deux types de particularités (de deux temporalités) : celle de la situation et celle de la trajectoire biographique, elle prend des formes toujours singulières qui impliqueraient un processus d’élaboration (donc la confrontation au point de vue d’autrui) pour accéder au statut d’engagement conscient et, au-delà, à la nature politique de l’enjeu sous-jacent: quel monde voulons-nous construire[17]?»
On retrouve ici la nature politique du travail qu’évoque Isabelle Ferreras. Les normes et valeurs sociales incorporées incluent aujourd’hui l’égale dignité de chaque être humain, le droit de chacun.e à participer aux décisions qui la concernent. Elles font aussi référence à la responsabilité envers les autres, à l’obligation de prendre soin du monde et de la vie[18]. Bien plus que la supposée contradiction entre la valeur d’échange et la productivité, c’est ce conflit entre le travail abstrait et ces valeurs fondamentales qui rend possible une politique d’émancipation fondée sur le travail vivant. L’organisation capitaliste du travail est par nature porteuse d’une «contradiction entre Argent et Activité[19]», cette injonction contradictoire faite en permanence aux travailleurs, à la fois appelés à obéir et à s’impliquer, à être des objets passifs de la prescription et des sujets actifs de l’activité. Ce hiatus nourrit en permanence la résistance et la créativité, plus souvent individuelle que collective, plus souvent silencieuse que tonitruante du travail vivant. Résistance et créativité qui s’incarnent dans les réalisations du travail collaboratif, de l’économie solidaire et des acteurs locaux de la transition, mais aussi, dans les lieux de travail ordinaires, par le déploiement spontané du souci de bien faire et du care ou, plus rarement, les recherches-actions syndicales sur la qualité du travail.
Une politique du travail vivant, ce serait en premier lieu l’affirmation sur la scène publique d’une cause commune à ces initiatives, celle de la défense et de la promotion du travail vivant contre les logiques du capital et de l’abstraction scientiste. Un mouvement social pour le travail vivant, en défense de la vie. Si nous le décidons, cette exigence pourrait irriguer de plus en plus profondément les luttes syndicales et écologistes qui se posent bien toutes cette même question : « Quel monde voulons-nous construire ? »
[…]
Instituer le travail concret
Ces résistances et ces innovations sont la source vive issue de l’activité quotidienne de travail de millions de personnes et sans laquelle rien n’est possible. L’essor d’un mouvement social pour la liberté du travail pourrait contribuer de façon décisive à la reconstruction d’un pouvoir d’agir populaire. Mais il importe aussi de penser dès maintenant les institutions qui peuvent à la fois en naître et les renforcer. On ne saurait instituer le travail vivant car, pour le dire à la manière de Castoriadis[20] et de façon ramassée, il exprime le jeu de l’imagination radicale dans le cours de l’action humaine. Toutefois les institutions sociales peuvent jouer un rôle déterminant pour favoriser l’expression de son potentiel créatif ou au contraire l’étouffer. Celles du capitalisme ont pour propriété fondamentale d’enserrer le travail vivant dans la poigne de fer de la valeur abstraite. Un enjeu central pour l’émancipation et l’écologie est de défaire l’imaginaire de la « rationalisation » du travail pour donner une place centrale au travail vivant.
Si le travail vivant n’est pas instituable, le travail concret peut l’être. Cela passe par la création d’institutions qui valorisent non pas seulement des indicateurs financiers ou quantitatifs, mais les effets qualitatifs du travail sur le monde social et naturel. En incluant donc dans ces effets non seulement la qualité d’usage des produits du travail – les biens et services utiles et durables -, mais aussi la qualité politique des rapports sociaux produits dans le travail – l’égalité et l’autonomie. Mettre la qualité, en ce double sens, au cœur du processus de travail, c’est ce que font déjà les acteurs de l’éthique du care – qui prêtent attention aux effets concrets du travail – et ceux du travail collaboratif – qui inventent des règles pour l’autogouvernement. Dans ces mouvements, de nouvelles significations imaginaires sont au travail, qui contestent radicalement les significations capitalistes et productivistes.
Quelles institutions, quelles politiques publiques pourraient entrer en résonance avec ces mouvements, les renforcer, voire leur donner la prééminence sur le travail mort? Des secteurs importants de la gauche syndicale et politique, en particulier sa frange antiproductiviste, tendent à présenter la réduction du temps de travail comme l’exigence clé qui permettrait à la fois une amélioration des conditions de vie, une réduction du chômage, une redistribution des richesses, une prise de distance vis-à-vis du consumérisme et une plus grande activité politique des citoyen.ne.s. La réduction du temps de travail peut être un levier majeur. Mais cette stratégie serait illusoire si elle restait prisonnière du travail abstrait. En persistant à ignorer la question du travail vivant, elle nous amènerait à être «esclaves deux heures par jour ». Au moins autant que la réduction quantitative de la durée du travail, c’est l’augmentation qualitative de la liberté du travail qu’il faut mettre au cœur d’une stratégie politique émancipatoire, car comme le dit bien Michel Husson, paraphrasant Simone Weil, «être exploité, contraint à un travail aliéné, ne serait-ce que deux heures par jour, c’est être asservi le reste du temps[21]». Couplée à un recul de la subordination, la RTT pourra contribuer à rapprocher le marché du travail du plein- emploi. Dans un contexte de travail asservi et de productivité stagnante, elle ne peut qu’être l’instrument d’une intensification et d’un asservissement supplémentaires.
La qualité du travail, exigence vitale
«Une organisation du travail telle qu’il sorte chaque soir des usines à la fois le plus grand nombre possible de produits bien faits et des travailleurs heureux » : voilà qui pourrait être une belle définition de la qualité du travail… à condition d’y ajouter « heureux et libres ». Mais Simone Weil, pour une fois peu originale, voyait cette organisation idéale comme un compromis entre des exigences contradictoires: « les besoins de la production et les besoins des producteurs ne coïncident pas forcément […], mais on peut tout au moins s’approcher d’une telle solution en cherchant des méthodes qui concilient le plus possible les intérêts de l’entreprise et les droits des travailleurs»[22]. Les récents développements théoriques et pratiques de l’auto- gouvernement d’entreprise et du travail collaboratif remettent en question ce postulat jusqu’ici incontesté y compris à gauche : le travail, réorganisé selon des principes d’égalité et d’autonomie, voit son efficacité productive non pas diminuée mais accrue. En outre on ne peut plus contester, à la suite des nombreux travaux sur les indicateurs de richesse[23], que la mesure de l’efficacité du travail doive intégrer ses effets sur les humains et la nature : selon la formule de Jean Gadrey, « il faut passer de la productivité à la qualité[24]». Un travail de qualité exige une attention aux conséquences des différents choix possibles de production et une délibération démocratique sur ces choix. Et donc des entre- prises qui, par leur structure et leur gouvernance, puissent produire cette attention et cette délibération. Concernant la structure, j’ai montré (chapitre 7) que l’analogie avec la théorie des systèmes vivants permet de comprendre comment la décentralisation des décisions dans l’entreprise auto- gouvernée rend possible un haut niveau de performance produc- tive par le déploiement d’une éthique du care : au-delà des ratios comptables et financiers, qui demeurent évidemment indispensables pour évaluer l’économie des moyens, il s’agit de porter attention aux finalités, aux besoins réels des usagers-clients et de l’environnement. Au point de vue surplombant et abstrait de la finance, doivent succéder la prise en compte et l’adaptation rapide aux situations concrètes locales. Il faudra beaucoup expérimenter pour affiner les modélisations, dont la sociocratie n’est sans doute qu’une parmi d’autres.
L’entreprise ne deviendra pas pour autant un nirvana, ni le travail un enchantement quotidien. Produire, c’est toujours se confronter à la résistance du réel et aux désaccords avec les collègues. Décider, c’est toujours arbitrer entre des attentes contradictoires. Dans le travail comme ailleurs, la souffrance et le conflit sont inéliminables. Ce que montrent précisément les avancées récentes, c’est que l’intelligence collective est plus efficace pour surmonter cette résistance et plus légitime pour arbitrer ces conflits. C’est aussi que l’intelligence collective suppose la confiance et l’égalité entre les participante.s.
Voilà pourquoi l’autogouvernement appelle une révolution démocratique de l’entreprise. On ne peut nier les mérites d’un Zobrist ou d’un De Blok, les dirigeants de FAVI et de Buurtzorg, mais la figure paradoxale du « leader libérateur » mène à une impasse. Tant que les pouvoirs de changer les règles de travail, de distribuer la richesse créée, de supprimer des emplois ou même de vendre l’entreprise demeurent l’apanage d’un seul ou de quelques-uns, la désillusion – la « dérision managériale » – est presque inévitable. Il est très nécessaire de développer la participation des salarié.e.s aux décisions sur leur travail, mais l’entre- prise, qu’elle soit «libérée» ou «délibérée[25]», ne peut tenir durablement ces promesses sous la dictature des actionnaires. L’autogouvernement du travail suppose l’autogouvernement de l’entreprise. Dans les termes de Christophe Dejours – même si cet auteur est plus enclin à fonder qu’à contester la légitimité des hiérarchies[26] —, la «déontique du faire», c’est-à-dire la création de règles pour la coopération dans et autour du travail, ne peut s’affirmer durablement sans une «déontique institutionnelle» – l’invention d’une gouvernance démocratique de l’organisation.
- Alexis Cukier. «Deux modèles de la centralité politique du travail», Travailler, n° 36, 2016. ↑
- Ibid., p. 35. ↑
- Axel Honneth, « La démocratie, coopération réflexive. Dewey et la théorie contemporaine de la démocratie », Mouvements, n° 6, 1999. ↑
- Christophe Dejours, «Psychodynamique du travail et politique, quels enjeux?», art. cité, p. 86. ↑
- John Dewey, Later Works n° 13, in Collected Works, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1939, p. 320, cité par Laure Bazzoli, Véronique Dutraive, «La contribution de la philosophie sociale de John Dewey à une philosophie critique de l’économie », Cahiers d’économie politique, n° 65, L’Harmattan, 2013. ↑
- Alexis Cukier, Introduction, Travail vivant et théorie critique, op. cit, p. 41. ↑
- Naomie Klein, Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique, Paris, Les liens qui libèrent, 2015. ↑
- www.ituc-csi.org/qu-est-ce-une-transition-juste ?lang=fr ↑
- Bastamag, Mediapart, Reporterre… font à cet égard un travail essentiel. ↑
- Alain Caillé et alii, Manifeste convivialiste. Déclaration d’interdépendance, Lormont, Le Bord de l’Eau, 2013 ↑
- Patrick Cingolani, Révolutions précaires, Essai sur l’avenir de l’émancipation, Paris, La Découverte, 2014. ↑
- Ibid., p. 31. ↑
- Philippe Askenazy, Les Désordres du travail. Enquête sur le nouveau productivisme, Paris, Seuil, 2004. ↑
- Jean-Yves Bonnefond, «Une expérience d’amélioration de la qualité du travail à Renault-Flins », La Revue des conditions de travail, Anact, n° 3,2016. ↑
- Interview à Santé et Travail, n° 100, octobre 2017. ↑
- Interview à Alternatives économiques, 24 octobre 2017, www.alternatives- economiques.fr/on-veut-changer-societe-faut-commencer-changer-travail/ 00081194. ↑
- Je remercie vivement Philippe Davezies pour nos échanges de courriels et son autorisation d’en extraire ce texte. ↑
- Hans Jonas, Le Principe responsabilité, Paris, Le Cerf, 1998. ↑
- Yves Schwartz, Postface, Expérience et connaissance du travail, Paris, Les Éditions sociales, 2012. ↑
- Cornélius Castoriadis, L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975. ↑
- Michel Husson, «Droit à l’emploi ou revenu universel», À l’Encontre. La Brèche, 7 mai 2011, www.alencontre.org/economie/droit-a-l%E2 %80 % 99emploi-ou-revenu-universel.html. ↑
- Simone Weil, «La rationalisation», in La Condition ouvrière, op. cit., p. 185. ↑
- Jean Gadrey, Florence Jany-Catrice, Les Nouveaux Indicateurs de richesse, Paris, La Découverte, 2012 ; voir aussi Jean-Paul Fitoussi, Amartya Sen, Joseph Stiglitz (2009), Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, Paris, La Documentation française, 2009. ↑
- Jean Gadrey, « Il faut passer de la productivité à la qualité »,La Vie, 4 février 2016. ↑
- Laurent Stoffel, « L’entreprise délibérée », décembre 2016, www.croisee.fr/ 2016/12/lentreprise-deliberee. ↑
- «L’autorité procède d’abord de l’inégalité de fait entre les humains ; elle suppose ensuite une prise de conscience de cette inégalité ; puis l’évaluation d’une organisation rationnelle de la hiérarchie sociale ; et la reconnaissance de la supériorité de la personne qui, au moins par intermittence, incarne l’autorité» (Christophe Dejours, Travail et émancipation, op. cit.,p. 150). ↑