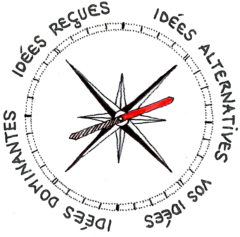Un socialisme véritable et réalisable1
David SCHWEICKART (Chicago) traduit de l’anglais par Tony Andréani In: Actuel Marx n°14, Nouveaux Modèles de Socialisme, PUF, Paris, deuxième semestre 1993
Le modèle socialiste que je vais présenter possède des traits communs avec le socialisme yougoslave, le capitalisme japonais et les coopératives de Mondragon, dans le Pays basque espagnol, mais il n’est une version stylisée d’aucun d’entre eux. Mon modèle diffère de chacune de ces expériences sur plusieurs points cruciaux. Mais celles-ci, par leurs succès comme par leurs échecs, constituent un donné empirique très pertinent quant aux propositions que je vais défendre en sa faveur2.
J’appellerai ce modèle «Démocratie économique»3. La Démocratie économique, dans le sens où je prendrai l’expression ici (pour marquer la spécificité du modèle), signifie quelque chose de plus que le contrôle général de l’économie par les citoyens. Elle signifie aussi quelque chose de différent de ce que le système yougoslave et le système de Mondragon ont en commun, à savoir le contrôle démocratique d’une entreprise par ses travailleurs. Ce dernier trait, qui sera un élément de la Démocratie économique, je l’appellerai «autogestion des travailleurs». Ainsi la Démocratie économique est une forme de socialisme comportant (entre autres choses) cette autogestion.
Comme le socialisme yougoslave (en théorie sinon en pratique), la Démocratie économique est un socialisme de marché autogestionnaire. A la différence de la forme yougoslave (avant 1989), elle suppose la Démocratie politique. Je laisserai de côté ses particularités politiques, mais je poserai l’existence d’un Etat de droit qui garantit les libertés civiles et d’un régime représentatif, avec des corps démocratiquement élus, tant au niveau local qu’aux niveaux régional et national4.
La structure économique du modèle que je propose comporte trois traits fondamentaux:
- chaque entreprise est gérée démocratiquement par ses travailleurs
- l’économie au jour le jour est une économie de marché: les matières premières et les biens de consommation sont achetés et vendus à des prix déterminés par les mécanismes de l’offre et de la demande
- les investissements nouveaux sont contrôlés socialement: le fonds d’investissement est généré par une taxation et accordé en fonction d’un plan démocratique orientant le marché.
Voyons chacun de ces trois éléments:
1) Chaque entreprise est gérée par ceux qui y travaillent
Les travailleurs sont responsables des décisions courantes: organisation des postes de travail, discipline, techniques de production, nature et quantité des produits, mode de distribution des bénéfices nets5. Ces décisions sont prises démocratiquement selon le principe: un homme, une voix. Dans une firme d’une certaine taille une délégation de pouvoir sera sans aucun doute nécessaire. Un conseil des travailleurs ou un directeur général (ou les deux) seront habilités à prendre certains types de décisions6. Mais ces dirigeants sont élus par les travailleurs. Ils ne sont pas salariés par l’Etat, ni élus par l’ensemble de la collectivité.
Bien que les travailleurs gèrent leur entreprise, ils ne possèdent pas en propre les moyens de production. Ceux-ci sont propriété collective de la société. La propriété sociale se manifeste par l’obligation (inscrite dans la loi) de garder intacte la valeur du stock de capital de la firme. Un fonds d’amortissement doit être dégagé à cette fin: l’argent de ce fonds peut être dépensé pour tout remplacement ou pour toute amélioration de capital que l’entreprise juge utile, mais il ne peut servir à augmenter les revenus des travailleurs.
Si une firme connaît des difficultés, les travailleurs sont libres d’effectuer des restructurations courantes ou de la quitter et d’aller travailler ailleurs. Mais ils ne sont pas libres de vendre leurs stocks de capital sans les remplacer par une valeur égale – du moins sans une autorisation explicite de leur institution de tutelle (la banque à laquelle la firme est affiliée – pour aller vite). Si une firme est incapable d’engendrer même le revenu minimum par tête, elle doit se déclarer en faillite. Le capital circulant doit être vendu pour payer les créanciers. Tout ce qui reste doit être restitué au fonds d’investissement, pendant que le capital fixe retourne à la collectivité – les deux processus étant médiés par la banque. Les travailleurs doivent s’embaucher ailleurs.
2) La Démocratie économique est une économie de marché
Ca l’est du moins dans la mesure où il s’agit d’allouer les biens capitaux et les biens de consommation existants. L’alternative à l’allocation par le marché est la planification centralisée, et cette planification (comme la théorie le prédit et comme l’histoire le montre) conduit à la fois à une concentration autoritaire du pouvoir et à l’inefficience.
Il y a une décennie, l’affirmation que la planification centrale est fondamentalement défectueuse était un grand sujet de querelle parmi les socialistes. Elle l’est moins aujourd’hui. La plupart (mais pas tous) concèdent que sans un mécanisme des prix régulé par l’offre et la demande il est extrêmement difficile pour un producteur ou pour un planificateur de savoir ce qu’il faut produire, en quelle quantité et avec quelles variétés, et de savoir quels moyens sont les plus efficaces. On reconnaît aussi généralement qu’il est difficile en l’absence d’un marché d’harmoniser l’intérêt privé et l’intérêt général sans compter à l’excès sur des motivations altruistes. Le marché résout ces problèmes (quoique de façon incomplète) d’une manière non autoritaire, non bureaucratique. C’est là un avantage important.
Notre économie socialiste est une économie de marché. Les entreprises achètent leurs matières premières et leurs équipements à d’autres entreprises, et vendent leurs produits aux autres entreprises ou aux consommateurs. Les prix sont largement spontanés. Dans certains cas, toutefois, des contrôles de prix ou des soutiens aux prix peuvent être requis (les premiers dans les branches qui connaissent des concentrations monopolistiques, les seconds en agriculture pour atténuer les incertitudes dues au variations climatiques, et peut-être pour préserver un mode de vie qui pourrait autrement disparaître).
Notre économie socialiste n’a pas la religion du laissez-faire. Comme le libéralisme moderne, elle autorise l’intervention étatique quand le marché fonctionne mal. Elle ne fait pas du marché le bien absolu, le paradigme de la libre interaction entre les individus. Elle préfère considérer le marché comme un instrument utile pour atteindre certains buts sociaux. Cet instrument a sûrement des avantages, mais aussi des défauts. Le tout est de l’employer avec discernement.
Comme les entreprises, dans notre économie, achètent et vendent sur le marché, elles cherchent à faire un «profit». Ce profit cependant diffère du profit capitaliste. Les entreprises cherchent à maximiser la différence entre le produit de leurs ventes et l’ensemble des coûts non salariaux. Dans une démocratie économique le travail n’est pas un facteur de production au même titre que la terre ou le capital. Le travail n’est pas du tout une marchandise, car, quand un travailleur rejoint une entreprise, il y acquiert un droit de vote et un droit à une part du revenu net.
Ces parts (des pourcentages du revenu net et non des quantités absolues) ne sont pas nécessairement égales pour tous. Les travailleurs eux-mêmes décident de la manière dont ils distribuent le revenu. Ils peuvent opter pour l’égalité, mais ils peuvent aussi décider de rémunérer davantage les tâches les plus difficiles; ils peuvent trouver qu’ils ont intérêt à récompenser les talents qui sont rares pour les attirer et les conserver. De telles décisions sont prises démocratiquement.
3) Les investissements nouveaux sont contrôlés socialement
Le troisième trait fondamental de la démocratie économique caractérise davantage, paradoxalement, le Japon capitaliste et les coopératives de Mondragon que le système yougoslave: il s’agit du contrôle de l’investissement. C’est là un trait décisif.
L’autogestion a pour fin de supprimer la marchandisation de la force de travail et l’aliénation qui en résulte. Le marché est le remède à la centralisation excessive et à la bureaucratie. Le contrôle social des investissements nouveaux est le contrepoids du marché, ce qui permet de réduire l’«anarchie» de la production capitaliste.
Dans le capitalisme, le marché a deux fonctions: il alloue les biens existants et les ressources et il détermine le cours et le taux de la croissance. Dans notre modèle ces deux fonctions sont séparées. Il n’y a pas de «marché de l’argent» faisant se rencontrer épargnants privés et investisseurs privés et déterminant un taux d’intérêt.
Les fonds d’investissement sont générés et accordés selon des processus démocratiquement contrôlés. Ils sont générés non en offrant l’appât de l’intérêt aux épargnants, mais en taxant les actifs en capital. Cette taxe a une double finalité. Elle incite à faire un usage efficace des biens capitaux (puisque les entreprises doivent payer une taxe sur leurs actifs en capital, elle chercheront à en faire un usage économique), et elle sert à constituer des fonds pour les nouveaux investissements. Cette «taxe sur le capital» remplace l’intérêt de l’économie capitaliste, et remplit la même double fonction.
En fait, puisque la taxation est la source du fonds d’investissement, il n’y a aucune raison de payer des intérêts aux individus pour leur épargne, ni, pour la même raison, de conférer des intérêts à des prêts venant de particuliers. La Démocratie économique remet en vigueur la vieille proscription de l’usure8.
Les fonds d’investissement sont donc générés par la taxation. Comment sont-ils accordés? Bien que la société soit démocratique, il ne serait pas réalisable de faire voter la population sur chaque projet d’investissement. Non seulement l’énorme quantité de projets rendrait cette procédure impraticable, mais encore elle annulerait un avantage majeur de l’investissement socialisé: l’adoption consciente d’un ensemble bien coordonné et cohérent de priorités d’investissement.
Mais comment un plan d’investissement serait-il formulé et mis en oeuvre? Il est important ici de se rendre compte qu’il existe toute une gamme de possibilités. Il est probable qu’aucune ne soit optimale pour tous les pays et pour toutes les périodes.
A l’une des extrémités de la gamme, on trouverait un ensemble d’institutions inspiré du Japon: une élite bureaucratique bâtit un plan, crée un consensus, le fait adopter par le pouvoir législatif national, enfin l’applique rigoureusement – non par la contrainte, mais en se servant de ses larges pouvoirs d’accès au financement pour le couper à certaines firmes et pour permettre aux autres de se développer dans le sens souhaité.
A l’autre extrême, nous trouverions un «plan» qui imite le processus du marché tout en évitant l’intermédiaire capitaliste, une sorte de «laissez-faire socialiste». En ce cas, le fonds d’investissement serait réparti dans un réseau de banques nationales, régionales et locales qui attribueraient les dotations exactement selon les mêmes critères que des banques capitalistes. Le parlement fixe la taxe (le taux d’intérêt), l’ajustant chaque année de manière à harmoniser l’offre des fonds d’investissement avec la demande. Les banques acquittent elles-mêmes cette taxe. Elles peuvent percevoir un taux plus élevé sur les dotations qu’elles accordent et ainsi, en cherchant à maximiser leur profit, elles évaluent les risques relativement à leur profitabilité exactement de la même façon que des banques capitalistes. Dans une économie socialiste reposant sur un tel laissez-faire, il n’y a pas de planification qualitative de l’investissement, pas de volonté d’encourager ou de décourager une filière de production, pas davantage de contrôle conscient sur la quantité de l’investissement.
Le plus souvent, le mécanisme optimal se situe probablement entre ces deux extrêmes. Examinons un mécanisme qui serait plus ou moins intermédiaire. II sera plus démocratique et plus décentralisé que dans le modèle japonais; il donnera à la société un plus grand pouvoir de contrôle que ne le ferait un «laissez-faire socialiste».
Il faut remarquer que la planification que je propose ne concerne pas le fonctionnement économique dans son ensemble: elle ne prend en considération que le nouvel investissement, c’est-à-dire l’investissement qui n’est pas financé par l’amortissement. Bien que des sommes importantes soient mises en jeu, il ne constitue qu’une fraction de l’activité économique de la nation (la formation brute de capital fixe aux Etats-Unis, pendant la période 1960-1984, a atteint 17,9% par an, dont un quart pour l’immobilier d’habitation). On ne doit donc pas craindre que l’allocation sociale de l’investissement net productif constitue une part massive du produit national brut, quoiqu’elle représente, naturellement, une part stratégique de celui-ci. II faut aussi remarquer que les entreprises en activité ne sont pas touchées par cette planification aussi longtemps qu’elles ne souhaitent pas modifier leurs activités par des financements qui ne proviennent pas de leur fonds d’amortissement9.
Une taxe uniforme sur les actifs en capital de chaque entreprise a engendré une offre de fonds d’investissement. Le contrôle social sur ces fonds, convenablement démocratisé et décentralisé, sera mis en oeuvre par des plans interconnectés et par les banques. Commençons par les banques.
Nous distinguerons trois sortes d’investissements que peut faire la société: 1) ceux que des coopératives à la recherche de profit feraient spontanément, 2) ceux qui auraient pour but de faire de l’argent, mais qui, du fait d’externalités positives dans le domaine de la consommation ou celui de la production, ont une valeur supérieure pour la société à celle qui ressort de leur profitabilité, et 3) ceux qui se rapportent à la fourniture de biens et de services gratuits, tels que infrastructures, écoles, hôpitaux, transports urbains, moyens pour la recherche fondamentale, etc. Les deux dernières catégories correspondent à des initiatives que la planification doit soutenir10.
Deux problèmes se posent à propos de ces deux dernières sortes d’initiatives: décider quels projets soutenir, et allouer les fonds pour ces projets. Les décisions doivent être prises démocratiquement par les instances représentatives aux niveaux appropriés. Il faudrait faire faire des audits pour ces investissements comme on le fait pour le budget; il faudrait solliciter les avis des experts et de la population. Les représentants devraient ensuite décider du montant et de la nature du capital à dépenser pour les biens publics gratuits, et déterminer quelles branches du secteur coopératif ils souhaitent encourager. Les fonds pour les dépenses publiques devraient être transférés aux organismes publics appropriés; les fonds pour le secteur coopératif classés comme «fonds d’encouragement» devraient être spécifiés dans leur montant et leurs conditions d’attribution (une taxe d’usage à un taux plus bas que le taux national, peut-être seulement pour une période limitée).
Les allocations du fonds d’investissement se feraient donc selon le processus suivant: d’abord l’instance législative nationale décide, selon les procédures démocratiques qui viennent d’être évoquées, des dépenses en capital qui iront aux projets d’intérêt national, par exemple une amélioration des transports par voie ferrée. Les fonds pour ces projets sont alloués par l’organisme gouvernemental approprié, c’est-à-dire le ministère des Transports. Le reste du fonds d’investissement est attribué aux régions (Etats, provinces) sur une base per capita – si une région a une population qui représente X% de la population nationale, elle reçoit X% du fonds d’investissement11. L’instance législative nationale peut aussi décider que certains types de projets doivent être encouragés et, par suite, spécifier le montant du fonds mis à la disposition et le taux de la taxe pour de tels projets12.
Les instances représentatives régionales prennent des décisions similaires: sur les dépenses publiques en capital et sur les projets à encourager. Les fonds sont transférés aux autorités régionales appropriées; les fonds restants sont alloués, per capita, aux collectivités, qui prennent des décisions concernant l’investissement public local et leurs propres dotations d’encouragement.
Les priorités ayant été définies aux niveaux national, régional et local, les collectivités allouent les fonds à leurs propres banques. Je propose que ces banques soient structurées selon le modèle de la Caisse Populaire du Travail de Mondragon.
Chaque entreprise d’un niveau donné s’affilie à une banque de son choix, qui tient les comptes de son fonds d’amortissement et du revenu de ses ventes, l’approvisionne en capital productif et lui fournit peut-être d’autres services techniques et financiers. C’est vers cette banque que l’entreprise normalement se tourne pour un nouvel investissement en capital, bien qu’elle soit libre de se fournir ailleurs.
Chaque banque est gérée comme une «coopérative du second degré» – c’est le terme employé à Mondragon pour désigner une coopérative dont le conseil d’administration comprend des représentants autres que ceux des travailleurs de la coopérative. Le conseil d’administration d’une banque relevant d’une collectivité devrait inclure des représentants de l’organisme planificateur de la collectivité, des représentants des travailleurs de la banque et des représentants des entreprises avec lesquelles la banque travaille13.
Chaque banque reçoit de la collectivité une part des fonds d’investissement alloués à la collectivité, part déterminée par a) la taille et le nombre de entreprises affiliées à la banque, b) les réussites passées de la banque en ce qui concerne la profitabilité des dotations qu’elle a accordées (y compris les dotations d’encouragement à des taux inférieurs) et c) ses succès dans la création de nouveaux emplois14. Le revenu de la banque, qui sera distribué parmi ses travailleurs, provient d’une taxe générale sur les revenus (puisqu’ils sont des employés publics) selon une formule liant le revenu aux succès de la banque concernant les dotations profitables et la création d’emplois.
Si une collectivité est incapable de trouver des occasions d’investissement suffisamment viables pour absorber les fonds qui lui sont alloués, l’excédent doit être restitué au centre, pour être réalloué là où la demande de fonds d’investissement est plus forte15.
Les collectivités sont ainsi incitées à chercher des occasions d’investissements nouveaux, comme à conserver les fonds qui leur sont alloués. Les banques sont stimulées de la même façon. On peut ainsi raisonnablement s’attendre à ce que les collectivités et leurs banques mettent en place des départements de promotion, organismes qui surveillent les bonnes occasions à saisir, et fournissent des services de conseil technique et financier aux entreprises à l’affût de bonnes occasions et aux individus désireux de créer des coopératives, en les aidant avec des études de marché, des plans d’investissement, etc. Ces organismes pourraient aller jusqu’à recruter des dirigeants et des travailleurs pour de nouvelles entreprises (la Caisse Populaire du Travail de Mondragon a un département de ce type, ce qui constitue une autre de ses innovations réussies).
On voit désormais quelles seraient les grandes lignes d’un contrôle social sur l’investissement. En bref, le gouvernement central collecte le produit des taxes sur les actifs en capital et les distribue à travers un réseau de banques locales, qui dispensent ces fonds (certains devant servir à encourager telle ou telle sorte de projets) aux entreprises qui leur sont affiliées et à de nouvelles entreprises de manière à optimiser la profitabilité de ces entreprises et de leur personnel. Nous sommes donc en présence d’un réseau de coopératives à la Mondragon (ou, si vous préférez, de mini-keiretsu) qui reçoivent leurs fonds pour des investissements nouveaux du Fonds public d’investissement.
Chaque banque peut accorder des dotations comme bon lui semble, appliquant la taxe standard la plupart du temps, mais accordant un taux réduit pour les projets à encourager. Ces dotations, une fois attribuées, ne doivent pas être restituées, mais viennent s’ajouter aux actifs en capital de l’entreprise, et par suite grossir la base de la taxe qu’elle verse16. La plupart des banques ont des divisions pour la promotion qui visent à renforcer l’expansion des entreprises ou la création de firmes nouvelles. (La Démocratie économique appelle, et même requiert, des «entrepreneurs socialistes», individus et collectivités désireux d’innover, de prendre des risques, dans l’espoir de produire de nouveaux biens et services, ou de les produire d’une autre façon. La critique a eu raison de souligner que de telles personnes sont importantes pour le bien-être d’une société et n’ont pas été suffisamment encouragées dans les économies socialistes existantes).
J’ai exposé avec quelque détail ce que j’estime être une forme économiquement viable et hautement désirable de socialisme. Il est important, surtout aujourd’hui, que les socialistes soient capables d’examiner et d’articuler une telle structure. Il doit être clair, pour nous et pour les autres, que le problème n’est pas de choisir entre le plan et le marché, mais d’intégrer ces deux institutions dans un champ démocratique. Il doit être clair aussi que la démocratie n’est pas uniquement une valeur politique, mais qu’elle a aussi de profondes implications économiques. La Démocratie économique n’est pas seulement plus démocratique que la démocratie du capitalisme, elle est également plus efficiente.
Je vais m’attacher à cette dernière affirmation, car c’est sous l’angle de l’efficience que le socialisme est le plus attaqué aujourd’hui. Je manque de place pour en faire la pleine démonstration, mais je voudrais au moins mettre en lumière l’argument de base et citer quelques faits importants17.
Parmi les formes variées d’inefficience économique, on peut distinguer les inefficiences en matière d’allocations, les inefficiences keynésiennes et les inefficiences organisationnelles («inefficiences X»).
Les inefficiences en matière d’allocations sont des diminutions du bien-être général résultant de ces défauts du marché qui font dévier les prix de ce qu’ils devraient être en régime de concurrence parfaite. Elles sont familières à quiconque connaît la théorie économique de base – surtout celles liées aux monopoles et aux «externalités».
Pour les mettre en évidence, on suppose habituellement que 1) la technologie est donnée, 2) il y a plein emploi des ressources matérielles et humaines dans l’ensemble de la société, et que 3) chaque entreprise peut transformer aisément ses intrants en extrants selon ses objectifs – c’est-à-dire qu’il n’y a point de gaspillage interne.
Les «inefficiences keynésiennes», elles, se réfèrent à ces écarts par rapport à l’optimum qui se manifestent quand les ressources matérielles et humaines ne sont pas pleinement mises en oeuvre, c’est-à-dire quand la deuxième condition n’est pas remplie. Les inefficiences X sont celles que la troisième condition excluait – à savoir les inefficiences internes à l’entreprise, résultant de sa structure propre18.
L’ordre de grandeur n’est pas le même pour chacune de ces trois formes d’inefficience. Vanek les compare à «des mouches, des lapins et des éléphants»19. La recension effectuée par Leibenstein des travaux empiriques établit que les inefficiences en matière d’allocations sont de l’ordre de 0,1% du PNB, alors que les inefficiences internes aux entreprises souvent dépassent les 50%. Tout en admettant que ces comparaisons posent des problèmes méthodologiques, il note que les inefficiences en matière d’allocations surtout doivent être de faible ampleur, parce que – sous les conditions définies – des prix plus élevés que les prix «normaux» dans un secteur de l’économie seront compensés par des prix plus bas dans les autres secteurs. Si nous ajoutons à ces considérations la gravité évidente du chômage qui affecte continuellement les économies capitalistes, la comparaison de Vanek semble judicieuse.
On peut s’attendre à ce que notre modèle retrouve quelques-uns des atouts du capitalisme en matière d’efficience. La Démocratie économique est elle aussi une économie de marché. Comme son protagoniste capitaliste, une entreprise autogérée cherche à faire du profit et à répondre aux préférences des consommateurs, et à utiliser ses matières premières et sa technologie de façon économe. Cependant le lecteur attentif peut se trouver embarrassé. Le «profit» dans la Démocratie économique n’est pas le même que le profit dans le capitalisme. Le travail compte comme un coût dans ce dernier, non dans la première. Cette différence n’aurait-elle pas des conséquences en matière d’efficience sur l’économie dans son ensemble?
L’impact de cette différence sur les inefficiences en matière d’allocations a été l’objet d’un important effort de recherche théorique consacré ces dernières années aux modèles autogestionnaires20. Mais si Vanek, Leibenstein et Horvat ont raison concernant leur ampleur relative (ce que je crois), alors ce débat représente une grande agitation pour bien peu de choses21.Je vais donc le négliger ici. Quelque importance que puissent avoir ces inefficiences (si elles en ont), leur impact sur l’économie serait vraisemblablement faible.
Le problème de l’inefficience keynésienne est plus sérieux, mais il faut noter que la Démocratie économique, du fait que son mécanisme d’investissement comporte des incitations spécifiques à la création d’emplois, répondra mieux au problème du chômage que l’économie capitaliste. Cette conclusion est renforcée par l’idée, émise depuis longtemps par Marx, et soigneusement ignorée ensuite par la théorie néoclassique, selon laquelle un capitalisme «bien portant» a fondamentalement besoin d’un volant de chômage pour discipliner la classe ouvrière. Une telle discipline est inutile dans la Démocratie économique (je vais très vite sur ce sujet important).
Je voudrais m’étendre davantage sur les inefficiences d’origine interne. Le modèle économique que nous étudions élargit la démocratie au lieu de travail. J’ai soutenu qu’une firme gérée démocratiquement dans un environnement marchand est incitée comme une entreprise capitaliste à satisfaire ses usagers et à utiliser efficacement sa technologie et ses ressources.
Mais, objecte-t-on fréquemment, une firme autogérée peut-elle faire aussi bien qu’une entreprise capitaliste? Les travailleurs sont-ils assez compétents pour prendre des décisions techniques et financières compliquées? Sont-ils assez compétents pour élire des représentants qui emploieront des managers performants? Je ne peux nier qu’il s’agisse là de vrais problèmes, mais je ne peux m’empêcher non plus de remarquer combien il est curieux que ces questions soient si promptement soulevées (comme mon expérience me le montre) dans une société qui s’enorgueillit de son engagement démocratique.
Nous trouvons généralement que les gens sont assez compétents pour choisir des maires, des gouverneurs et même des présidents. Nous estimons habituellement que les gens ordinaires sont capables de choisir des représentants qui décideront de leurs impôts, qui voteront des lois dont la violation les conduira en prison, qui peuvent même les envoyer au combat et à la mort. Pouvons-nous sérieusement nous demander si les gens ordinaires sont assez compétents pour élire leurs patrons?
Il faut pourtant se poser cette question. Un discours rhétorique ne peut passer pour un argument sur un problème aussi crucial. Après tout, les travailleurs dans les sociétés capitalistes démocratiques n’élisent pas leur patrons. Pourquoi ne le font-ils pas? Peut-être sont-ils si peu qualifiés pour le faire qu’il en résulterait un chaos économique, ou, pour le moins, une baisse abrupte de l’efficience.
Les gens ordinaires sont-ils assez compétents pour élire leurs patrons et pour participer à la gestion de leur entreprise? La question doit donc être posée. L’étonnant est que nous pouvons y répondre – de manière aussi nette qu’on peut le souhaiter, étant donné la complexité et l’étendue de ce problème. Il est difficile d’imaginer question éthico-économique plus importante qui ait reçu une réponse aussi décisive. A un degré rarement atteint dans les sciences sociales les faits sont clairs.
Procédons ici avec précaution, car l’enjeu est de taille. Il n’est pas nécessaire pour notre propos d’essayer d’isoler les effets en matière d’efficience interne des divers aspects de l’autogestion: le choix démocratique de la direction, le partage du profit, les formes de participation, etc. Ce qu’il nous faut, c’est montrer que ces éléments, lorsqu’ils sont combinés, ont peu de chances de conduire à une inefficience à l’intérieur de l’entreprise.
Plusieurs auteurs ont soulevé des questions sur l’efficience interne de l’autogestion, mettant l’accent notamment sur la répugnance des managers à s’engager à fond dès lors qu’ils doivent partager les profits avec les travailleurs, la répugnance de dirigeants élus à discipliner convenablement les travailleurs, le gaspillage de temps et d’effort lié au processus démocratique de prise de décision. Les faits leur donnent tort. Les données empiriques montrent fortement que le participation des travailleurs à la gestion et le partage du profit tendent à élever la productivité, et que les entreprises dirigées par les travailleurs sont souvent plus productives que leurs vis-à-vis capitalistes.
Sur les effets en matière d’efficience d’une plus grande participation des travailleurs, une étude menée en 1973 se conclut ainsi: «Dans aucun de nos exemples nous n’avons constaté qu’un accroissement de la participation des employés ait entraîné une baisse de la productivité»22. Neuf ans plus tard, passant en revue leur recension des études empiriques, Jones et Svejnar écrivaient: «II y a, semble-t-il, de solides raisons d’affirmer que la participation des travailleurs à la gestion entraîne une productivité supérieure.
Ce résultat est étayé par diverses approches méthodologiques, faisant appel à de nombreux faits et ceci pour plusieurs périodes de temps»23. En 1990, une recension d’articles édités par l’économiste de Princeton Alan Blinder élargit considérablement le champ empirique et aboutit aux mêmes conclusions. Levine et Tyson, par exemple, résument ainsi leur analyse de quelque quarante-trois études distinctes: «Notre revue d’ensemble de la littérature empirique sur l’économie, les relations industrielles, le comportement organisationnel et les autres sciences sociales conclut à ce que la participation conduit généralement à de petites et promptes améliorations dans les performances, et parfois à des améliorations significatives à long terme. Surtout elle n’a jamais d’effets négatifs»24. Ils tirent une autre conclusion. La participation conduit à des améliorations de productivité quand elle est combinée avec 1) le partage du profit, 2) une garantie de l’emploi à long terme, 3) une échelle des salaires relativement étroite, et 4) des droits garantis aux travailleurs (comme la restriction des motifs de licenciement).
Les entreprises dans la Démocratie économique tendent à remplir toutes ces conditions.
Quant à la viabilité d’une démocratie sur le lieu de travail, nous pouvons noter que les travailleurs dans les coopératives de contreplaqué du Pacific Northwest ont élu leurs dirigeants depuis les années quarante et les travailleurs des coopératives de Mondragon depuis les années soixante. Nous pouvons noter que vers 1981 il y avait 20 000 coopératives de production en Italie, y compris dans l’un des secteurs les plus actifs de l’économie25. Est-il besoin de le dire, toutes les entreprises autogérées n’ont pas réussi, mais je ne connais aucune étude empirique qui tende à montrer que les dirigeants élus par les travailleurs sont moins compétents que leurs homologues capitalistes. La plupart des comparaisons suggèrent le contraire. Elles trouvent que les entreprises autogérées sont plus productives que les entreprises capitalistes correspondantes. Nous avons déjà cité celles concernant Mondragon.
Voici ce que dit Berman à propos des coopératives de contreplaqué: «La base principale du succès des coopératives et du maintien en vie d’équipements capitalistiques non profitables a été une productivité du travail plus élevée. Les études comparant l’output en mètres cubes ont toujours montré un volume d’output plus élevé par heure, et les autres […] montrent une plus grande qualité du produit ainsi qu’une économie dans l’usage des matériaux 26.II y a aussi l’exemple récent de Weirton Steel, la plus grande entreprise coopérative des Etats-Unis. En 1982, après une année médiocre et face à des perspectives encore plus sombres, National Steel proposa de vendre Weirton, son usine de la Virginie de ]’Ouest, à ses 7 000 travailleurs. L’affaire fut conclue en 1984. Weirton parvint à afficher des profits pendant dix-huit trimestres consécutifs – à une époque où une grande partie de l’industrie connaissait des pertes sévères (deux des concurrents de Weirton ont fait faillite). «Weirton est la belle histoire des compagnies de l’acier», disait l’analyste John Tumazos de la firme Oppenheimer et Cie. «Au point de vue de la production et des coûts, Weirton l’emporta sur ses concurrents»27.
Mais la Yougoslavie ne constitue-t-elle pas un exemple négatif? Même Harold Lydall, peut-être le plus sévère critique pro-capitaliste du système économique yougoslave, ne soutient pas que l’incompétence des travailleurs dans le choix de leurs dirigeants ait été le problème. Comme nous l’avons vu, Lydall reconnaît que, pendant l’essentiel de la période qui va de 1950 à 1979, la Yougoslavie non seulement s’est maintenue, mais a prospéré.
Les choses ont changé, surtout dans le mauvais sens, dans les années quatre-vingts. Comment explique-t-il ce déclin précipité? «Il est certain que la cause principale de l’échec fut le refus du Parti yougoslave et du gouvernement de mettre en oeuvre une politique de restriction macroéconomique – particulièrement de restriction de l’offre de monnaie – combinée avec une politique microéconomique ayant pour but d’élargir les opportunités et de renforcer les stimulants concernant l’initiative et le travail efficace. Ce qu’il aurait fallu, c’était plus de liberté de décision pour les entreprises réellement autogérées au sein d’un marché libre, associée à un strict contrôle de la monnaie des ménages»28. Le problème en Yougoslavie ne semble pas résider dans un excès de démocratie sur le lieu de travail. Selon l’opinion d’un journal de Belgrade (résumée par Lydall), «l’explication la plus convaincante de l’actuelle crise sociale est la réduction des droits autogestionnaires des travailleurs»29.
Si nous y réfléchissons, il n’est pas surprenant que les entreprises autogérées soient plus efficientes. Puisque les revenus des travailleurs sont liés directement à la santé financière de leur entreprise, tous ont intérêt à se trouver de bons dirigeants. Puisque une mauvaise gestion n’est pas difficile à déceler pour ceux qui en sont les témoins immédiats (qui l’observent de très près et qui en ressentent rapidement les effets), il est improbable qu’ils tolèrent longtemps l’incompétence. De plus, chaque travailleur a intérêt à s’assurer que ses co-équipiers travaillent bien (et à ne pas apparaître comme un tire-au-flanc), en sorte qu’il faut moins de contrôle. Telles sont les conclusions de Henry Levin, étayées par sept années d’études de terrain: «II y a des stimulants à la fois individuels et collectifs qui ont toutes chances d’entraîner une productivité plus élevée. Les effets spécifiques de ces stimulants sont que les travailleurs des coopératives tendent à travailler plus dur et de manière plus flexible que dans les entreprises capitalistes; ils ont un taux de turnover et d’absentéisme plus bas; ils prennent davantage soin des installations et des équipements. En outre, les coopératives de production fonctionnent avec relativement peu de travailleurs non qualifiés et de cadres moyens, connaissent moins de goulets d’étranglement dans la production et ont des programmes de formation plus efficients que les entreprises capitalistes»30.
Mon intention n’est pas de suggérer que la démocratie sur le lieu de travail est la panacée pour tous les maux de l’économie. Les gains d’efficience ne sont pas toujours spectaculaires. Toutes les coopératives ne réussissent pas. L’échec est souvent douloureux, comme l’échec des entreprises capitalistes – et pas seulement pour leurs propriétaires. Mais il me semble que les faits démontrent que les entreprises autogérées sont au moins aussi efficientes, sur le plan interne, que les entreprises capitalistes. En fait, les travaux cités établissent plus que cette conclusion minimale. Je ne vois pas comment quiconque passant en revue la littérature sur le sujet pourrait douter que, à conditions égales par ailleurs, les entreprises autogérées ont tendance à être plus efficientes, dans leur fonctionnement interne, que les entreprises capitalistes.
J’ai dessiné, en y ajoutant quelques détails, la forme générale de l’argumentation selon laquelle la Démocratie économique est une forme efficiente de socialisme, plus efficiente en fait que le capitalisme. Mais l’efficience est loin d’être sa seule force. Une analyse attentive et honnête montrerait que la Démocratie économique est moins pénétrée que le capitalisme par la manie de la croissance – et pas suite plus adaptée à un monde qui doit faire face aux limites écologiques -, plus démocratique et plus égalitaire.
Je pense qu’on peut aussi montrer, ce que je n’essaierai pas de faire ici, que la Démocratie économique s’accorde mieux avec les valeurs sous-jacentes, fondatrices, d’un socialisme marxien émancipateur que toutes les autres formes de socialisme existantes ou proposées. De plus, si nous restons dans la perspective (comme Marx nous y invite) d’institutions nouvelles se formant lentement dans les entrailles de la veille société, je pense que les institutions de la Démocratie économique sont de celles-là.
Si le socialisme doit être l’avenir de l’humanité (une conclusion qui ne doit en aucune façon être anticipée), elle est un avenir dont nous pouvons faire le projet de façon réaliste et pour lequel nous pouvons combattre la tête haute.
Notes
1.* Communication présentée à la Conférence on market socialism (Berkeley, Californie, 1991) sous le titre «Economic Democracy. A Worthy Socialism that Would Really Work».
** [Le début de cette communication; omis ici, est pour l’essentiel une analyse de ces trois expériences – NDLR].
3. Dans un travail précédent, Capitalism or Worker Control? (New York, Praeger, 1980), j’ai désigné le modèle de base par les termes de « contrôle ouvrier ». J’ai décidé d’en utiliser d’autres ici, d’une part pour souligner la nature démocratique du modèle, d’autre part parce que j’ai réalisé que le modèle renforce les trois rôles que chaque individu est amené à jouer: celui de travailleur bien sûr, mais aussi celui de consommateur et celui de citoyen.
4. J’évoque ici l’un de ces très importants problèmes qui recevront moins d’attention qu’ils n’en méritent. Marx a sûrement raison de considérer que les structures politiques, éducatives, culturelles et les autres structures sociales ne peuvent être séparées de l’économie d’une société (si elles ne sont pas déterminées par l’économie, au moins doivent-elles être harmonisées avec elle). II s’ensuit qu’une économie tout à fait différente du capitalisme doit avoir aussi des formes politiques et culturelles différentes. Le modèle que je propose n’est pas différent au point de suggérer des structures politiques (ou éducatives ou culturelles) complètement différentes de celles que nous connaissons, mais un modèle accompli de société socialiste démocratique qui devrait comporter des réformes fondées sur les valeurs démocratiques et égalitaires postulées par la Démocratie économique.
5. On pourrait choisir – au niveau de la collectivité, de la région ou de la nation d’imposer certaines restrictions à la distribution des revenus. On pourrait décider que le différentiel de revenu entre la plus haute et la plus basse rémunération à l’intérieur de toutes les entreprises n’excède pas un certain ratio (à Mondragon le rapport fut pendant de nombreuses années de 1 à 3; mais il a été récemment porté de 1 à 6 – pour empêcher les meilleurs travailleurs d’être attirés par les entreprises capitalistes). Il faudrait probablement décider que le revenu ne peut descendre au-dessous d’un minimum. Il pourrait être souhaitable d’avoir une grille officielle des salaires fixant des rétributions égales pour des qualifications comparables, avec des suppléments de revenu dépendant de la rentabilité des entreprises. (Ceci se rapprocherait de la pratique des coopératives de Mondragon, qui paient des salaires à des taux comparables aux taux des entreprises capitalistes de la région, et distribuent une part des profits de l’entreprise à chaque membre selon son apport en capital, et de la pratique japonaise consistant à donner aux travailleurs d’une firme des primes semestrielles basées sur le succès de celle-ci).
6. Le système d’élection indirecte en usage à Mondragon est probablement optimal pour la plupart des entreprises – un conseil des travailleurs élu qui appointe la direction. Ce qui doit être optimisé, c’est l’équilibre entre le fait d’avoir des comptes à rendre et l’autorité. Les dirigeants doivent avoir suffisamment d’autorité pour diriger effectivement, mais pas assez pour exploiter la main d’oeuvre à leur propre avantage. (Chacun de ces facteurs est de la plus haute importance. Les socialistes démocrates ne doivent pas minimiser l’importance des structures et des relations qui permettent aux talents gestionnaires de s’épanouir. La crainte justifiée d’un élitisme managérial ne doit pas rendre aveugle aux réelles frustrations et aux inefficiences qui résulteraient d’une limitation excessive des prérogatives managériales).
7. Cf. HORVAT, Yougoslav Economic System, p. 218 sq., pour une revue des différentes politiques d’investissement essayées en Yougoslavie au long des années. Dans la première phase de la transition vers une pleine économie de marché, le gouvernement yougoslave contrôlait les investissements, mais cette politique fut abandonnée dans un contexte d’opposition générale à toutes les formes d’intervention étatique. Au début des années soixante-dix, on peut dire que «sous plusieurs aspects importants […] la Yougoslavie présentait plus de ressemblances avec le type d’économie libérale préconisé par Adam Smith qu’avec n’importe quel pays d’Europe de l’Ouest» (David GRANICK, Entreprise Guidance in Eastern Europe, Princeton, Princeton University Press, 1975, p. 25). Par opposition, la plus grande partie de l’investissement au Japon est médiée par des organismes gouvernementaux (notamment le ministère des Finances et le MITI), tandis qu’à Mondragon l’investissement est soigneusement supervisé et planifié par la Caisse Populaire du Travail. Dans les deux cas, des buts autres que ceux de la maximisation du profit reçoivent la priorité.
8. «L’usage le plus haï de l’enrichissement, et ce à juste titre, est l’usure, qui tire un gain de l’argent lui-même et non de son objet naturel. Car l’argent devait servir à l’échange, et non grossir avec l’intérêt» (ARISTOTE, La Politique, 1258 b 2-5). La Démocratie économique partage ce jugement. Il pourrait exister des institutions pour conserver à l’épargne des individus sa valeur, en l’indexant sur le taux de l’inflation, et pour leur faire des prêts (contre une commission pour le service rendu et avec remboursement indexé), mais, en séparant l’épargne de l’investissement, l’intérêt devient inutile.
Il faut noter cependant que le paiement de modestes intérêts à des particuliers ne constituerait probablement pas, dans la Démocratie économique, une source importante d’inégalités (c’était là la principale objection éthique). Quoique d’autres dispositions, théoriquement plus satisfaisantes, soient possibles, des prêts à la consommation et un secteur locatif pourraient très bien être pris en charge par des coopératives de crédit, soumises à réglementation, qui paieraient un intérêt modeste à leurs épargnants, alors qu’ailleurs ils toucheraient un intérêt plus élevé.
9. Dans ce modèle, le fonds d’amortissement est déterminé par la loi, mais contrôlé par les entreprises. Il peut être dépensé pour toute amélioration du capital qui paraît souhaitable à l’entreprise, et, quand il est dépensé de la sorte, il est considéré comme un investissement « courant ». Cette dépense doit être distinguée de l’investissement «nouveau», qui est financé par la banque – et par suite soumis à toutes sortes de conditions négociables. Cette distinction entre l’investissement courant et le nouvel investissement est une manière quelque peu arbitraire de donner aux entreprises quelque contrôle sur leur politique d’investissement, mais pas au point de faire naître une instabilité au niveau macro-économique.
10. Je ne veux pas discuter ici des mesures négatives, parce qu’elles ne font pas particulièrement problème et ne sont pas inconnues. Si la nation (ou la région ou la collectivité locale) souhaite interdire ou décourager la production ou l’usage de tel ou tel produit, si elle veut établir des normes concernant l’usage de certaines technologies, les mesures appropriées seront soumises à l’instance législative appropriée, des audits auront lieu, et des votes interviendront. Si cette instance ne fait pas ce qu’on attend d’elle, il est possible de recourir au référendum. II paraît clair qu’une société socialiste démocratique devrait se servir de toute la panoplie des mécanismes politiques dont on dispose habituellement, en les modifiant et en les complétant de manière à rendre le processus politique plus conforme aux attentes populaires.
11. Je propose ici une distribution égalitaire. Une alternative moins égalitaire consisterait à rendre à chaque région la portion du fonds d’investissement (moins les déductions nationales) qui provient d’elle. Cette alternative tendrait à exacerber, bien plus qu’à atténuer, les disparités entre les régions. Une autre proposition, peut-être la plus séduisante sur les plans économique et éthique, serait d’attribuer les fonds «selon les besoins», ceux-ci résultant d’un arbitrage entre les niveaux de revenus, les besoins des entreprises et les priorités nationales. Dans mon modèle j’opterai pour la distribution égalitaire, surtout à cause de sa simplicité. J’imagine que dans la pratique une distribution décidée démocratiquement serait moins égalitaire que celle que je propose, mais plus égalitaire que si elle résultait des contributions.
12. Si le gouvernement avait une parfaite connaissance de la demande, il pourrait simplement fixer la taxe appropriée, et le montant souhaité de l’investissement en découlerait (cf. John ROEMER, Ignacio ORTUNO-ORTIN et Joachim SILVESTRE, Market socialism, Davis, University of California, Department of Economics Working Papers, séries n° 355 et 356, 1990, pour la démonstration de cette proposition). Je suppose, de façon plus réaliste, que le gouvernement est moins certain du montant qu’il souhaite investir dans tel ou tel projet, en sorte qu’il se contente de fixer une limite au montant total et offre des stimulants aux entreprises pour qu’elles fassent ces investissements. Les montants et les stimulants seraient réajustés l’année suivante, selon les résultats.
13. La Caisse Populaire du Travail a un Conseil d’administration de douze membres : quatre représentants de ses travailleurs et huit représentants de la centaine d’entreprises qui sont affiliées à la banque. Comme le fonds de la Caisse ne provient pas d’une taxation, on n’a pas ressenti la nécessité d’adjoindre des représentants de la collectivité locale.
14. Il ne s’agit pas de suggérer que des emplois pourraient être créés dans la région s’ils ne sont source d’aucun profit. Les banques seraient pénalisées si elles n’attribuaient pas judicieusement leurs dotations. Mais la maximisation du profit ne serait pas davantage le seul critère. Si deux projets demandent un égal investissement en capital nouveau, celui qui procure plus d’emplois devrait être favorisé. La preuve que les deux objectifs – le profitabilité et la création d’emplois – ne sont pas irrémédiablement contradictoires nous est fournie par la Caisse Populaire du Travail, qui a fait de la création d’emplois, depuis le début, un de ses objectifs centraux.
15. Un stimulant bien simple pour arriver au résultat voulu serait d’imposer aux collectivités une taxe d’usage pour les fonds qui leur sont alloués, de laquelle seraient déduits les revenus de la taxe d’investissement collectée auprès des entreprises de leur zone. Une collectivité serait ainsi pénalisée si elle gardait des fonds par devers elle ou attribuait des dotations de manière improductive.
16. D’un point de vue économique, la distinction entre une taxe sur l’usage et un intérêt n’implique aucune différence, mais leur signification socio-psychologique n’est pas du tout la même. II me semble que la conception du paiement comme taxe d’usage destinée au fonds d’investissement et non comme intérêt rend plus transparent le fait qu’oh paie pour avoir accès à la propriété créée par d’autres, et que ce paiement sera remis en jeu pour que d’autres puissent avoir le même accès. En dehors de cette considération – qui peut être en fait mineure -je ne vois pas d’objection de principe à ce que la taxe d’usage soit appelée intérêt.
17. Pour un traitement plus approfondi de cette question, et pour une analyse de toute une série d’autres problèmes concernant ce modèle, cf. D. SCHWEICKART, Against capitalism: An Ethico-Economic Comparative-Systems Critique, Cambridge, Cambridge University Press, à paraître.
18. L’expression «X-Efficiency» fut proposée par Harvey LEIBENSTEIN dans son article souvent cité: «Allocative Efficiency Vs « X-Efficiency »», American Economic Review, n° 56, juin 1966, p. 392-415. Ses idées furent ensuite développées dans son livre Beyond Economic Man: A New Foundation for Microeconomics (Cambridge MA, Cambridge University Press, 1976) et dans Inside the Firm: The Ineffciencies of Hierarchy (Cambridge MA, Harvard University Press, 1987).
19. Jaroslav VANEK, Crisis and Reform: East and West, Ithaca, 1989, p. 93.
20. Des modèles formels d’autogestion, se servant des catégories néo-classiques standard, ont connu une forte expansion pendant la dernière décennie (cf., pour une large recension, John BONIN et Louis PUTTERNAM, «Economies of Cooperation and the Labour-Managed Economy», in Jacques Lesourne et H. Sonnenshein dir., Fundamentals of Pure and Applied Economics). Répondant aux analyses de Ward et Domar, Jaroslav VANEK, dans sa vaste étude The general Theory of Labour-Managed Market Economies (Ithaca NY, Cornell University Press, 1970), a fourni une soigneuse démonstration de la proposition selon laquelle, sous des hypothèses appropriées, une économie autogérée était optimale au sens de Pareto. Depuis la publication de son oeuvre, de nombreux économistes néoclassiques ont essayé de montrer q’une telle économie n’était pas efficiente, pendant que d’autres ont fabriqué des modèles pour montrer le contraire. A ce niveau d’abstraction, le problème semble maintenant réglé. Jacques DRÈZE, dans son livre Labour Management, Contracts and Capital Markets (Oxford, Basil Blackwell, 1989) conduit une analyse en termes d’équilibre général qui «établit sans équivoque la compatibilité de l’autogestion avec l’efficience économique» (p. 25).
21. Les premiers critiques de l’autogestion insistent sur quelque chose d’important, qui ne peut être traité à la légère. Il y a de bonnes raisons de penser (même si ce ne sont pas exactement celles que les critiques ont mis en avant) qu’une entreprise autogérée ne se comportera pas comme une entreprise capitaliste dans certaines circonstances. Plus précisément, dans des conditions plutôt normales, elle n’aura pas la même tendance spontanée à l’expansion. Cette différence toutefois, loin de jouer contre la Démocratie économique, est une raison importante de sa supériorité sur le capitalisme (mon ouvrage, Against Capitalism, op. cit., discute largement ce problème).
22. UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION AND WELFARE, Work in America, Cambridge MA, MIT Press, 1973, p. 112.
23. Derek JONES et Jan SVEJNAR dir., Participatory and Self-Managed Firms: Evaluating Economic Performance, Lexington MA, D.C. Heath, 1982, p. 11.
24. David LEVINE et Laura D’ANDREA TYSON, «Participation, Productivity and the Firm’s Environment», in Paying for Productivity : A Look at the Evidence, Alan Blinder dit., WashingtonDC, The Brookings Institution, 1990, p. 203-204.
25. Sur les coopératives de contreplaqué, cf. Katrina BERMAN, «A Cooperative Model for Worker Management», in Frank STEPHEN dir., The Performance of Labour-Managed Firms, New York, St. Martin’s Press, 1982, p. 74-98. Sur les coopératives italiennes, cf. Saul ESTRIN, Derek JONES et Jan SVEDNAR, «The Productivity Effects or Worker Participation in Producer Cooperatives in Western Economies», Journal of Comparative Economics, 1987, p. 40-61.
26. BERMAN, «A Co-operative Model…», loc. cit., p. 80. Sur la difficulté de faire de telles comparaisons, cf. Henry LEVIN, « Issues in Assessing the Comparative Productivity of Worked-Managed Firms in Capitalist Societies », in Participatory and Self-Managed Firms, Jones et Svejnar dit., p. 45-64.
27. Steven GREENHOUSE, «Employees Make a Go of Weirton», New York Times, 6 janvier 1985, et William SERRIN, «Success Story in Steel Town: Sharing Profits», New York Times, 15 mars 1986. Cf. aussi J. Ernest BEAZLEY, «Employees-Owned Weirton Steel Mulls Public Stock Offering Later This Year», Wall Street Journal, 23 juin 1988, p. 43.
28. Harold LYDALL, Yougoslavia in Crisis, Oxford, Clarendon University Press, 1989, p. 69. Lydall soutient que les réformes du milieu des années soixante-dix constituaient une «contre-réforme» pour affaiblir le pouvoir des managers et donner plus de pouvoir aux politiciens du Parti. En Yougoslavie, à la fin des années quatre-vingts, «alors que la doctrine officielle» était «que les travailleurs, à travers leurs représentants au Conseil ouvrier, choisissent leur directeur, en pratique la plupart des directeurs, particulièrement ceux des grandes ou moyennes entreprises», étaient «choisis par les politiciens locaux» (ibidem, p. 112).
29. Ibidem, p. 96. C’est moi qui souligne.
30. Henry LEVIN, «Employment and Productivity of Producer Cooperatives», in Worker Cooperatives in America, Robert Jackall et Henry Levin dir., Berkeley, University of California Press, 1984, p. 28.