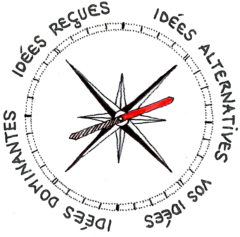Extrait tiré de Thomas Coutrot, «Jalons vers un monde possible», Le bord de l’eau, 2010.
Le marché et ses vices
Les marchés sont bien antérieurs au capitalisme, ils lui survivront très certainement. Il faut distinguer «économie avec marchés» et «économie de marché». Une économie où existent des échanges marchands n’est pas nécessairement dominée par les «forces du marché». Il en va du marché en économie comme de la représentation en politique: c’est un mal nécessaire. L’important n’est pas d’essayer de l’éliminer, mais de le soumettre au contrôle de la société civile – de le socialiser.
J’en veux pour preuve l’extrême difficulté à théoriser sérieusement une économie démocratique sans marchés. Michael Albert, un économiste marxiste étatsunien, a tenté de façon ingénieuse d’imaginer une planification démocratique de l’économie qui se dispense complètement des mécanismes marchands. Son Économie participative décrit de façon détaillée l’utopie d’une économie démocratique sans marché.
Albert part d’une vigoureuse critique du marché, qui reprend les arguments traditionnels des opposants à ce mode de coordination économique. On peut distinguer quatre familles d’arguments: le marché est irrationnel, injuste, antisocial et antidémocratique.
Irrationnel d’abord : dans une économie marchande, les producteurs décident d’investir et de produire sans savoir si leurs produits ou leurs services rencontreront une demande solvable. Le marché ne sanctionne qu’à posteriori les décisions d’investissement et de production : les consommateurs peuvent ne pas vouloir des produits offerts, ou bien ne pas avoir les moyens de les acheter. Les crises de surproduction ou de pénurie sont donc inévitables, comme l’atteste toute l’histoire du capitalisme jusqu’à aujourd’hui. Il en résulte un gigantesque gâchis économique et humain.
Injuste ensuite: le marché oriente les décisions des investisseurs non pas en fonction des besoins sociaux les plus urgents, mais des besoins des catégories sociales solvables. L’objectif des producteurs est le profit et pas la production de richesses utiles ; la valeur d’échange et non pas la valeur d’usage. On préfère produire des 4×4 et des gadgets inutiles pour les riches plutôt que des logements ou des aliments pour les pauvres. L’opulence scandaleuse d’une petite minorité coexiste avec une disette qui touche un milliard de personnes dans le monde.
Antisocial, également : le marché fonctionne sur la base de la concurrence, qui avive l’individualisme et mine la coopération sociale. L’homo œconomicus, l’agent économiquement rationnel de la théorie libérale, est un individu amoral et sans scrupule, qui n’agit qu’en fonction de son intérêt égoïste. Le néolibéralisme a poussé à l’extrême l’exaltation de cette attitude cynique. L’opportunisme et la corruption gagnent les sphères de la culture, de la politique, de l’intimité… Depuis longtemps on pouvait acheter des hommes politiques ou des services sexuels, mais c’est l’ère néolibérale qui permet d’acquérir sur Internet des organes humains, des épouses russes, des bébés haïtiens ou des amis branchés.
Antidémocratique, enfin: le marché empêche la délibération collective des priorités. Ses lois s’imposent aux collectivités nationales ou locales. Un gouvernement qui voudrait imiter les droits des investisseurs ou fixer le prix des aliments ou des matières premières se heurterait à la fuite des capitaux et à la pénurie organisée, et devrait faire machine arrière.
Bref, selon Albert, le marché est un mécanisme aveugle, anonyme et inefficace, incompatible avec la justice, la solidarité et la démocratie. Pour autant, Albert n’ignore rien des échecs de la planification centralisée expérimentée dans de nombreux pays dits socialistes au XXe siècle. Ces échecs ne proviennent pas seulement ni même principalement des circonstances défavorables dans lesquelles se sont déroulées les expériences socialistes (arriération économique, absence de culture démocratique…). Ils renvoient, toujours selon Albert et de nombreux spécialistes des économies du « socialisme réel », à des failles structurelles du modèle théorique de la planification centralisée : l’inefficacité et la domination bureaucratique. L’inefficacité d’abord: les producteurs à la base n’ont pas de raisons de produire en économisant les ressources ni en innovant. Ils doivent certes atteindre les objectifs fixés par le planificateur, mais ils déterminent eux-mêmes en grande partie ces objectifs, en manipulant l’information qu’ils transmettent au Plan concernant leurs capacités de production. L’irresponsabilité généralisée à la base favorise un gaspillage considérable de ressources.
La domination bureaucratique, elle, résulte inévitablement de la concentration du pouvoir dans l’organisme central de planification et de coordination. Bref, avec la planification centralisée, l’oppression inefficace de l’État ne fait que remplacer l’oppression injuste du capital.
Ces critiques du marché et du plan centralisé sont sans aucun doute pertinentes. La supériorité historique du capitalisme sur la planification centralisée tient essentiellement au fait qu’il a dû s’accommoder des libertés démocratiques et du pluralisme politique. Après 1945, obligé de prendre en compte les luttes sociales, le capitalisme a pu éviter un temps de suivre sa pente naturelle, celle de la concentration illimitée des revenus et des pouvoirs. Faute de contre-pouvoirs, le « socialisme » bureaucratique s’est quant à lui enlisé dans sa médiocrité.
Abolir le marché ?
Si l’on peut suivre Albert dans ses critiques du marché et du plan centralisé, le bât blesse au moment de décrire l’alternative qu’il propose, une économie prétendument sans marchés – et même sans monnaie – ni centralisme bureaucratique. Son économie participative repose sur des conseils locaux de consommateurs, qui une fois par an votent pour déterminer leurs besoins de toutes sortes. Ils communiquent au Bureau central du plan, par Internet, la liste des biens et services qu’ils souhaitent pour l’année à venir. De même les entreprises coopératives communiquent au Bureau central du plan leurs capacités de production des différents biens et services. Le Bureau central compare la demande et l’offre; les objectifs de production et d’investissement résultent d’un jeu itératif avec des prix fictifs, équilibrant au final l’offre et la demande (vive Internet !). Le Bureau central du plan fait les calculs, transmet les résultats aux unités de production qui n’ont plus qu’à produire et à envoyer les biens demandés aux conseils de consommateurs. Ceux-ci répartissent les biens entre les habitants en fonction de l’effort au travail fourni par chacun (effort évalué par les collègues et voisins), de façon à maintenir une incitation à la productivité. Les travaux pénibles font l’objet d’une rotation systématique entre les citoyens, de façon à éviter l’accumulation du prestige et du pouvoir aux mains de certains, et des nuisances sur le dos des autres.
Selon Albert, dans ce mode de coordination, le Bureau central n’a aucun pouvoir mais un rôle purement technique, celui de centraliser l’information, de faire les calculs et de répercuter les résultats. En réalité, quoi qu’il en dise, son économie participative n’est qu’un relookage d’une ancienne proposition, faite par l’économiste marxiste polonais Oscar Lange en 1936, alors fortement contestée (dans la célèbre « controverse du calcul socialiste ») par le théoricien du néolibéralisme, Friedrich von Hayek. Ce dernier dénonçait la lourdeur du projet de Lange, son caractère bureaucratique, l’absence d’incitation à l’efficacité productive. Les développements récents de « l’économie de l’information », attachés notamment au nom de Joseph Stiglitz, confirment qu’Hayek n’avait pas tort, pour trois raisons principales.
Tout d’abord l’asymétrie de l’information: les acteurs économiques locaux n’ont aucun intérêt à révéler gratuitement au Bureau du plan l’information qu’ils détiennent (coûts, productivité…). Ils ont au contraire intérêt à sous-évaluer systématiquement leurs capacités de production de façon à pouvoir se la couler douce.
Ensuite la rigidité : alors que les goûts, les technologies, les opportunités changent sans cesse, la planification « décentralisée », surtout avec le lourd caractère collectiviste des choix de consommation, risque fort de ne pas satisfaire les individus et de voir se développer des marchés parallèles.
Le caractère tacite de l’information, enfin: les informations pertinentes sur le meilleur usage des ressources résultent souvent de l’expérience informelle accumulée localement. La formalisation exigée par le plan – il faut que les producteurs explicitent avec précision leurs capacités et leur choix de production sous diverses hypothèses de prix des inputs – serait dans beaucoup de cas trop coûteuse.
En réalité, la planification décentralisée sans marché ni monnaie n’est pas compatible avec l’idéal démocratique qu’elle prétend incarner. Elle mise exagérément sur l’émergence de «l’homme nouveau», qui livrerait en toute transparence, dans l’intérêt de la société, les informations stratégiques dont il dispose.
Elle parie abusivement sur la passion démocratique : il faudrait voter pour choisir le nombre et la couleur des paires de chaussettes, et le niveau de consommation de chaque membre du conseil de consommateurs… On risque bien plutôt de discréditer ainsi la démocratie. Enfin, la coordination «décentralisé » repose malgré tout sur un calcul centralisé par un organisme public, aussi bien pour le calcul des objectifs de production et d’investissement que pour la répartition des biens produits. On sait qu’il y a là une source quasi-inévitable de pouvoir bureaucratique.
Au bout du compte, l’utopie de l’économie participative aboutit malgré elle à démontrer qu’avec tous leurs défauts, les marchés demeurent une condition de la liberté de choix individuel, de la diversité des modes de vie possibles. Le marché n’est pas le diable, mais une construction humaine, une institution économique et sociale, qui peut être construite socialement de bien des manières différentes. Qu’y a- t-il de commun entre le petit marché bio de Brive- la-Gaillarde et le Chicago Board Options Exchange, haut lieu de la spéculation sur les produits financiers les plus sophistiqués? Certes, dans les deux cas on trouve des acheteurs, des vendeurs et des prix. Mais les dynamiques sociales et environnementales, les enjeux de pouvoir sous-jacents, les conséquences sur le mode de développement, n’ont strictement aucun rapport.