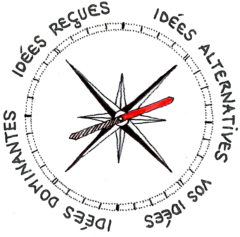Thomas Coutrot
Les Possibles — No. 17, Été 2018.
Remettre en chantier l’imaginaire de la transformation sociale: voilà la tâche urgente à laquelle Benoît Borrits apporte une contribution précieuse en nous proposant de nous projeter « au-delà de la propriété ». Disons-le d’emblée : même si ses propositions méritent d’être plus creusées, leur audace nous incite à la créativité théorique et institutionnelle, loin des attitudes nostalgiques qui irriguent souvent le débat stratégique à gauche. L’ouvrage s’inscrit dans la lignée théorique des communs, tout en l’arrimant fort utilement à l’histoire des débats, peu pris en charge en France, sur la propriété sociale non étatique. Pour faire vivre ce débat si nécessaire, j’ai choisi ici d’entremêler la présentation des principales thèses de l’ouvrage et leur critique.
Critique de la propriété
Dès la préface, Pierre Dardot résume la thèse principale de l’ouvrage : « tant qu’on n’en aura pas fini avec la propriété productive en tant que telle, la démocratie sociale et politique ne sera qu’un vain mot » (p. 11). En parcourant toute l’histoire des débats sur la propriété dans la gauche depuis Proudhon et Marx, Benoît Borrits montre l’échec de la propriété collective, que ce soit sous sa forme étatique ou coopérative. L’expérience historique, à la fois du soviétisme, des nationalisations et du mouvement coopératif, démontre que le propriétaire collectif « ne peut s’incarner que dans une élite qui tend inévitablement à reproduire les rapports d’exploitation » (p. 17).
La critique de la propriété privée fait partie du bagage commun de la gauche, et celle, plus récente, de la propriété publique – avec ses dérives bureaucratiques ou néolibérales – est elle aussi bien connue. Pour le dire dans les termes de Dardot et Laval, « la prétendue ‘réalisation’ du commun sous la forme de la propriété d’État ne peut rien être d’autre que la destruction du commun par l’État »[1]. Benoît Borrits le dit autrement : « en devenant propriétaire des moyens de production, l’État, et donc la couche sociale qui le contrôle, se comporte toujours en propriétaire en monopolisant la fonction de décision » ; même s’il prétend « associer les travailleurs et les usagers à la gestion, l’État restera toujours décideur en dernier ressort » (p. 128).
L’apport de Benoît Borrits, fin connaisseur du mouvement coopératif auquel il consacre un chapitre éclairant, concerne surtout la critique de la propriété coopérative. Celle-ci « ne remet pas en cause le fondement du capital » (p. 42), car « même géré différemment, le capital de la coopérative reste celui de ses membres et aucunement la propriété collective d’une classe ou de l’ensemble de la population » (p. 43). Les règles du coopérativisme (en particulier l’élection démocratique des dirigeants et le caractère impartageables des réserves) donnent certes un rôle second au capital. Mais ce rôle devient bloquant en cas de succès économique, les coopérateurs répugnant à ouvrir le sociétariat à de nouveaux membres au risque de diluer leur patrimoine collectif. L’expérience de Mondragon, la grande success story de la coopérative de production, le confirme suffisamment, qui ne propose pas le statut de coopérateur aux travailleurs des firmes qu’elle absorbe.
Si les coopératives tendent à « reproduire les rapports d’exploitation », peut-on pour autant en attribuer toute la responsabilité à l’existence d’une propriété, fût-elle collective ? Il me semble que Benoît Borrits néglige le poids de la hiérarchie et du pouvoir dans l’organisation du travail, que le mouvement coopératif ne remet aucunement en question. En imitant la démocratie parlementaire par l’élection des compétents qui commanderont ensuite à la masse, les coopératives se privent de contester la coupure entre travail de conception et travail d’exécution et donc d’avancer vers une réelle démocratie productive. Je reviendrai en conclusion sur cette impasse que fait Benoît Borrits sur les rapports de production.
La propriété : à démembrer ou à dépasser?
Mais si la propriété des moyens de production, sous ses formes privée, étatique ou coopérative, n’est pas compatible avec une démocratisation de l’économie, comment faire ? Le débat n’est pas nouveau, même s’il a connu de longues éclipses. En 1947[2], le communiste conseilliste Anton Pannekoek proposait la « propriété commune » contre la conception, alors dominante à gauche, de la « propriété publique » : « cette propriété commune ne signifie pas propriété au sens ancien du mot, c’est-à-dire le droit d’en user et d’en mésuser selon sa propre volonté », mais elle « demande la direction commune du travail ainsi que l’activité productive commune ». Pannekoek anticipait ainsi la proposition, rappelée également par Benoît Borrits, que formulait Rosanvallon en 1977, dans « L’âge de l’autogestion » : la « dépropriation », c’est-à-dire « l’éclatement et la redistribution des différents droits qui, regroupés, forment le droit classique de propriété (…) La socialisation redistribue les différents droits attachés à la propriété classique entre différentes instances (au niveau de l’entreprise, de la région, de l’État, des collectivités diverses) et ne les remet donc pas tous ensemble dans les mains du même agent collectif ».
Benoît Borrits rejette cette perspective: « en dépit de la radicalité apparente du terme de dépropriation, il n’y a aucune remise en cause de la propriété mais simplement un démembrement des droits de la propriété classique – usus, fructus, abusus – entre différents niveaux de décision. On voit mal dès lors comment vont s’articuler ces différents pouvoirs. On peut imaginer que les travailleurs disposeraient d’un droit d’usage sur le patrimoine d’une entreprise – usus – contre le versement d’une somme – fructus – au propriétaire qui ne serait plus l’État mais l’instance appropriée – commune, région, pays, groupe de pays. Cela signifie bien qu’on reconnaît à la collectivité le droit de conserver l’abusus. Dès lors, celle-ci reste capable de privatiser l’unité de production, perspective à laquelle Rosanvallon s’est montré très attaché dans les années qui ont suivi… » (pp. 118-119).
Notons que ce débat a resurgi récemment à propos des communs. Pour les uns, « si le commun est à instituer, il ne peut l’être que comme inappropriable, en aucun cas comme l’objet d’un droit de propriété »[3] ; pour les autres, les communs « consistent non en une négation des droits de propriété mais en des formes nouvelles de partage et de distribution des attributs de ce droit (sous la forme de droits d’accès, d’usage, de prélèvement …) entre différentes parties prenantes » (Coriat (dir.), La crise de l’idéologie propriétaire, présentation).
Au fond, Benoît Borrits réduit la propriété au droit d’abusus. Pour lui, dépasser la propriété ne veut évidemment pas dire supprimer le droit d’usus ni de fructus – même s’il faut redéfinir les acteurs qui vont exercer ces droits, non plus les actionnaires mais les salariés et les parties prenantes (consommateurs, usagers, etc.). Mais dépasser la propriété, c’est supprimer le droit d’abusus, c’est-à-dire le droit de valoriser, de vendre, voire de détruire le capital accumulé. Ainsi la propriété publique est condamnable parce qu’elle ne protège pas de la privatisation: l’État peut à tout moment décider de vendre ou de liquider ses actifs.
Coopératives multi-collèges : une fausse bonne idée ?
Mais comment éliminer la propriété, ainsi entendue au sens du droit d’une personne (physique ou morale) de disposer d’un bien comme bon lui semble au détriment du collectif et de la société ? Benoît Borrits aurait pu chercher du côté des règles coopérativistes, comme celle des réserves impartageables, qui supprime la possibilité pour les coopérateurs de revendre leurs parts pour en tirer une plus-value. Le droit d’abusus persiste mais est alors fortement restreint, réduit à la possibilité pour les coopérateurs de fermer l’entreprise et de récupérer leur mise initiale, ce qui quand même est très éloigné d’un fonctionnement capitaliste classique.
Et puisque le principal reproche fait à la propriété coopérative est l’égoïsme des coopérateurs – qui bénéficient du capital accumulé, les réserves impartageables, comme matelas de sécurité, et rechignent souvent à le partager avec de nouveaux entrants – Benoît Borrits aurait pu approfondir la piste du partage du pouvoir entre plusieurs collèges – producteurs, usagers, collectivités locales… – prévu par exemple dans le statut des SCIC (sociétés coopératives d’intérêt collectif) créé en France en 2002. Les salariés ne disposant pas de plus de 50%, ils ne peuvent pas imposer seuls leurs vues particulières.
Bizarrement, il écarte sans hésitation cette perspective. Certes, la coopérative multi-collèges, « en associant usagers et travailleurs dans la gestion commune d’une entreprise, permet un élargissement de la notion de service public au sens étymologique du terme : on ne produit plus pour mettre en valeur un capital, mais pour répondre à un besoin social, et l’ensemble des parties prenantes est impliqué dans ce processus ». Mais c’est insuffisant à ses yeux : « pour autant on peut être très sceptique sur un pouvoir partagé entre usagers et travailleurs sur la base d’un pourcentage défini statutairement. La règle des Scic françaises stipule qu’aucun collège ne détient plus de 50% des voix, ce qui impose aux salariés d’être minoritaires, voire parfois très minoritaires dans les décisions » (p. 40). L’auteur ne vient-il pas pourtant de nous dire que le problème de la coopérative de production est précisément que les travailleurs ne décident qu’en fonction de leur seul intérêt ?
Un autre argument est avancé contre la coopérative multi- collèges: c’est une « solution peu satisfaisante dans la mesure où les travailleurs et les usagers n’ont pas le même rapport à l’entreprise (…) le travailleur est certainement plus à même de définir la façon dont le travail doit être organisé, alors que l’usager s’intéressera plus à la qualité et au prix des produits » (p. 197). Mais n’est-ce pas précisément parce qu’ils n’ont pas le même rapport à l’entreprise que la confrontation entre parties prenantes dans un conseil d’administration multi-collèges est de nature à faire émerger un intérêt commun, compromis dynamique entre des perspectives différentes ?
Domestiquer le marché
Ayant écarté un peu légèrement la pluralité des collèges comme outil de « dépropriation », Benoît Borrits s’engage dans l’ébauche d’une solution beaucoup plus radicale, l’abolition de toute propriété. C’est tout sauf simple, car cela l’oblige à imaginer une transformation globale de l’économie dans une direction autogestionnaire non étatiste, fondée sur 1) une planification démocratique du volume des investissements, 2) une gouvernance des entreprises par les travailleurs sous la surveillance des usagers organisés en « conseils d’orientation », 3) un financement exclusivement bancaire, sans fonds propres, 4) un remplacement du droit de propriété par le droit d’usage, et 5) le recours au jeu des marchés pour l’activité économique courante. Il s’inscrit ainsi de façon créative dans le courant marxiste critique[4] qui, depuis la fin des années 1970, s’efforce de repenser des modèles de socialisme gestionnaire économiquement crédibles à la lumière de l’expérience du «socialisme réel » – autrement dit du stalinisme.
Pourquoi une économie autogestionnaire devrait-elle renoncer à abolir les marchés? Pour Benoît Borrits, l’histoire de la planification centralisée a montré que «le maintien des relations marchandes est indispensable si nous voulons permettre une certaine autonomie des travailleurs » (p. 143). Même une planification décentralisée, avec des projets de production élaborés par les travailleurs eux-mêmes et coordonnés de façon souple, lui semble irréaliste: «rien ne nous indique que les collectifs de travail parviendront spontanément à se mettre d’accord sur un plan qui se traduit par l’acceptation par chacun d’entre eux de produire une certaine quantité de produits prédéterminée » (p. 131).
Cela me semble fort juste[5]: le marché existait bien avant le capitalisme et existera bien après. La question pertinente n’est pas de l’abolir – ce qui pose d’insurmontables problèmes pratiques (impossibilité de voter sur toutes les décisions) et politiques (risque majeur de dérives bureaucratiques), mais de le socialiser, c’est-à-dire d’inscrire les décisions des acteurs du marché dans un contexte institutionnel qui soumette les décisions importantes à la délibération démocratique et empêche l’accumulation (privée ou publique) de richesses et de pouvoir.
Parmi les décisions les plus importantes, figure évidemment l’investissement. Aujourd’hui le volume et la destination des investissements sont décidés par les capitalistes dans le seul objectif du profit. Dans l’économie autogestionnaire proposée par Benoît Borrits, ces décisions sont prises, à un niveau national, sectoriel et régional, par le débat démocratique, et mises en œuvre par des « Fonds socialisés d’investissement » (de même niveau). Ces fonds sont financés par une « cotisation d’investissements » payée par les entreprises sur leur activité économique, et les ressources ainsi collectées sont attribuées aux banques, elles-mêmes autogérées, qui ont la charge de les distribuer sous la forme de crédits aux entreprises autogérées en arbitrant entre les projets concurrents qu’elles présentent. Cette cotisation est un « outil de transition destiné à constituer un capital socialisé des entreprises autogérées » (p. 148), elle peut être modulée au cours du temps en fonction du niveau global des besoins d’investissements nouveaux.
La répartition des tâches entre les fonds d’investissement et les banques est clairement établie: « le rôle des gestionnaires (du fonds d’investissements) sera de contrôler la réalisation des plans déterminés par les citoyens, alors que celui des banques sera de sélectionner les projets qui bénéficieront des financements » (p. 188). La banque « est responsable devant le fonds d’investissement des sommes qu’elle emprunte et de leur affectation » (p. 190) ; en cas de défaut de la banque, «les dépôts monétaires sont garantis par le FSI »: il s’agit donc d’une «solution mutualiste» et non étatiste (p. 192). Ce schéma institutionnel me semble assez convaincant ; il rejoint très largement la conceptualisation en termes de « planification participative» proposée par Pat Devine[6], qui prévoit elle aussi des fonds d’investissements, gestionnaires de ressources planifiées, articulés avec des entreprises autogérées en concurrence pour l’obtention des crédits.
L’accès contre la propriété ?
C’est dans ce cadre qu’on comprend ce que Benoît Borrits entend par abolition de la propriété: les entreprises n’ont pas de fonds propres (pas de capital social donc), mais se financent exclusivement par le crédit. « Le financement des entreprises socialisées par endettement intégral (…) permet d’envisager des entreprises sans fonds propres, lesquelles n’appartiendraient à personne en particulier mais seraient à la disposition de leurs usagers, travailleurs comme clients (…) il n’y aura aucune accumulation réalisée en propre (…) les décisions microéconomiques d’investissement seront prises entre l’unité de production et l’une des agences de crédit qui aura donné son accord à un projet de financement » (p. 176).
Non seulement les entreprises n’auraient pas de fonds propres, mais elles ne pourraient pas être propriétaires de leurs équipements ni de leurs bâtiments, du fait de l’obligation légale de recourir à une pratique déjà très répandue dans l’économie capitaliste actuelle, le leasing (location de longue durée). Benoît suggère même que le leasing pourrait devenir obligatoire pour les biens durables des ménages (équipement domestique, ordinateurs et portables, automobile…) de façon à éradiquer l’obsolescence programmée et à inciter les fabricants à la qualité et la durabilité de leurs produits.
Cependant, il ne traite pas de la question des actifs immatériels (qui représentent souvent près de la moitié de la valeur boursière des grands groupes) : si la réputation, la marque, la bonne organisation, la capacité d’innovation d’une entreprise la rendent capable de payer des hauts salaires, qu’est-ce qui empêchera les travailleurs de cette entreprise, même dans un système autogestionnaire, de faire payer cher un droit d’entrée aux candidats à l’embauche ?
Autre interrogation, si la propriété est remplacée par la location, c’est bien qu’il y a un bailleur. Mais comment le bailleur d’un immeuble ou d’une machine n’en serait-il pas le propriétaire ? N’est-ce pas – comme dans la misarchie de Dockès[7] – parce que son droit d’abusus est strictement réglementé, voire limité dans le temps ? Benoît cite l’exemple de la coopérative foncière Terre de Liens, qui « achète des terres agricoles afin de les soustraire définitivement à la spéculation foncière et de les dédier à l’agriculture biologique en les louant à des paysans » (p. 207). Mais Terre de Liens n’est-elle pas propriétaire des terres louées ? N’est-ce pas dans ses statuts qu’elle a décidé de s’interdire la spéculation foncière ? Autrement dit, plutôt que de prétendre dépasser la propriété, réduite de fait au seul droit d’abusus, mieux vaudrait partir d’une approche de la propriété comme « faisceau de droits », et se demander comment mener à bien la « dépropriation », c’est-à-dire la limitation du droit d’abusus et la répartition des différents droits entre différentes parties prenantes. Bref, instituer une propriété sociale plutôt qu’une non-propriété.
Une perspective libertaire non dogmatique
Ces remarques critiques n’invalident aucunement la réflexion menée, qui a le grand mérite de rester souple et ouverte : elle ne prétend imposer aucune solution « clé en main » mais cherche à construire les outils qui permettront aux choix démocratiques de s’exercer pleinement. « Il ne s’agit pas de « normer », de rendre obligatoires des formes juridiques précises, mais d’expérimenter, et la forme coopérative est un déjà-là, un institué qui nous permet d’avancer sur la voie de la rupture avec le capitalisme ».
Ainsi, ses réflexions sur la socialisation partielle des rémunérations sont particulièrement stimulantes. S’il y a une concurrence sur des marchés, les rémunérations des travailleurs dépendront du revenu de l’unité de production dans laquelle ils opèrent. Mais le mécanisme proposé, la « péréquation de la richesse disponible », permet de modérer cette dépendance. Le système semble ingénieux: une cotisation de péréquation peut servir à « sécuriser par mutualisation le revenu des travailleurs en activité », p. 137), donc à « démarchandiser les rémunérations des producteurs » (p. 151). Le principe est le suivant : on prélève sur chaque entreprise une proportion (30 à 50%) de la richesse produite[8] et on lui verse une allocation forfaitaire par salarié employé. Borrits suggère que les paramètres de cette « péréquation de la richesse disponible » peuvent être ajustés, en fonction des débats démocratiques, pour déboucher sur un « salaire à vie » à la Friot (dépendant de la qualification individuelle), un revenu universel (identique pour tous), ou un salaire sécurisé comme le prévoit par exemple la proposition CGT de « nouveau statut du travail salarié ».
Là encore, des questions demeurent sans réponse : quelles règles les entreprises pourraient-elles utiliser pour fixer leurs prix, avec un système de prélèvement aussi complexe[9] ? Et quelles seraient les conséquences sectorielles et macroéconomiques de cette redistribution massive des secteurs capitalistiques vers les secteurs de main-d’œuvre[10] ? Quoi qu’il en soit, l’idée de mécanismes de péréquation de la richesse est à creuser, si l’on veut éviter la formation d’inégalités cumulatives entre les entreprises autogérées en fonction de leur réussite économique.
Plus généralement, la perspective ainsi ouverte est celle de « communs géographiques » (les fonds d’investissement, mais aussi la sécurité sociale, les écoles, les hôpitaux…), gérés par les travailleurs sous le contrôle des usagers sans intervention directe de l’État. Benoît y voit « une voie possible vers le dépérissement de l’État » pour les activités dont la validation est purement politique (financement par la fiscalité) et dont le contrôle est aujourd’hui « cadenassé par l’État et la démocratie représentative » (p. 219). Il rejoint ainsi la perspective « misarchiste » tracée par Emmanuel Dockès[11].
Quelle stratégie de transition ?
Évidemment, face à un projet aussi ambitieux, une question vient à l’esprit : comment on y va? Comment avancer vers cette « perspective d’une société débarrassée des actionnaires » (p.145), cette « appropriation sociale véritable, c’est-à-dire sans propriétaire des moyens de production » (p.164) ? Dans sa recension[12] par ailleurs fort bienveillante de mon ouvrage « Libérer le travail », Benoît s’interroge sur mes propositions consistant à démocratiser les entreprises en introduisant face aux actionnaires dans les lieux de décision les salariés, les usagers et les associations concernées: « devant la frilosité actuelle du patronat à l’égard d’une augmentation de la présence des salarié-es dans la gestion des entreprises, on peut s’interroger de la viabilité d’une telle solution (…) on se demande quand même où on va bien pouvoir trouver d’aussi gentils actionnaires à l’avenir ».
C’est sans doute là que se localise notre principale divergence. Benoît n’évoque aucune stratégie de lutte sociale qui permettrait d’avancer dans la construction des rapports de force nécessaires pour se « débarrasser des actionnaires ». Ou plutôt si, mais cette stratégie me semble franchement contradictoire avec l’esprit libertaire de l’ouvrage: « qu’un gouvernement augmente la part des salaires dans la valeur ajoutée et dévalorise de facto les entreprises, et la question de la propriété productive sera alors immédiatement posée » (p. 224). Ou bien : « l’augmentation des cotisations sociales comme moyen de mettre en crise les sociétés de capitaux afin de favoriser leur reprise par les travailleurs » (p. 145). Autrement dit, il faudrait attendre qu’un gouvernement de gauche augmente les salaires pour pousser les entreprises à la faillite et les faire reprendre par les travailleurs.
Je préfère retenir des objectifs peut-être plus modestes dans un premier temps (contester le pouvoir unilatéral des actionnaires), mais cohérents avec une stratégie de lutte ancrée dans le réel : une « politique du travail vivant » fondée sur les antagonismes, les résistances et les innovation sociales que suscitent aujourd’hui les méfaits de la gouvernance actionnariale sur le travail, la nature et la démocratie. C’est dans la lutte contre la souffrance au travail, pour la qualité du travail, pour l’intelligence collective et l’éthique du care, qu’on pourra trouver les ressources de pouvoir qui nous manquent aujourd’hui pour contester la domination néolibérale. Bref, plutôt que de nous focaliser sur la question – certes importante – des formes de propriété, soyons d’abord et surtout attentifs au travail réel, aux rapports sociaux de production qui s’y nouent, à leurs contradictions et aux leviers qui pourraient en résulter pour l’émancipation.
Notes
-
P. Dardot & C. Laval, Commun, La Découverte, 2014, p. 93. ↑
-
« La propriété publique et la propriété commune ». ↑
-
P. Dardot & C. Laval, Commun, op. cit., p. 233. ↑
-
Voir le numéro spécial d’Actuel Marx , n° 14, « Nouveaux modèles de socialisme » , novembre 1993, PUF. Voir aussi mon article « Socialisme, marchés, autogestion : un état du débat », ainsi que mon ouvrage Jalons vers un monde possible (Le Bord de l’eau, 2010). ↑
-
Il est d’ailleurs surprenant de voir surgir plus loin le projet de « dépasser le marché » par la « planification spontanée », que Benoît Borrits reprend de Dominique Pelbois, Pour un communisme libéral, L’Harmattan, 2005. Avec la « planification spontanée », plutôt que de signaler leurs préférences par leurs achats, « les ménages définissent ce qu’ils comptent acheter prochainement » et transmettent cette information aux entreprises, lesquelles orientent ensuite « la production en fonction des besoins des consommateurs » (p. 211). Borrits nous avait pourtant bien rappelé que l’échec de la planification soviétique tenait notamment à « la multiplicité des biens de consommation et à la difficulté d’ajuster en permanence les investissements » (p. 76) : même l’économie de pénurie de l’URSS des années 1980 comportait 12 millions de produits différents sur lesquels il aurait été difficile d’organiser un vote des consommateurs. La « planification spontanée » retombe dans le travers de ces échafaudages théoriques où il faut voter pour la couleur des chaussettes. ↑
-
Pat Devine, David Laibman and John O’Neill, « Participatory Planning through Negotiated Coordination », Science & Society, Vol. 66, No. 1. ↑
-
Emmanuel Dockès, Voyage en misarchie. Essai pour tout reconstruire, Éditions du Détour, 2017. ↑
-
Plus précisément, de l’agrégat free cash flow + masse salariale. ↑
-
Notamment parce que la cotisation de péréquation est établie sur le free cash flow c’est-à-dire le flux de liquidités générées par l’activité, une fois payé l’amortissement, l’impôt sur les sociétés… ↑
-
Michel Husson, « Les mirages du financement de la sécu », 2004.
Note de la rédaction : voir la discussion qui a suivi : « Débat sur le financement de la protection sociale », 2007. ↑
-
E. Dockès, Voyage en misarchie., op. cit., 2017. ↑
-
Benoît Borrits, « Libérer le travail », 31 mai 2018. ↑