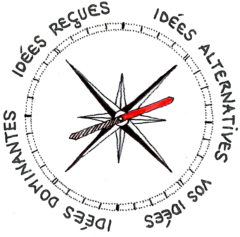Extrait du livre, Benoît Borrits, «Au-delà de la propriété, pour une économie des communs», La Découverte, Paris, 2018, pp.15-20
Si le capitalisme peut être défini comme étant l’«appropriation privée des moyens de production», on comprend que l’alternative à celui-ci ait spontanément été définie comme l’«appropriation collective des moyens de production». Or ce terme d’appropriation porte en lui une ambiguïté profonde. Le verbe « approprier » fait référence au mot «propre» : «approprier» peut aussi bien signifier devenir le «propre» d’une ou de plusieurs personnes que rendre propre à une finalité déterminée. Cette seconde signification du verbe «approprier» a été valorisée au sein du mouvement ouvrier comme antithèse à l’aliénation capitaliste dans la mesure où elle exprime avant tout l’exigence d’une orientation de l’économie à partir de la finalité des besoins sociaux, qui intègrent aujourd’hui l’urgence écologique, et non en fonction des impératifs de valorisation du capital.
Mais le premier sens du verbe «approprier», devenir la propriété d’une seule ou de plusieurs personnes, a été, lui aussi, adopté par le mouvement ouvrier comme une évidence. La « propriété collective des moyens de production» est devenue l’une des définitions les plus simplifiées du socialisme, antithèse de la « propriété privée des moyens de production » qui caractérise le capitalisme. L’introduction de la notion de propriété dans le projet d’appropriation collective allait induire deux conséquences dont le mouvement ouvrier n’avait pas pleinement mesuré les implications.
La première est l’exclusion : une propriété exclut du champ de l’usage, du bénéfice ou de la décision celui qui n’est pas propriétaire. Dès lors, la question du périmètre de la collectivité deviendra récurrente et ne sera jamais résolue d’une façon satisfaisante. Pour éviter l’exclusion, la collectivité propriétaire devrait donc être l’humanité tout entière, ce qui suppose des institutions supranationales. Le projet de l’Internationale ouvrière n’était pas loin de cette préoccupation. Malheureusement, ce projet a fait long feu après la Première Guerre mondiale et aujourd’hui, c’est souvent la gauche qui défend le retour à l’État-nation comme antidote à la mondialisation néolibérale, mais cette fois-ci non plus tellement comme cadre d’appropriation collective des moyens de production mais comme cadre régulateur du capitalisme.
La seconde conséquence est la planification de la production : par définition, le propriétaire commande ce que l’unité de production va réaliser. Plus l’échelle de la propriété est grande, plus la coordination de l’ensemble des individus intervenant dans le processus de production est complexe et plus les différenciations entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent sont fortes. Ceci est vrai dans le contexte des plus grands groupes industriels et financiers privés, au point que la littérature managériale récente tente de prôner avec difficulté l’entreprise légère ou agile[1] sans, bien sûr, aborder la question essentielle qui reste celle de la propriété.
De son côté, le mouvement ouvrier a expérimenté la propriété collective à deux échelles. D’abord à l’échelle de l’entreprise existante au travers du mouvement coopératif. Près de deux siècles après les premières expériences, le bilan est en demi-teinte. Si la forme coopérative d’entreprise reste un cadre largement utilisé dans les expériences alternatives, le mouvement coopératif international s’est aujourd’hui tellement institutionnalisé qu’il ne constitue plus une force transformatrice. Le mouvement ouvrier a aussi expérimenté la propriété collective à l’échelle d’une nation dans le cadre de l’Union soviétique et des divers pays «socialistes». Les difficultés rencontrées par les grands groupes privés se sont alors trouvées démultipliées, à tel point qu’une nouvelle bureaucratie s’est constituée contre la classe ouvrière au nom de laquelle la transformation était réalisée. Ceci a littéralement condamné la perspective d’une propriété collective à l’échelle internationale, les États «socialistes» s’étant limités à une collaboration entre « pays-frères » dans laquelle rapports de force et rivalités étaient largement présents. Quelle que soit l’échelle, celle d’un pays ou celle d’une coopérative, la propriété collective reste privée pour les personnes extérieures à cette propriété: la propriété est excluante par nature.
La difficulté de la mise en œuvre de la propriété collective à grande échelle n’avait pas échappé à de nombreux socialistes qui, à l’instar de Jean Jaurès, recherchaient une synthèse entre propriété collective incarnée par la nation et gestion par les travailleurs eux-mêmes. C’est sur une voie assez semblable que se sont engagés les communistes yougoslaves après leur rupture avec l’Union soviétique en 1948. Ce sont aussi les tentatives de cogestion État-travailleurs réalisées récemment au Venezuela dans des entreprises publiques. Mais une question reste récurrente : qui est le décideur en dernier ressort sinon le propriétaire collectif? Or celui-ci ne peut que s’incarner dans une élite qui tend inévitablement à reconduire les rapports d’exploitation.
Il apparaît donc clairement que les deux sens du mot « approprier » sont contradictoires : on ne peut rendre un moyen de production « propre » à la finalité de l’émancipation humaine que s’il n’y a pas de propriété, qu’elle soit privée ou collective. Le courant libertaire et, à sa suite, certains courants du marxisme, ont toujours refusé la perspective de la propriété collective des moyens de production, préférant parler de «socialisation» : il s’agit de la reprise en main des moyens de production par les intéressés eux-mêmes avec la perspective que ceux-ci s’entendront pour définir ensemble un plan de production. Ce sont, bien sûr, les collectivisations espagnoles de 1936 réalisées sous l’influence du puissant mouvement anarchiste. C’est aussi, d’une façon largement cadenassée par un parti unique, la troisième phase de l’autogestion yougoslave qui débute dans les années 1970. Il s’agit ici de construire une planification du bas vers le haut, de faire en sorte que chacune et chacun ait son mot à dire dans l’élaboration du plan de production. Mais cela suppose que tous les protagonistes arrivent à se mettre d’accord, ce qui reste une hypothèse pour le moins difficile à réaliser…
Nous reviendrons dans les quatre premiers chapitres sur l’ensemble des débats et expériences qui se sont déroulées depuis près de deux siècles: les réalisations du mouvement coopératif et leurs limites, les hypothèses des différents socialismes du XIXe siècle, les révolutions soviétiques et espagnoles du XXe siècle et, pour finir, la tentative de correction autogestionnaire des communistes yougoslaves qui influença grandement la gauche française des années 1970. La quasi-disparition de ce courant autogestionnaire marque-t‐elle la fin de tout espoir de transformation sociale ? Le cinquième chapitre reviendra sur l’impasse de la propriété collective des moyens de production, tout en introduisant en contrepoint deux transformations majeures du XXe siècle qui nous montrent que la notion même de propriété des moyens de production est appelée à disparaître : il s’agit de la socialisation des revenus initiée par les cotisations sociales, ainsi que du financement de plus en plus important des actifs par endettement et non par fonds propres.
Dans le cadre de la mondialisation néolibérale, de nombreuses luttes autour de la notion de « biens communs » sont apparues à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Sans chercher à démontrer que la gestion de certains biens a tout à gagner à s’écarter de celle de la logique du privé et du public[2], divers auteurs[3] font de la notion de «commun», en tant que substantif, un horizon politique, celui de la primauté du droit d’usage, du droit à la coactivité sur celui des propriétaires. C’est effectivement cette exigence du commun qui fait le lien entre des populations qui refusent la privatisation de services publics fondamentaux, comme celui des eaux, à Cochabamba ou à Naples par exemple, et les travailleurs argentins qui occupent leur usine et reprennent la production sous forme coopérative. Il s’agit dans tous les cas d’une contestation de la logique propriétaire par ceux qui ont l’usage d’une ressource: que ce soit celle de l’État auquel on dénie le droit de privatiser ou celle du propriétaire privé à qui l’on conteste le droit de disposer du matériel productif. D’une certaine façon, ces luttes renouent avec la logique de la socialisation libertaire dans laquelle les travailleurs s’approprient l’outil productif en tant qu’usagers de celui-ci afin de le mettre au service d’une finalité sociale et non de la propriété.
Très souvent, les travailleurs et/ou usagers qui s’engagent dans la construction d’un commun utilisent la forme coopérative ou une mise en service public pour lui donner corps. Dans ces deux cas, la notion même de propriété reste présente : propriété coopérative dans le premier cas, propriété étatique dans le second. Pourquoi les obstacles rencontrés au cours des deux siècles passés disparaîtraient-ils par magie? Pourquoi la logique propriétaire ne reprendrait-elle pas le dessus ? Nous défendons ici la nécessité de donner corps à la notion d’un commun productif, un commun qui se serait définitivement débarrassé du carcan de la propriété et dans lequel travailleurs et usagers, du simple fait de leur participation et non d’une quelconque qualité de propriétaire, même coopératif, seraient appelés à délibérer pour le gérer conformément à leurs attentes.
Dans les sixième et septième chapitres, nous approfondirons ces tendances fortes à la socialisation du revenu et au financement par endettement. Le huitième et dernier chapitre portera sur la définition de ce commun productif qui ne peut exister indépendamment des socialisations esquissées aux chapitres précédents, et qui devrait permettre qu’éclosent enfin des unités de production sans propriétaire dans lesquelles travailleurs et usagers s’auto-organiseront de concert pour réaliser une production socialement et écologiquement utile.
Puisse ce livre contribuer à refermer définitivement cette impasse de la propriété collective qui a conduit à certains des plus grands désastres du XXe siècle. Nous lui opposons une économie des communs dans laquelle tout individu trouvera sa place dans la délibération en fonction de sa position à l’égard de chaque unité productive et des espaces de socialisation auxquels il participe.
Alors que de plus en plus de résistances et d’alternatives se construisent aujourd’hui en récusant le pouvoir induit par l’argent, que de plus en plus d’aspirations s’expriment en faveur d’un système garantissant à la fois l’autonomie et la solidarité, la gauche aurait tout intérêt à se faire le catalyseur de ces alternatives afin de renouer avec un programme à vocation majoritaire dans lequel les citoyens – et non plus les politiques – seraient les véritables acteurs de la transformation sociale.
- Brian J. Robertson , La Révolution Holacracy. Le système de management des entreprises performantes, Alisio, Éditions Leduc.s, Paris, 2016 ; Isaac Getz , « La liberté d’action des salariés : une simple théorie ou un inéluctable destin ? », Gérer et comprendre, n° 108, juin 2012. ↑
- Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles, De Boeck, Bruxelles, 2010. ↑
- Michael Hardt et Antonio Negri, Commonwealth, Stock, Paris, 2012 ; Pierre Dardot et Christian Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, Paris, 2014. ↑