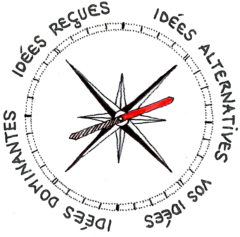Extrait du livre de Tony Andréani, « Le Socialisme est à venir », tome 2, Syllepse, 2004.
Bénéfices de la démocratie d’entreprise
Quoiqu’en disent ses détracteurs, ils sont considérables pour l’individu, pour l’entreprise et pour la collectivité tout entière.
Le lieu de travail est et restera -même si l’on en venait à ne travailler plus que deux heures par jour – le lieu central de l’existence. C’est là qu’on fait un travail considéré comme socialement utile (d’où le désespoir du chômeur, qui pourtant a du temps pour des tâches domestiques, et le malaise du retraité, alors qu’il peut se livrer à certaines activités de son choix). C’est là que, en vertu des contraintes propres au travail social, on doit se soumettre au principe de réalité, ce qui certes représente une “ peine ” par rapport aux plaisirs du temps libre, mais qui est aussi une forme profondément gratifiante d’appropriation du monde et de réalisation de soi (il est significatif que, dans les conditions même du travail le plus aliéné, le travailleur cherche un intérêt autre que pécuniaire dans son activité – ce qu’on a désigné sous l’expression “ d’implication paradoxale ”). C’est là que l’on connaît des relations fortes de coopération, qui s’ancrent dans le caractère coopératif du travail humain depuis ses origines (même lorsque cette coopération est imposée, purement “ factuelle ”, point du tout intersubjective, elle apporte le sentiment de s’inscrire dans une oeuvre collective, d’où le désarroi de travailleurs licenciés, même quand ils n’avaient que des chaînes à perdre). C’est là que l’on noue, autour d’enjeux relativement bien définis, des relations interpersonnelles de groupe (cf les “ cultures ” des différentes catégories de personnel repérées par les sociologues de l’entreprise) et d’individu à individu (pour le meilleur et pour le pire). C’est là enfin que les décisions ont les répercussions les plus immédiates et les plus profondes sur la vie de chacun, notamment en matière de revenus.
Les bénéfices de la démocratie d’entreprise découlent de ces considérations anthropologiques, et ils sont attestés par toute la littérature, scientifique ou de témoignage, qui s’est attachée à celle-ci, loin des préjugés propres aux théories de l’acteur rationnel, qui ne connaissent qu’un individu calculateur prêt à toutes les dissimulations, ruses, tromperies, et resquillages propres à satisfaire son intérêt financier.
La démocratie permet de restituer au travail une certaine autonomie, même dans la grande organisation. Le travailleur peut intervenir dans l’atelier ou le bureau sur le segment productif dont il est partie prenante, en étant assuré que son avis sera suivi d’effet. Et, s’il dispose d’une bonne information, il peut replacer ce segment dans le l’ensemble de la production. Son activité retrouve ainsi sens et finalité.
La démocratie étant, lorsqu’elle est effective, un processus interactif, le travailleur peut évoluer, tant sur le plan de la compétence professionnelle que sur celui de la formation des opinions. Même si l’organisation du travail reste très rigide, la démocratie permet, en vue des prises de décision, des effets de connaissance mutuelle qui réduisent les séparations nées de la division du travail.
D’autres bénéfices se situent sur un plan plus relationnel: enrichissement de la personnalité par les contacts multiples, sentiment d’appartenance collective satisfaisant ce “ besoin de communauté ” dont les théoriciens de l’entreprise n’ont pas la moindre idée, mais que les gestionnaires n’ignorent point et tentent de manipuler (cf. les efforts du management pour enraciner une “ culture ” et des “ valeurs ” d’entreprise). Enfin la démocratie désamorce, au moins partiellement, les rivalités, les jalousies, l’arrivisme et le clientélisme stimulés et exploités par le système de commandement hiérarchique.
Les bénéfices pour l’entreprise sont démontrés par toutes les études : plus de motivation, plus de créativité, un travail plus responsable, et finalement des gains de productivité parfois modestes, parfois spectaculaires. Le socialisme disposerait là d’un atout incomparable.
Les bénéfices pour la société sont potentiellement considérables. Non seulement les produits sont moins chers et/ou de meilleure qualité. Mais aussi – encore un aspect dont les théoriciens de l’entreprise se désintéresse totalement – le travailleur associé fait un meilleur citoyen, parce qu’il a appris à sortir de sa passivité et sait qu’il peut influer sur le cours des choses.
Ce bref argumentaire en faveur de la démocratie d’entreprise se heurte pourtant à ce que bien des études montrent : qu’elle est loin de tenir toutes ses promesses et qu’elle peut même engendrer des effets pervers. Et l’on sait aujourd’hui à peu près pourquoi. Je voudrais m’arrêter un peu plus longuement sur ses difficultés et ses travers, dont il faut prendre la mesure si l’on veut y remédier.
Difficultés et effets pervers de la démocratie d’entreprise
Je passe sur le fait que la démocratie d’entreprise, comme la démocratie politique, suppose un véritable apprentissage. Il est difficile, quand on vient du monde capitaliste, de sa hiérarchie de commandement et de sa division du travail (avec toutes les “ cultures ” qu’elle suscite), de changer des habitudes de passivité, “ d’opportunisme ”, et de contestation, qui ont aussi leur “ bon côté ” (une certaine irresponsabilité). On ne peut attendre des miracles par exemple d’une transformation d’une entreprise capitaliste familiale en coopérative de production. Reste le fait que, dans les exemples les plus probants – encore une fois les coopératives de production ou les entreprises yougoslaves – la démocratie a donné des résultats décevants. On peut identifier trois types principaux de difficulté : les défauts du système délégatif, l’intrusion en force des relations interpersonnelles, l’échelle de l’organisation.
J’ai déjà critiqué la démocratie “ délégative ”, et j’irai à l’essentiel. Le premier défaut est le système d’élection à plusieurs degrés. Comme les mandats impératifs sont de facto impossibles (j’y reviendrai), les voeux de la base peuvent se trouver complètement déviés ou dénaturés quand ils arrivent au sommet. Le deuxième défaut reproduit ce qui se passe dans la démocratie représentative (comme système d’élection directe), à savoir la confiscation du pouvoir par les instances exécutives, fortes de leur expertise et de leur permanence. En Yougoslavie par exemple le Conseil ouvrier ne faisait guère le poids par rapport au management, qui lui faisait avaliser ses décisions et ne manquait pas de reporter la responsabilité sur lui en cas de mauvaise gestion. Le troisième défaut de la démocratie purement délégative est que le pouvoir échoit entre les mains des plus habiles à énoncer des projets ou des critiques et à prendre la parole. Le théoricien des compétences y verra un signe de rationalité. Mais le résultat global est loin de l’optimalité, puisque les travailleurs prennent l’habitude de s’en remettre à eux et en même temps les suspectent d’abus de pouvoir, ce qui fait tomber la participation et ses bénéfices au plus bas niveau.
Je développerai un peu plus le problème de l’intrusion des relations interpersonnelles, car il est moins connu. Je citerai ici ce passage du Discours sur l’égalité parmi les hommes : “ Le système hiérarchique écrase les différences en les subsumant sous des castes et statuts dans la division verticale du travail. Au contraire “ l’autogestion entraîne un processus de différenciation presque infini des intérêts et projets particuliers ”, et par suite une multiplication des conflits, et ceci en dépit de tous les éléments de consensus et de convivialité. En même temps ces conflits entre groupes divers (par la qualification, l’âge, le sexe etc.) sont redoutés, et l’on préfère souvent s’en remettre à des médiateurs ou négociateurs improvisés, quitte à s’en méfier. Il faut ajouter à cela les difficultés du “ face à face ”, en tant qu’il met en scène les individus et leur personnalité, y compris dans leur histoire personnelle et familiale, et suscite des rapports d’attirance et de rejet. Enfin il existe des risques de pression normative du groupe sur l’individu, moins forte que dans l’entreprise hiérarchique, mais plus diffuses du fait que les oppositions sont censées disparaître grâce à la “ citoyenneté ”. La surveillance mutuelle peut être excessive (plaisanteries agressives, réprimandes par exemple pour une absence à une réunion), des coalitions fusionnelles contre des boucs émissaires ne sont pas exclues”.
Enfin le problème de l’échelle de l’organisation est un problème qui paraît souvent dirimant. Les psychosociologues disent que, dans un petit groupe de vingt ou trente personnes la démocratie directe est non seulement praticable, mais encore représente la meilleure solution. Un système de vote en bonne et due forme, bien qu’il ne puisse être toujours évité, casse la dynamique sociale, fait surgir l’opposition entre une majorité gagnante et une minorité perdante, crée des susceptibilités, des jalousies et des rancoeurs. Un système d’élection démobilise largement les membres du collectif. Mieux vaut des réunions fréquentes, dont le coût peut être ici léger, et une rotation des responsables. Quoiqu’il en soit, dès que l’on dépasse ce seuil, l’élection de délégués paraît inévitable.
Mais, si la délégation de pouvoir n’est pas strictement limitée, une coupure se produit inéluctablement entre le haut et le bas. Le mandat impératif n’est praticable que pour des décision simples et ponctuelles, Une direction d’entreprise ne saurait être tenue par de tels mandats, d’abord parce que les unités de travail n’ont forcément qu’une vue partielle des choses, et ensuite parce la situation n’est jamais figée, mais en perpétuelle évolution, et qu’il lui faut y faire face, souvent dans l’urgence. Dans ces conditions la démocratie semble se vider de sa substance, parce que les mandants ne comprennent pas les tenants et les aboutissants des décisions, parce que les délégués ont leurs propres intérêts, parce qu’ils filtrent, consciemment ou inconsciemment, les informations qui viennent du bas et ne laissent descendre que celles qu’ils ont triées.
Imaginons à présent non une entreprise, mais un “ groupe ” composé de nombreuses “ filiales ”, dont certaines sont à l’étranger, et qui, au total, emploie plusieurs centaines de milliers de travailleurs (j’ai déjà évoqué le problème à propos des limites des coopératives de production). La démocratie semble tout bonnement ou bien impraticable, ou bien vouée à être totalement formelle. Les spécialistes de la firme nous renverront alors à nos songes creux. Et, si l’on refuse le principe de la grande organisation, ce sont les économies d’échelle et autres synergies qui s’envolent.
En réalité tous ces problèmes ne sont pas sans solution, même s’il n’existe pas de solution parfaite.
Il existe des solutions
Revenons d’abord au problème du type de démocratie : représentatif ou délégatif. Et, pour simplifier, plaçons nous dans le cadre d’une entreprise qui soit une entité unique et qui appartienne au secteur socialisé (les problèmes se poseraient différemment dans le cas d’une administration ou d’un service public (cf. le chapitre 5). Il faudrait conserver les avantages du système représentatif, mais en en combattant les revers.
Les représentants des travailleurs devraient être élus directement (et non de manière pyramidale, comme dans le système délégatif ou “ conseilliste ”) pour former un conseil d’administration (ou de gestion). Mais 1° ils le seraient sur la base d’un projet ou d’un programme relativement précis (et, au cas où il n’y en aurait qu’un, il devrait obligatoirement présenter des options, ne serait-ce que pour susciter une réflexion et une discussion), et 2° des procédures reférendaires pourraient être mises en oeuvre, soit à l’initiative du Conseil, soit à l’initiative d’un certain nombre de travailleurs, surtout dans le cas où des décisions engagent l’avenir de l’entreprise.
Mais cela ne signifie pas que l’on renonce à toute forme de représentation à des niveaux inférieurs. Il devrait y avoir des conseils élus au niveau de l’atelier, du bureau, du service, du département, de la division etc. Mais les représentants seraient élus chaque fois directement, et le pouvoir de ces conseils serait limité à certaines questions. Il n’y là rien d’utopique. Le capitalisme a expérimenté des formes d’autonomie limitée, par exemple avec les “ groupes semi-autonomes ” de production, ou avec les “ centres de profit ”, avec cette différence qu’ils sont toujours chapeautés par la hiérarchie non élue. Dans les universités françaises il existe des formes d’autogestion intermédiaires (les conseils d’unités de formation et de recherche). Le deuxième principe serait que les conseils soient obligatoirement consultés sur les décisions importantes (en matière d’organisation du travail, d’effectifs, de choix technologiques etc.) que le Conseil central est amené à prendre. Mieux : ils devraient avoir un pouvoir de critique et de proposition, et chaque instance supérieure serait tenue de donner des réponses motivées et à bref délai aux questions ainsi soulevées. Enfin les instances où les travailleurs sont représentés non en tant qu’associés, mais en tant que simples travailleurs (délégués du personnel, comités d’hygiène et de sécurité, comités d’entreprises) seraient conservées, et pourraient voir leur rôle accru.
En ce qui concerne les effets, souvent pervers, des relations interpersonnelles sur les relations de travail, il existe toutes sortes de parades, que je ne ferai ici que mentionner rapidement : instauration de règles détaillées et régulièrement refondues pour prévenir ou régler les conflits et pour abréger les négociations ; formation de base à l’analyse des phénomènes de groupe ; appel à des intervenants extérieurs compétents en matière d’autogestion ; rôle des syndicats dans la défense des personnes ou des groupes en situation de faiblesse.
J’en viens au troisième problème, celui de la démocratie dans une très grande organisation. On peut évidemment souhaiter que les entreprises restent petites, mais ce serait aller contre la “ socialisation des forces productives ”, qui traduit des phénomènes comme les économies d’échelle ou les synergies. On peut imaginer que celle-ci se réalise à travers des partenariats ou des contrats d’association, qui laissent à chaque entreprise son entière indépendance, mais ces coopérations sont instables et ne permettent pas une unité stratégique. On peut encore imaginer que les entreprises se fédèrent en élisant des représentants dans une instance centrale de coordination, qui fournit aussi des services divers, comme c’est le cas avec le grand groupe coopératif espagnol Mondragon, mais il s’agit alors plus d’une nébuleuse d’entreprises que d’un groupe industriel unifié.
En réalité je ne crois pas qu’on puisse, à partir d’un certain seuil, éviter la structure de groupe, avec son entreprise mère, ses filiales, voire ses sous-filiales, qui est une très ingénieuse invention institutionnelle du capitalisme, et qui est d’ailleurs utilisée par des établissement publics, des entreprises de services publics, des coopératives et des mutuelles, comme nous l’avons vu. Tout le problème est de ne pas reproduire la forme de domination capitaliste, qui, même si l’entreprise mère était autogérée, viderait de sa substance la démocratie dans les filiales. C’est, on le sait, par la détention du capital (dans les filiales à 100%) ou d’une part du capital (dans les autres filiales) que s’exerce cette domination. La solution pourrait être trouvée en détournant une autre invention capitaliste, la société holding (une société qui ne produit rien, mais qui gère des participations financières) .
Le principe de base serait que toutes les filiales aient des représentants au sein de la société holding au prorata non de leur chiffre d’affaires, mais de leur nombre de travailleurs, ce qui élargirait le principe “ un homme, une voix ” à la dimension du groupe. C’est bien le groupe qui devrait avoir une politique et une stratégie globale, mais ce sont cette fois les filiales, et non la maison mère, qui les déterminent conjointement. Mais l’écueil est de taille si nous restons dans le cadre de sociétés à capitaux. Si la holding investit des capitaux dans les filiales, c’est le Conseil de groupe (et, en son sein, les représentants des filiales les plus nombreuses) qui va peser de tout son poids sur la gestion des filiales, sélectionner leurs investissements, exiger tel seuil de rentabilité, voire les mettre en liquidation, ce qui laisse peu d’autonomie à ces dernières. C’est une des raisons pour lesquelles le modèle que je présente ici me paraît préférable à d’autres. En effet, dans ce modèle, comme on le verra mieux au chapitre suivant, les entreprises fonctionnent toutes à crédit, si bien que la société holding ne possède pas de participations, mais est seulement pourvoyeuse de crédits (en fonction de sa politique générale, ce qui la différencie d’une banque, – outre le fait qu’elle ne crée pas de monnaie, mais redistribue seulement les crédits dont elle dispose). Cela lui donne barre sur les filiales, mais dans des conditions fixées à l’avance (comme dans tout crédit), et les filiales peuvent largement recourir à des crédits bancaires, ce qui leur garantit une certaine indépendance.