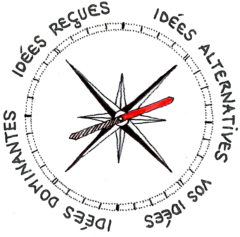Christophe Koessler
Version longue d’un article publié dans Le Courrier du 24 septembre 2014 et du magazine Hors série du Courrier «Alternatives, le monde des possibles»
Malgré les désastres provoqués par l’économie capitaliste, et l’effondrement du modèle social-démocrate européen, la même rengaine est constamment reprise en chœur dans bien des milieux, de gauche comme de droite: «Il n’y a pas d’alternatives». Cette antienne n’a en réalité pas de consistance si l’on se penche sérieusement sur le sujet. Du moins dans le domaine des idées. Toute une littérature scientifique récente développe, de manière convaincante, et à la lumière des expériences économiques socialistes et solidaires réalisées depuis deux siècles, des modèles d’alternatives pour remplacer à large échelle l’économie dirigée par le profit. Des modèles conçus comme des guides pour la réflexion et pour la mobilisation sociale, et non comme des solutions clefs en main à imposer ou appliquer tels quels. Ce corpus de recherche, qui insiste sur la faisabilité et la désirabilité des ces alternatives, reste paradoxalement ignoré par la plupart des mouvements anticapitalistes. L’impasse faite par ces derniers sur ce précieux apport est due à un tabou qui traverse l’ensemble de la gauche radicale, lequel s’explique principalement par des blocages idéologiques et par l’échec traumatisant du communisme (lire encadré). Comment alors, avec de telles œillères, dégager un horizon qui puisse motiver une part significative de la population à s’engager dans une lutte pour un monde meilleur? Sans projets de société, les mouvements sociaux ne sont-ils pas cantonnés à des luttes défensives face à l’avancée du programme néolibéral?
L’autogestion comme guide
Nous nous limiterons ici à décrire les grands traits des modèles autogestionnaires1. Basés sur la démocratie dans les entreprises, ils répondent aux deux objectifs fondamentaux du socialisme : l’émancipation des travailleurs de toute tutelle, que ce soit celle des détenteurs du capital ou celle de l’Etat, et le contrôle social des grandes orientations de l’économie. Ils ont aussi le mérite de rester relativement proches, au final, du fonctionnement actuel de l’économie au jour le jour, tout en se débarrassant de l’irrationalité, des injustices et des fortes inégalités propres à la valorisation du capital au profit d’agents privés.
Les autres piliers de ces modèles sont principalement: la conservation du marché pour les biens de consommation courante, un système d’investissement socialisé, des services publics puissants délivrant des biens sociaux gratuits ou semi gratuits (santé, éducation, culture, eau, électricité, logement, etc.), et une planification incitative qui permette d’orienter l’économie vers les buts décidés par la société. Ce cadre suppose une démocratie politique largement améliorée, incluant toutes sortes de participations citoyennes, et une propriété sociale des moyens de production (à distinguer d’une propriété d’Etat. S’agissant des produits de consommation courante, l’Etat n’est plus que le nu-propriétaire, direct ou indirect, de ces moyens, dont l’usage est confié à des tiers soumis à des obligations).
Libérer le travail
Ce type d’économie suppose donc que les travailleurs s’organisent comme ils le souhaitent au sein de collectifs de travail ou d’entreprise. Ils élisent des gestionnaires en cas de besoin (qui peuvent être tournants et révocables) et perçoivent pour eux-mêmes les revenus tirés de la production de biens et services qu’ils produisent, une fois payés leurs impôts et les intérêts des prêts qu’ils ont contractés. «C’est un système orienté vers la maximisation des revenus du travail, pour que les travailleurs se sentent responsables et fassent preuve de la plus grande efficience productive», écrit le politologue français Tony Andréani, fort des études sur l’autogestion en ex-Yougoslavie et sur les coopératives Mondragon en Espagne, de loin le plus grand spécialiste francophone du sujet. Pour éviter de trop grandes inégalités de rémunération des travailleurs entre entreprises, des grilles salariales pourraient par exemple être imposées à l’échelle de la société. Tout en laissant une marge de manœuvre aux entreprises, par exemple en matière de primes attribuées aux collaborateurs en fonction des résultats de leur collectif de travail. Certains auteurs proposent d’associer d’autres parties prenantes à la gestion des entreprises: associations de consommateurs, fournisseurs, banques socialisées, représentants de collectivités publiques, etc., afin que les intérêts collectifs de la société puissent s’exprimer au cœur même des firmes.
Socialiser le marché
Pour les biens privés (nourriture, chaussures, vélos, journaux, etc.) et les moyens de production, le marché reste l’instrument principal de la rencontre de l’offre et de la demande. Malgré ses défauts – il ne prend pas en compte les externalités des transactions (la pollution par exemple), ignore les disparités de pouvoir d’achat et pousse les entreprises à une concurrence parfois destructrice – les partisans d’un socialisme autogestionnaire le considèrent comme un moindre mal. La seule alternative au marché, qui serait une planification de l’ensemble de la production, aurait prouvé son inefficacité et son caractère autoritaire en Union soviétique. Une variante démocratique, d’inspiration anarchiste, proposée par l’économiste américain Michael Albert2, leur apparaît comme impraticable – en raison de la lourdeur d’un tel dispositif -, inefficiente, et entachée du même risque de dérive tyrannique. Sans compter qu’elle impliquerait un bouleversement complet des modes de vie des citoyens en matière économique, réduisant drastiquement les achats spontanés et impliquant une participation active à l’élaboration du plan.
Pour contrer les tendances délétères du marché, Tony Andréani et Diane Elson proposent de le «socialiser». A la concurrence, des coopérations obligatoires seraient opposées à plusieurs niveaux: entre entreprises, par le biais de réseaux publics d’information (sur les techniques mises en œuvre, les méthodes de travail, etc.), avec les consommateurs, à travers leur présence dans le comité de gestion des firmes autogérées et la diffusion d’informations sur les produits, et avec les travailleurs extérieurs à travers des réseaux publics d’emploi.
La clef de l’économie: l’investissement
Le caractère aveugle des marchés serait aussi compensé par la socialisation des investissements, laquelle permet non seulement d’en finir avec la logique d’accumulation capitaliste, mais d’orienter la production vers des objectifs décidés démocratiquement et mis en œuvre par un plan incitatif.
Pour ce faire l’économiste étatsunien David Schweickart prévoit que les entreprises paient une taxe sur le capital fixe qui leur est confié, dans le but d’alimenter un Fonds public d’investissement, une sorte de pot commun. Le Fonds ventile ensuite ces ressources entre des banques socialisées et autogérées, qui elles mêmes attribuent aux entreprises des prêts selon des critères d’efficience. L’idée est que seules des banques, soumises à un contrôle public, sont à même d’exercer une «contrainte dure» sur l’entreprise pour que les investissements soient réalisés à bon escient et sans gaspillage des ressources.
Ceux-ci sont toutefois orientés vers des finalités sociales, décidées par des collectivités publiques élues, grâce à des taux d’intérêt et une fiscalité différentiels selon le type de production et leur impact social et écologique. Des sommes d’argent plus conséquentes pourraient aussi être réservées aux investissements considérés comme prioritaires. On peut ainsi favoriser la production de vélos électriques, plutôt que de grosses automobiles, ou des services favorisant les liens sociaux plutôt que la fabrication de jeux électroniques guerriers, tout en permettant que tous les goûts soient malgré tout satisfaits.
Tony Andréani, qui propose un système similaire, souligne la logique de ce dispositif: «Ce n’est plus le capital qui loue le travail (comme dans le capitalisme ndlr), mais le travail qui loue le capital», selon les orientations du Plan.
A partir de ces propositions pourrait se développer un débat parmi ceux qui croient en la nécessité d’un dépassement du capitalisme. La difficulté de parvenir à cet objectif, plus encore dans un monde globalisé, ne doit pas paralyser la réflexion de la gauche radicale sur ce qu’elle souhaite vraiment, au-delà de ses divergences. Ce n’est que munis d’une vision claire d’un horizon qu’elle pourra trouver les chemins de la transition3.
Les modèles de socialisme: un tabou
Réfléchir aux contours précis d’une économie postcapitaliste se heurte souvent à une levée de boucliers dans les milieux de la gauche radicale. Même si ces modèles d’alternatives sont conçus avant tout comme des idées à débattre et des guides pour orienter l’action militante, et non comme des solutions clefs en main à imposer ou appliquer à la lettre, ils suscitent une vive méfiance. Le principal argument donné à cette démarche tient ses racines de la fin du XIXe siècle déjà, à savoir que l’alternative ne pourrait surgir que du mouvement des masses des dominés et de leurs luttes concrètes, pas de l’imagination de quelques bourgeois. Marx s’opposait alors aux «utopies» proposées par Saint-Simon, Fourrier et Owen: «Ils (les utopistes, ndlr) ne discernent du côté du prolétariat aucune spontanéité historique, aucun mouvement politique qui lui soit propre. (…). Leurs inventions personnelles doivent suppléer ce que le mouvement social ne produit point; les conditions historiques de l’émancipation prolétarienne, c’est l’histoire qui les donne, mais ils préfèrent les tirer de leur imagination; à la place de l’organisation graduelle et spontanée du prolétariat en classe, ils voudraient organiser la société suivant un plan spécialement imaginé à cet effet», écrivait Marx dans le Manifeste du Parti communiste. Cette idée a largement empêché les mouvements anticapitalistes de préciser ce qu’ils voulaient concrètement. Dès lors, n’est-ce pas là l’une de leurs faiblesses principales? C’est du moins la conviction de plusieurs auteurs de ces modèles, qui pensent que réfléchir à des solutions pour le futur et pour tout de suite est l’un des clefs de la transformation sociale de l’économie. Sans projets de société, les mouvements sociaux peuvent-ils convaincre une partie significative de la population de se joindre à eux, interrogent en substance les auteurs de modèles autogestionnaires? Faute de propositions nouvelles, outre celle de faire appel à l’Etat social, ne sont-ils pas démunis face à la progression actuelle du néolibéralisme? Pour Tony Andréani, «les prolétaires ont besoin des intellectuels, auxquels ils sont en droit de demander de faire leur travail».
NOTES
1. Le politologue et philosophe français Tony Andréani reste celui qui a de loin le plus creusé le sujet. Après avoir étudié les expériences soviétiques, yougoslaves et hongroises principalement, consignées dans l’ouvrage Le socialisme est (a)venir, éd. Syllepse, tome I, il s’est penché sur presque tous les modèles de socialisme élaborés par d’autres, avant de proposer son propre modèle dans le tome II. Citons encore David Schweickart, After capitalism, Rowman and littlefields publishers, 2002, et Pat Devine, Participatory planning through negotiated coordination, Science and society, 2002.
2. Michael Albert, Après le capitalisme, éléments d’économie participaliste, Agone, 2003.
3. Tony Andréani, David Schweickart et Michael Albert, développent des pistes sur les réformes à exiger dès maintenant pour se diriger vers un socialisme démocratique. Il ne s’agit ni d’attendre la révolution ni de croire au Grand soir.