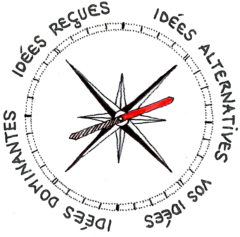Thomas Coutrot, février 2000
“Le capitalisme est en crise”. Même François Fillon, député séguiniste peu suspect d’anti-capitalisme primaire, le dit. Licenciements et maxi-fusions, Michelin et Elf/Total, souffrance et précarisation au travail, effet de serre et marée noire, yoyo boursier et exclusion sociale: le tableau est inquiétant. Non pas tant économiquement – productivité, investissement et profits se portent encore plutôt bien, merci – qu’idéologiquement. Hors les Etats-Unis et la Grande Bretagne, le néo-libéralisme même à son apogée manque cruellement de légitimité sociale.
L’inévitable – bien qu’imprévisible – krach boursier ébranlera sans doute cette légitimité même dans le monde anglo-saxon. Déjà des voix autorisées crient au loup, tel Joseph Stiglitz, ex-économiste en chef de la Banque Mondiale, démissionnaire par désaccord avec l’orientation néo-libérale.
En fait le problème remonte à plus loin. C’est depuis la fin des années soixante-dix que la croissance économique capitaliste a cessé d’être humainement progressiste. Là encore, aucune invective trotskiste, mais les conclusions d’études fort sérieuses. En 1995 des chercheurs américains, imités deux ans après par des experts du gouvernement canadien, montraient la divergence croissante, depuis le milieu des années 70 pour les USA et le début des années 80 pour le Canada, entre la croissance du PIB et celle d’un indicateur de “santé sociale”, d’inspiration proche de l’indicateur de développement humain du PNUD. Pour les experts canadiens, “les résultats expliquent l’inconfort éprouvé par les gens malgré la croissance de l’économie”. Montée de la pauvreté, aggravation des inégalités, de la délinquance, de la toxicomanie, des suicides… expliquent cette divergence statistique entre croissance et bien-être. A ma connaissance aucune étude similaire n’existe pour l’Europe, ce qui est fort dommage.
Réguler le capital ?
Certes, dira-t-on, mais cela ne prouve rien contre le capitalisme en soi. Puisqu’il a été capable, de 1945 à 1975, de faire grosso-modo coïncider croissance et développement humain, pourquoi ne le pourrait-il pas à nouveau ? La troisième révolution technologique en cours, celle de l’électronique et des biotechnologies, va donner un nouvel élan à l’économie : il s’agira alors de la réguler politiquement pour qu’elle profite à tous. De nouvelles institutions supranationales seront certes nécessaires, pour mener des politiques monétaires et financières coordonnées, reprendre le contrôle de la sphère financière déchaînée, lutter efficacement contre l’effet de serre et assurer une meilleure distribution des richesses. OMC démocratisée, taxe Tobin, réforme du FMI et de la Banque Mondiale, affirmation du contre-pouvoir global des ONG, tracent la voie d’une “mondialisation à visage humain”. Point n’est besoin de rêver de renverser ou de dépasser le capitalisme, d’imaginer une économie réglée par autre chose que la loi du profit : l’effondrement du “socialisme réel” a montré la vanité, pire encore le caractère criminel, de telles utopies. Rester dans le “cercle de la raison” oblige à se satisfaire de l’objectif de “nouvelles régulations” du capitalisme. Même des auteurs aussi critiques du néo-capitalisme que Luc Boltanski et Eve Chiapello n’attribuent à la “critique” qu’un rôle d’aiguillon du capitalisme. Obliger le capital à se réformer pour se (re)-légitimer, telle est donc aujourd’hui l’horizon ultra-majoritaire de la gauche française, à l’exclusion de toute tentation utopiste.
Certes, limiter les pires excès du libéralisme représenterait une amélioration considérable pour la grande majorité des habitants de la planète. Je voudrais toutefois défendre un point de vue différent : non seulement il n’est pas nécessaire de renoncer à imaginer un au-delà du capitalisme, mais surtout ça n’est pas utile.
Au contraire, l’histoire l’a montré, la “critique” ne peut se passer de la force que représente un imaginaire collectif tourné vers une meilleure société – un imaginaire utopique au meilleur sens du terme. Même si l’on ne pense pas possible d’accéder dans un avenir prévisible à une organisation sociale postcapitaliste, cette perspective devra jouer un rôle fondamental dans la mobilisation imaginaire, symbolique et politique des dominés, seule manière de mettre en échec (ne serait-ce que pour le réguler!) un néo-capitalisme aujourd’hui complètement débridé. Reconstruire cet imaginaire, recréer un projet cohérent de transformation sociale, suppose cependant avoir pleinement intégré non seulement les échecs du capitalisme, mais la faillite des stratégies jusqu’ici adoptées par les forces anti-capitalistes.
“Pourquoi le socialisme ?”
Albert Einstein avait ainsi intitulé le bel article qu’il donna au premier numéro de la Monthly Review (mai 1949). Selon lui “le but réel du socialisme est de dépasser la phase prédatrice du développement humain” (ma traduction, TC). Son analyse n’a vraiment pas pris une ride. La position de l’individu dans la société capitaliste est telle que “les tendances égotistes de sa constitution naturelle sont en permanence stimulées, alors que ses tendances sociales, par nature plus faibles, se détériorent progressivement (…) Nous sommes confrontés à une gigantesque communauté de producteurs dont les membres ne cessent de lutter pour se priver mutuellement des fruits du labeur commun – non par la force, mais en observant fidèlement les règles établies par les lois”. La concentration du capital aboutit inéluctablement à une concentration du pouvoir économique “qui ne peut plus être réellement mis en échec même par une société politique démocratiquement organisée”, notamment parce que “les capitalistes privés contrôlent directement ou indirectement les principales sources d’information (presse, radio, éducation)”.
Ces quelques phrases suffisent à nous rappeler au moins trois raisons de refuser fermement la résignation au capitalisme: celui-ci est structurellement inégalitaire ; il mine incessamment toutes les formes de solidarités; il sape inlassablement les fondements de la démocratie.
Le néo-libéralisme pousse à l’extrême ces tendances et apporte un démenti quotidien au postulat, posé par Furet et notre intelligentsia post-communiste, du lien indestructible entre libéralisme économique et démocratie politique. La réapparition de la barbarie au coeur de l’Europe – Yougoslavie, Autriche, Russie… -, la dislocation de pays entiers, voire de continents, la montée des intégrismes, devraient nous ouvrir les yeux sur l’urgence de redéfinir un mode de fonctionnement de l’économie qui non seulement n’agresse pas les communautés humaines existantes, mais stimule l’affirmation de nouvelles valeurs communautaires et universelles. Bien sûr, en tirant toutes les leçons du passé. L’article d’Einstein se termine par un bref paragraphe proclamant la nécessité d’une « économie planifiée » pour mettre un terme à « l’anarchie capitaliste ». Mais sur les ruines du projet communiste, il nous faut aujourd’hui redéfinir un socialisme politiquement démocratique et économiquement efficace, apte à relancer le projet séculaire de l’émancipation humaine, aujourd’hui bien en panne.
Les intellectuels de gauche français sont malheureusement aujourd’hui à l’arrière-garde de la pensée progressiste, payant sans doute le prix d’une trop longue hégémonie du stalinisme. Mais se développe depuis près de vingt ans une vaste littérature internationale qui remet sur le chantier ces vieilles questions théoriques: l’articulation plan/marché, le rôle respectif des incitations marchandes et civiques, l’autogestion versus la propriété privée des moyens de production…
Les leçons de l’histoire
Il faut le reconnaître sans ambages: dans le débat des années trente entre le libéral Friedrich Hayek et le socialiste Oskar Lange, c’est Hayek qui avait raison. Il expliquait qu’une économie centralement planifiée ne pourrait fonctionner efficacement, seul le jeu des marchés permettant de faire émerger l’information pertinente sur les goûts et besoins des consommateurs comme sur les coûts et potentialités des producteurs. Lange lui répliquait par une démonstration mathématique montrant l’équivalence formelle de l’équilibre de concurrence parfaite et de la planification totalement centralisée. Mais Hayek maintenait le point clé : comment le planificateur pouvait-il connaître les millions d’informations précises nécessaires à ses décisions, alors que ceux qui détenaient ces informations n’avaient aucun intérêt personnel à les lui communiquer, bien au contraire ? L’incapacité du Gosplan à dépasser le stade de l’édification d’une industrie lourde, et de l’URSS à satisfaire les aspirations de ses habitants, a démontré le bien fondé de la critique de Hayek. En outre, il y a évidemment une tendance au renforcement mutuel entre un appareil tout-puissant de planification économique central, et un appareil totalitaire de répression policière.
Aujourd’hui, dans le débat international sur le socialisme de demain, la plupart des auteurs tiennent pour acquis la nécessité de préserver un rôle important pour les marchés et la concurrence. Mais contrairement à ce que pensait Hayek, « le marché » n’est aucunement une institution « naturelle » qui peut et doit échapper à toute intervention collective. Le débat principal n’est plus entre les partisans du marché et ceux de la planification, mais entre les différentes manières d’articuler les régulations marchandes, communautaires et politiques. Deux courants principaux s’opposent dans ce débat: les partisans du socialisme de marché et ceux de l’autogestion. On ne peut cependant négliger un troisième courant, celui du « socialisme participatif », qui continue (non sans arguments) à refuser tout rôle important aux marchés.
La coordination économique par la démocratie ?
Ce courant, fidèle à la tradition marxiste, critique le jeu des marchés à cause du « fétichisme de la marchandise » et de la concurrence qui atomise les citoyens et détruit les solidarités. E. Mandel (1987), P. Devine (1988), ou M. Albert et R. Hahnel (1991), décrivent avec précision un système basé sur une complexe architecture de conseils d’entreprises autogérées et de comités locaux, au sein desquels les travailleurs, les consommateurs et les citoyens confronteraient leurs points de vue et leurs priorités. Ces unités locales éliraient leurs représentants dans un vaste réseau de corps intermédiaires, à l’échelle régionale, sectorielle et nationale, destinés à concilier les orientations venues des instances de bases et à les coordonner afin de déterminer démocratiquement les principales décisions macroéconomiques. Des institutions de planification seraient chargées de rassembler l’information sur les projets de consommation et d’investissement des unités locales, afin de faciliter leur convergence dans un plan d’ensemble cohérent. La répartition des richesses créées serait assurée par la mise à disposition gratuite des biens et services de base, et de bons d’échange pour le reste. L’objectif essentiel de ce modèle est de développer la participation populaire la plus large dans tous les domaines, politique et économique, tout en garantissant un niveau d’efficacité dans la satisfaction des principaux besoins au moins équivalent, voire supérieur (car plus égalitaire) à celui atteint par le marché capitaliste.
Pour Hayek et les partisans du marché, aucun débat démocratique ne pourrait traiter efficacement la masse d’informations nécessaires à la multitude de décisions économiques quotidiennement prises à tous les niveaux. Ce à quoi les « socialistes participatifs » rétorquent qu’avec les micro-ordinateurs (et maintenant Internet), la technologie moderne offre des ressources extraordinaires pour développer la démocratie directe en réseau. Toutefois ce modèle se heurte à une objection plus fondamentale, qui nous renvoie au débat Lange-Hayek. A moins de supposer l’émergence d’un « homme nouveau » altruiste, on voit mal, en l’absence de marchés et d’incitations monétaires, ce qui motiverait les producteurs à partager gratuitement l’information privative dont ils disposent, ni à utiliser efficacement les ressources de leur entreprise pour économiser le capital et satisfaire les consommateurs. C’est pourquoi la majorité des auteurs admet la nécessité de marchés. Mais un point clé les sépare : faut-il maintenir le salariat ou l’abolir en faveur de l’autogestion ?
Le socialisme de marché : des marchés parfaits ?
Le socialisme de marché est une économie concurrentielle où les travailleurs possèdent les moyens de production. Ses partisans partent d’une idée simple : certes les marchés sont un fantastique outil de production d’information et d’allocation économique des ressources ; mais le capitalisme génère tellement d’inégalités et d’injustices, qu’une grande partie des ressources sont gâchées. Pour les radicaux américains (Bowles, Gintis, Gordon), les capitalistes doivent dépenser des sommes considérables pour contrôler le travail et réprimer la flânerie des travailleurs; pire encore, le moyen “naturel” utilisé pour discipliner la main-d’oeuvre est le chômage, avec son cortège de misères humaines. Pour Romer (un “marxiste analytique”), la concentration des fruits de la croissance dans les mains d’une minorité pousse celle-ci à ne pas se préoccuper des « maux publics » (pollution, violence urbaine, toxicomanie etc.) corrélatifs à la croissance économique maximale, maux dont elle peut se protéger grâce à ses revenus élevés. Les riches peuvent habiter des forteresses et partir en vacances en Patagonie… Une répartition égalitaire du capital – un “égalitarisme de la propriété” (asset-based egalitarianism) – permettrait d’intéresser directement les travailleurs à l’efficacité, évitant ainsi bien des dépenses et gaspillages inutiles; elle favoriserait un meilleur arbitrage social entre croissance économique et « maux publics ». Une telle réforme irait très au-delà d’un simple développement de l’actionnariat salarié, puisqu’elle supposerait une déconcentration radicale de la propriété des actions, aujourd’hui une des formes de patrimoine les plus concentrées. Elle viserait en fait à établir une concurrence “pure et parfaite” comme dans les manuels d’économie néo-classique.
Ces auteurs formalisent leurs propositions à l’aide des outils mathématiques de la théorie économique orthodoxe, retournant avec virtuosité contre les libéraux les outils dont ils croyaient avoir le monopole. Romer propose par exemple un système institutionnel très élégant (impossible à résumer ici) afin d’assurer le libre jeu des marchés et d’empêcher une reconcentration du capital entre les mains des plus habiles au bout de quelques dizaines d’années. Toutefois les modèles de socialisme de marché sont tous passibles de la critique qu’Einstein (et Marx) adressaient au capitalisme : en maintenant le salariat et la concurrence généralisée, ils continuent à développer l’individualisme et à saper la solidarité sociale. Les modèles de socialisme de marché supposent une très forte culture de solidarité dans la sphère politique (pour imposer et conserver l’égalitarisme de la propriété des moyens de production), mais ils proposent des rapports de production dont la dynamique est inverse. C’est cette même contradiction qu’on voit aujourd’hui à l’oeuvre dans le capitalisme: on peut douter qu’elle permette demain la stabilisation d’un modèle économique égalitaire et démocratique. Le grand avantage des modèles autogestionnaires est qu’ils reposent sur la démocratie participative non seulement dans l’Etat et la sphère politique, mais dans l’entreprise et la sphère économique.
Les modèles autogestionnaires : des marchés démocratiques ?
Dans une économie autogérée du type de celle définie par Vanek (1977) ou par Schweickart (1995), les travailleurs associés sont les maîtres des entreprises. Ils (elles) décident librement, par le vote démocratique, qui va diriger l’entreprise, et peuvent révoquer à tout moment les dirigeants élus. Ils discutent des projets de l’entreprise, et participent aux décisions, directement ou indirectement. Ils ne sont toutefois pas les propriétaires du capital : ce dernier doit être emprunté à des organismes de crédit. Il n’y a donc pas de marché des titres de propriété: personne ne peut acheter, vendre ou posséder une entreprise où travaillent d’autres personnes (le cas de l’entreprise individuelle étant évidemment différent). Il n’y a d’ailleurs pas non plus de salariés : seulement des travailleurs associés au sein de coopératives.
Car le socialisme autogestionnaire rend possible la disparition du salariat, synonyme d’exploitation et en tout cas de domination. Comme le montrait Marx, un travailleur qui est embauché contre un salaire ne peut maîtriser son travail ni son produit. Il doit se soumettre à une autorité – la hiérarchie, ou aujourd’hui de plus en plus le marché – qu’il ne contrôle pas. Salariat signifie soumission. Dans l’entreprise autogérée au contraire, les travailleurs embauchent le capital : ils payent aux institutions de crédit un taux d’intérêt fixe pour le capital emprunté, et achètent les équipements et les matières nécessaires pour maintenir la capacité de production et vendre sur le marché. Le revenu de l’entreprise sert d’abord à rembourser les emprunts et à payer les impôts; le solde constitue la rémunération des travailleurs, répartie entre eux selon une échelle démocratiquement décidée.
Le rapport capital-travail est ainsi renversé : les travailleurs s’approprient le surplus. Quant à l’investissement net (la clé de tout développement économique, puisqu’il traduit les priorités sociales qui vont être satisfaites), il pourrait être orienté et financé par des fonds locaux, régionaux ou nationaux selon leur ampleur, fonds eux-mêmes financés par des taxes sur les équipements (Schweickart).
Dans ces conditions les principaux facteurs de l’efficacité d’un système de marché sont conservés : le libre choix des consommateurs, la concurrence des producteurs, leur motivation par la rémunération de leurs efforts. La différence avec le capitalisme est double : l’interdiction de l’autofinancement et de l’appropriation privée du capital ; l’interdiction d’embaucher de la main-d’oeuvre.
Personne ne peut accumuler à titre privé des pouvoirs économiques exorbitants : les riches peuvent percevoir des intérêts sur leur patrimoine ou louer leurs châteaux, mais non utiliser leur richesse pour décider du sort de milliers de salariés. L’interdiction du salariat signifie que, quand une entreprise recrute, elle doit donner aux nouveaux travailleurs le même statut qu’aux coopérateurs plus anciens; c’est-à-dire partager avec eux le fruit du travail commun. Quant à la socialisation de l’investissement, elle signifie que la société peut décider démocratiquement d’orienter sa croissance économique.
Les modèles autogestionnaires ne présupposent pas un changement radical de la nature humaine, « l’homme nouveau ». Ils laissent une large place aux mécanismes marchands, dont l’efficacité tient à l’individualisme des agents économiques qui détiennent l’information économique pertinente. Mais – à la différence des modèles de « socialisme de marché » – l’autogestion non salariale peut être porteuse d’une dynamique de dépassement des comportements égoïstes. L’égalité et la récompense de l’engagement collectif sont inscrites dans ses institutions de base, tout comme l’inégalité et l’individualisme sont inhérents aux institutions du capitalisme. Comme le dit J. Stiglitz, « la nature humaine » est « endogène », et « l’étroitesse de l’homme néo-classique » est en partie un produit de ces institutions, le salariat et la marchandisation généralisée. Le modèle autogestionnaire fait prévaloir l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel, non pas en réprimant ce dernier, mais en le dépassant progressivement.
Diane Elson (1988) propose à cet effet deux innovations institutionnelles majeures dans le cadre d’une économie autogestionnaire : une avancée décisive dans le développement de l’accès gratuit de tous aux services de base (éducation, santé, communication, logement…), notamment via un revenu social garanti de haut niveau ; et un processus de « socialisation des marchés », grâce au développement d’un système sophistiqué de circulation de l’information sur les coûts, la qualité des produits, les marges et les revenus des producteurs. Ce système s’appuierait sur des réseaux d’institutions spécialisées de planification au niveau sectoriel et/ou local. Le projet socialiste autogestionnaire permet sans doute une synthèse fructueuse entre le projet participatif – avec sa conception de multiples réseaux de concertation démocratique « hors marché » – et le socialisme de marché. Il paraît particulièrement adapté à un monde « connexionniste » (Boltanski-Chiapello) mais égalitaire, où l’accès de tous à une information commune et de qualité est à la fois la condition et le produit du débat démocratique.
Le défi est immense auquel s’attaquent ces propositions, ici à peine ébauchées, et elles n’y répondent sans doute pas encore. Bien des débats seront nécessaires, bien des expérimentations aussi, avant que n’émerge un nouvel imaginaire socialiste doté d’une réelle puissance mobilisatrice, crédible, démocratique et efficace. Avec leurs qualités et leurs faiblesses, ces travaux nous rappellent néanmoins que l’histoire est ce qu’en font les hommes et les femmes: aucune fatalité ne les condamne à recommencer éternellement cette tâche de Sysiphe, réparer les absurdités du productivisme, de l’aliénation dans le travail et de la course effrénée au profit.
Bibliographie
La référence principale en français est l’excellent numéro spécial d’Actuel Marx « Nouveaux modèles de socialisme », coordonné par T. Andréani et M. Féray, PUF,1993, et notamment les articles de P. Romer, D. Schweickart, D. Elson, T. Andréani et M. Féray. Voir aussi Bowles S., Gintis H. (1998), Recasting egalitarianism, The real utopias project, Verso.
Pour le socialisme autogestionnaire, la référence majeure est Vanek J. (1977), The labor-managed economy : essays by J. Vanek, Cornell University Press ; pour un socialisme “mixte”, voir Nove A. (1985), Le socialisme sans Marx, Economica ; pour le socialisme participatif, voir Mandel E. (1987), “En défense de la planification socialiste”, Quatrième Internationale n°25, Septembre ; et M. Albert et R. Hahnel (1991), The Political Economy of Participatory Economics. Une synthèse remarquable est proposée par Jossa B., Cuomo G. (1997), The economic theory of socialism and the labour managed firm, Edwards Elgar