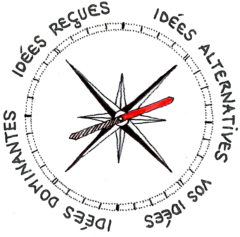Extraits de Michael Albert, Après le capitalisme, éléments d’économie participaliste, Agone, 2003.
On ne me fera jamais croire que la Providence a envoyé sur Terre une poignée de riches, nés bottés et éperons aux pieds, prêts à monter, et des millions d’autres sellés et harnachés, prêts à être montés.
Richard Rumbold
Je considère cette oppression de l’individu comme le plus grand crime du capitalisme. Tout notre système éducatif en souffre. On prépare l’avenir de l’étudiant en lui inculquant une attitude de compétition exacerbée et la vénération de la réussite financière.
Albert Einstein
Dans toute économie, la production trouve son origine dans les efforts collectifs de tous les travailleurs. Représentons-nous la production comme un énorme gâteau. Quelle part vous revient en fonction de votre travail ? Quelle part me revient ? Qu’est-ce qui détermine le revenu − la part de gâteau − de chacun ? En d’autres termes, quel est le critère économique sur lequel se fonde la rémunération ? L’économie capitaliste distribue d’une part des revenus liés à la propriété, d’autre part des salaires ou des primes en fonction des rapports de force, c’est-à-dire négociés ou extorqués en échange de la contribution à la production. Pour une économie plus juste, faut-il retenir tous ces critères de rémunération − propriété, rapports de force, contribution à la production −, en éliminer, ou en ajouter d’autres ?
Faut-il rétribuer la propriété ?
Il est peu probable qu’en majorité nos lecteurs soient favorables aux revenus tirés de la propriété − c’est ce qui s’appelle le profit. Les individus propriétaires des moyens
de production encaissent les bénéfices. Vous possédez des machines : la vente de la production génère des revenus supérieurs aux différents facteurs de production. Vous
encaissez la différence, c’est-à-dire les bénéfices. Vous n’avez rien de plus à faire que de conserver vos titres de propriété. C’est ainsi que la fortune cumulée de 475 milliardaires (dont les dividendes ne dépendent en aucun cas du travail qu’ils effectuent mais du portefeuille d’actions qu’ils possèdent) excède la totalité des revenus de la moitié de la population mondiale. Mais la rétribution de la propriété n’a pas pour seule conséquence ces inégalités dans la répartition des richesses et du pouvoir, aussi grotesques que démesurées, faussant presque tous les aspects de la vie sociale. Ne récompensant pas les personnes qui accomplissent des tâches cruciales, ce système ne joue pas le rôle incitatif nécessaire pour que les tâches socialement utiles soient correctement assumées.
Que nous ayons hérité de nos biens ou que nous les ayons accumulés nous-mêmes, cela signifie, dans la plupart des cas, soit que le destin nous a favorisés à la grande loterie des naissances, soit que nous avons eu de la chance ou été plus « roublard » que la concurrence. Nous ne pouvons pas changer nos parents ni la quantité de biens qu’ils
ont à nous léguer. Si on a la chance de mettre la main sur une entreprise qui à son tour s’empare d’un marché générant des bénéfices gigantesques, et qu’on est récompensé
par une grosse part de ce gâteau, cela est à la fois injuste et ne constitue en aucun cas une source de motivation.
Mais, en réalité, ce n’est même pas comme cela que ça fonctionne. Les entreprises appartiennent le plus souvent à des investisseurs qui ne font rien d’autre que déplacer de l’argent d’un projet à l’autre en ne laissant qu’un maigre pourcentage des bénéfices aux fondateurs. Hormis l’enrichissement d’une certaine élite, aucun argument, qu’il soit moral ou économique, ne justifie la rémunération − plus que généreuse − du simple fait de posséder quelques petits bouts de papier.
La rémunération doit-elle être le produit des rapports de force ?
Nos lecteurs ne pensent probablement pas non plus que le revenu est juste lorsqu’il traduit la capacité d’extorquer une plus grosse part du gâteau. En aucun cas un acteur économique voyou − bénéficiant du racisme, du sexisme, d’un monopole quelconque ou de l’accumulation de toutes sortes d’avantages comparatifs lui permettant de peser favorablement sur la fixation de sa rémunération − ne devrait pouvoir convertir ce pouvoir en revenu légalement extorqué.
Bien entendu, dans ces économies où l’extorsion est la norme, nous n’appelons pas à ce que les syndicats cessent de faire pression de toutes leurs forces pour obtenir des salaires à la hausse face au pouvoir des propriétaires et de tous ceux qui, sans cela, réduiraient sans hésiter les travailleurs à la plus abjecte pauvreté. Mais dans une bonne économie où chacun serait sujet à de justes critères de rémunération et ne serait pas
condamné à accumuler des avantages comparatifs au détriment de tous les autres, nous serions d’accord pour empêcher que les propriétaires, les syndicats ou d’autres acteurs utilisent un rapport de force en leur faveur pour obtenir de meilleurs revenus.
La rémunération comme traduction des rapports de force écarte indubitablement toute logique économique ou morale au profit de la force brute. Elle conduit à ce que le plus malhonnête, le plus indifférent à la situation de ceux qu’il piétine, détermine la part de la richesse sociale produite qui reviendra à chacun. Par conséquent, la rétribution sur la base des rapports de force n’est ni plus morale, ni plus éthique, ni plus efficace d’un point de vue économique que celle fondée sur la propriété.
Examinons donc les critères susceptibles de satisfaire une personne réellement soucieuse de justice.
La rémunération doit-elle être fonction de la contribution personnelle à la production ?
Les deux options ci-dessus ont été abordées sommairement parce que nous partions du principe que nos lecteurs n’ont plus besoin de se convaincre que la rémunération basée sur la propriété ou des rapports de force n’est d’aucune pertinence, s’agissant de mettre au point l’économie à laquelle nous aspirons. En revanche, la rémunération en fonction de la contribution à la production suscite, elle, une certaine controverse au sein de la gauche.
Il n’est pas rare que des personnes aussi raisonnables qu’humanistes, aspirant sincèrement à un système économique infiniment plus juste, estiment, si l’on veut résumer brutalement, que chaque acteur économique devrait recevoir une part de revenu égale à la valeur de ce qu’il produit. Ce fût même le mot d’ordre de groupes radicaux très stimulants au début du XXe siècle aux Etats-Unis. Après tout, si l’on ne contribue que très peu au produit économique de la société, pourquoi en prélèverait-on plus ? Et réciproquement si l’on contribue beaucoup. Pourquoi quelqu’un d’autre profiterait-il de la richesse que nous produisons ? Ou pourquoi profiterions-nous de la richesse produite par autrui au lieu que chacun se contente de percevoir l’équivalent de son propre investissement ? Reprenons la métaphore du gâteau pour représenter la richesse produite par la société. Si je contribue dans une certaine proportion à la préparation du gâteau, je peux prétendre à une rémunération qui me permette d’acheter une part de gâteau qui corresponde à mon investissement. Dit ainsi, cela peut paraître effectivement
équitable, ce qui explique que nombreux parmi ceux qui récusent le système de rémunération fondé sur la propriété et les rapports de force sont au contraire favorables
à ce critère. Mais étudions cela de plus près.
Supposons que Laure et Frédéric ramassent des oranges. Laure possède de bons outils. Ceux de Frédéric sont vieux et en mauvais état. Ils passent tous deux huit heures dans
l’orangeraie. Ils travaillent aussi dur l’un que l’autre. Ils endurent les mêmes conditions. À la fin de la journée, le panier de Laure est deux fois plus plein que celui de Frédéric. Elle a donc produit le double de ce dernier. Laure devrait-elle, par conséquent, être payée deux fois plus que Frédéric ? Si tel était le cas, cela reviendrait à rémunérer la
chance qu’elle a d’avoir de bons outils. Est-ce moral ? Il est certain qu’utiliser de bons outils, lorsqu’ils sont disponibles, est à la fois souhaitable et efficace ; mais récompenser la personne qui les possède est-il susceptible de favoriser une répartition sociale optimale des outils ? Pourquoi n’opterions-nous pas plutôt pour une répartition équitable des ressources, des outils et de la technologie permettant à tout le monde d’en tirer une rémunération tout en évitant les inégalités salariales ?
Supposons que Laure soit grande et forte et que Frédéric soit plus chétif. Cette fois-ci, admettons qu’ils utilisent les mêmes outils. Ils passent à nouveau huit heures dans l’orangeraie. Ils travaillent à nouveau aussi dur l’un que l’autre. Ils subissent à nouveau les mêmes conditions. Cependant, le tas de Laure est à nouveau deux fois plus gros que celui de Frédéric, cette fois parce qu’elle est plus forte que lui. Laure doit-elle percevoir le double de Frédéric ? Dans ce cas, elle est rétribuée pour sa chance à la loterie génétique. Est-ce moral ? Efficace ? Certainement pas moral. Et ce n’est certainement pas non plus en rétribuant un individu en fonction de sa production que nous obtiendrons la productivité qui correspond à ses caractéristiques héréditaires. Pour cela, il faut, comme nous allons le voir, axer la rémunération sur un niveau de production qui corresponde aux aptitudes et à l’outillage de la personne.
Prenons maintenant l’exemple de deux personnes faisant des mathématiques, de l’art, de la chirurgie ou toute autre chose socialement utile. Elles travaillent avec la même ardeur dans les mêmes conditions. L’une est naturellement plus douée que l’autre pour ce travail. Devrait-elle, par conséquent, être mieux payée que son ou sa collègue ? II est clair qu’aucune raison morale ne pourrait le justifier. Pourquoi récompenser une bonne fortune génétique qui représente déjà un grand avantage ? La personne qui bénéficie de ces « gènes talentueux » n’a rien fait de méritoire pour les obtenir.
Bien que cette notion soit plus controversée, la rémunération en fonction de la capacité productive n’a pas non plus de vertu incitative. La promesse d’une augmentation de salaire ne changera rien aux caractéristiques héréditaires. Nos aptitudes naturelles sont déterminées et les incitations salariales n’y changeront rien. Bien entendu, tout système économique souhaite exploiter ces aptitudes, mais il y a d’autres façons d’y parvenir qu’une échelle de salaires inadaptée tant sur le plan social que moral.
Qu’en est-il de l’éducation ou des compétences acquises ? D’un point de vue moral, l’augmentation de notre productivité ne devrait-elle pas être récompensée puisqu’elle résulte d’un choix méritoire ? Ne serait-il pas bénéfique d’encourager de tels choix ? Cela semble cohérent et nul ne conteste que le fait de se former devrait être rémunéré, non pas sur la base de la production que favorise cette formation, mais proportionnellement aux efforts et aux sacrifices qu’elle représente. En d’autres termes, c’est toujours l’acte effectué qui doit être rémunéré : cueillir des oranges, résoudre un problème de maths, peindre un tableau ou le fait d’accomplir des études nécessaires à l’acquisition de nouvelles aptitudes. Pour cela, il est aussi nécessaire de créer un système qui incite à la réalisation d’actes productifs. Ce qui n’a rien à voir avec la détermination du revenu d’un individu en considérant ce qu’il produit tout au long de sa vie.
Seuls l’effort & le sacrifice doivent être rétribués
Supposons que la rémunération soit déterminée en fonction de l’effort et du sacrifice consentis et non de la propriété, des rapports de force, ou de la contribution personnelle à la production. Que se passerait-il ? Si le travail est réparti comme aujourd’hui, ceux qui accomplissent les tâches les plus pénibles, dangereuses ou dégradantes bénéficieraient du meilleur salaire horaire pour un effort d’intensité normale. En revanche, ceux qui ont les meilleures situations et travaillent dans les meilleures conditions seraient rémunérés au taux le plus bas. Ce choix est moral dans la mesure où il récompense ceux qui s’investissent le plus dans leur travail et/ou endurent des conditions plus difficiles que la moyenne afin d’augmenter la quantité ou d’améliorer la qualité de la richesse produite. Mais ne rétribuer que l’effort et le sacrifice ne risque-t-il pas de déstabiliser l’économie en modifiant radicalement les facteurs qui guident les choix professionnels ? La richesse produite ne risque-t-elle pas de diminuer en quantité ou qualité ?
Plus spécifiquement, on peut se demander si un chirurgien ne devrait pas être payé pour les nombreuses années d’études que n’exigent pas, par exemple, les professions d’infirmière ou d’employé à l’entretien de l’hôpital ?
C’est évident. Le chirurgien devrait être rémunéré pendant ses études en fonction du niveau d’effort et de sacrifice que cela implique. Il devrait, ensuite, être payé en fonction du niveau d’effort et de sacrifice inhérent à son travail, tout comme l’infirmière ou l’employé à l’entretien. Ainsi, chacun serait rémunéré selon la même norme − c’est-à-dire le degré d’effort et de sacrifice consacré à une tâche utile à la société.
Cela suscitera certainement des objections du genre : « Plus personne ne voudra être chirurgien » ou « Les gens préféreront travailler à l’entretien de l’hôpital parce que
cela rapporte plus ». On se demandera également pourquoi quelqu’un voudrait faire tant d’années d’études pour avoir un salaire inférieur.
Pour comprendre, imaginons que vous veniez de sortir de l’école. Un choix s’offre maintenant à vous : soit six ans d’études médicales suivies de quarante ans d’exercice de la profession, soit quarante-six ans en tant qu’employé à l’entretien. Plus précisément, combien devriez-vous être payé pour que vous préfériez étudier pendant six ans plutôt que de consacrer ces années à l’entretien de l’hôpital, en tenant compte des conditions de travail offertes durant cette période et à l’issue de celle-ci ? Ou, inversement, combien faudrait-il vous payer pour que vous préfériez être employé à l’entretien pendant les six premières années plutôt que d’aller en faculté de médecine ? Enfin, quel salaire vous ferait choisir d’exercer l’un ou l’autre de ces métiers pendant une quarantaine d’années ?
Poser ces questions, c’est déjà y répondre et révéler que les effets incitatifs du salaire en fonction de l’effort et du sacrifice sont parfaitement justes, au moins dans un monde où chacun pourrait librement choisir sa profession, sans les contraintes nées de l’histoire ou les limites posées par les institutions.
Pour résumer, toutes choses égales par ailleurs et toutes possibilités également ouvertes à tous, il faut un salaire plus élevé, qui sera largement mérité, pour inciter à choisir ce qui nécessite le plus d’efforts et de sacrifices − beaucoup plus élevé pour les corvées de l’hôpital que pour étudier. Réciproquement, vous n’avez besoin ni ne méritez d’être mieux rémunéré pour faire quelque chose qui vous donne plus de satisfaction, de pouvoir ou génère une production plus importante, si cela n’exige pas plus d’efforts et de sacrifices. En fait, il est moins nécessaire de vous encourager à devenir médecin qu’employé à l’entretien.
La perversité des objectifs et de la nature de l’éducation actuelle sert le maintien d’un ordre social injuste. Il est facile d’imaginer la situation suivante : dans une classe de lycée ou d’université, vous annoncez que le salaire annuel d’un neurochirurgien atteint désormais 300 000 euros et que celui d’un mineur s’élève à 60 000 euros. Décrivez les conditions de travail de chacun en vous référant aux méthodes traditionnelles en ce qui concerne les mineurs − avec maladies pulmonaires, coups de grisou, etc.
Demandez aux étudiants combien d’entre eux souhaitent exercer un métier plus ou moins équivalent à celui de neurochirurgien dans la discipline de leur choix et combien aimeraient exercer un métier plus ou moins équivalent à celui de mineur. Demandez leur ensuite pourquoi le salaire des chirurgiens est si élevé. Ils vous répondront que c’est à cause de la durée de leurs études et de l’importance de leur contribution à la société, mais surtout parce qu’ils ne voudraient pas le faire sans un bon salaire pour les y encourager.
La véritable réponse est que les chirurgiens ont le pouvoir d’extorquer de tels salaires. Dans la perspective de ce chapitre, le phénomène à examiner est le suivant. Vos étudiants sont au moment de leur scolarité où ils doivent choisir entre la vie active et six années d’études supplémentaires. Proposez-leur les options existantes : soit 60 000 euros pour le mineur ou équivalent pendant les quarante-six années à venir, soit un revenu très bas pendant six ans d’études, suivi d’un salaire évoluant progressivement vers 300 000 euros par an pendant quarante années d’exercice de la chirurgie ou équivalent. Dites-leur ensuite que vous allez changer ces barèmes et que vous cherchez à savoir quel est le seuil à partir duquel ils abandonneraient l’« option hautes études, haut salaire » (qui s’accompagne du pouvoir, de l’admiration générale et de meilleures conditions de travail) pour lui préférer l’« option ouvrière ». Il faudra que le salaire des chirurgiens descende très en dessous de la barre des 60 000 euros pour dissuader les aspirants chirurgiens et les convaincre de descendre à la mine − si, toutefois, cela suffit. En revanche, le mineur changera d’avis sans la moindre difficulté, même si le salaire doit être plus bas. Cette petite expérience dévoile le mensonge de la rhétorique selon laquelle il serait nécessaire de mieux rémunérer quelqu’un pour qu’il choisisse d’étudier ou d’exercer une profession plus agréable et lui offrant plus de pouvoir.
Une rémunération équitable, sur le plan moral et jouant son rôle incitatif, suppose qu’elle soit plus élevée en faveur de ceux qui font le plus d’efforts et de sacrifices en exécutant un ensemble de tâches nécessaire à une société affectant correctement ses capacités et ses ressources. La contribution à la production peut souvent constituer un indicateur raisonnable de l’importance des efforts fournis, mais elle ne peut déterminer à elle seule la rémunération. (Nous verrons comment mesurer l’effort autrement que par les résultats après avoir étudié plus complètement la question de la répartition − mais en ce qui concerne l’identité de ceux qui l’évaluent, il s’agit bien évidemment de vos pairs, de vos collègues.)
Qu’advient-il si quelqu’un se trouve dans l’incapacité de travailler pour raison de santé ou autre ? Même les économies les plus proches de l’esclavagisme admettent que dans ce cas un revenu est nécessaire. Les personnes raisonnables peuvent être en désaccord sur son montant mais une somme équivalente au revenu moyen éviterait que quelqu’un soit injustement avantagé ou désavantagé à la suite d’un problème de santé.
Et qu’advient-il si quelqu’un souffre d’une maladie exigeant un traitement extrêmement coûteux ou se trouve victime de quelque catastrophe − naturelle ou autre − réduisant ses ressources à néant ? Bien entendu, une société souhaitable se doit de répondre socialement à ces problèmes, de collectiviser ce risque et de ne pas laisser ses membres affronter seuls de telles calamités.
Et qu’en est-il enfin des enfants qui ne peuvent ou ne doivent pas travailler ? Doivent-ils dépendre du revenu de leurs parents avec pour conséquence que les familles nombreuses disposeront de moins d’argent par personne que les autres ? On peut imaginer plusieurs attitudes, la plus simple étant que la société attribue pour chaque enfant le même revenu qu’aux personnes dans l’incapacité de travailler. Cette allocation serait une moyenne (peut-être avec quelques variations en fonction de l’âge du bénéficiaire), accordée au simple titre d’être humain. Le revenu familial serait donc la somme de celui des adultes et de leurs enfants bénéficiaires.
Dialogue sur la rémunération
Il existe un certain nombre de choses que toute personne saine d’esprit ne peut qu’approuver. Il vaut mieux être vivant que mort, être convenablement nourri que mourir de faim, être libre qu’en esclavage. […] Le genre humain a tellement pris la forme d’une seule grande famille qu’il nous est devenu impossible de garantir notre prospérité autrement qu’en nous assurant de celle de tout le monde. Celui qui veut être heureux doit se résigner à voir les autres l’être aussi.
Bertrand Russell
En quoi la « rémunération en fonction de l’effort et du sacrifice » a-t-elle à voir avec « l’équité » (conditions de travail et revenu) ?
La rémunération en fonction de l’effort et du sacrifice (et, dans certains cas, de l’état de nécessité) est assez différente de la revendication habituelle de la gauche, c’est-à-dire une rémunération fondée sur la contribution personnelle à la production. Cette dernière consiste à payer une personne bénéficiant d’une bonne constitution et une personne plus chétive proportionnellement aux seuls fruits de leur travail. Dans le premier cas au contraire, on rémunère ces travailleurs sur la base du nombre d’heures passées à la tâche (en supposant qu’ils travaillent aussi durement). II en va de même, que le travailleur ait ou non acquis un savoir-faire particulier pour cette tâche qui le rend plus productif. Pour un effort et un sacrifice équivalents, chacun reçoit le même salaire quelle que soit par ailleurs sa production effective.
Supposons que vous ayez un travail pépère tandis que le mien est horriblement exténuant. Si nous avons tous les deux la même journée de travail, rémunérée au taux applicable à nos différentes fonctions, je serai mieux payé parce que mon travail est plus difficile (et exige donc probablement plus d’efforts). Si les conditions de travail ne sont pas harmonisées, un salaire en fonction de l’effort et du sacrifice vient corriger les inégalités. Dans le cas où les conditions de travail sont identiques, le salaire sera strictement proportionnel au temps de travail avec éventuellement une légère différence en fonction de l’effort fourni.
S’il est rare, dans les milieux de gauche, de considérer comme injuste le système de la rémunération en fonction de l’effort et du sacrifice, il est courant de critiquer sa capacité à exercer un rôle suffisamment incitatif pour maximiser la production. Il s’agit là d’un dogme économique classique qui ne résiste pas à l’examen.
Si je comprends bien, dans ce système les travailleurs seraient rémunérés en fonction de l’effort accompli. Mais comme celui-ci serait évalué par les travailleurs eux-mêmes, qu’est-ce qui les empêcherait de se mettre d’accord pour s’accorder les uns les autres sur l’indice d’effort le plus élevé afin que tout le monde reçoive le salaire maximum ?
Un système économique juste doit pratiquer des arbitrages délicats s’il vise à la fois la productivité et la justice sociale. Il doit à la fois maximiser la production utile à la société et assurer que les travailleurs reçoivent une compensation réellement fondée sur leurs efforts et leurs sacrifices et non sur leurs dons naturels, leur chance, leur apparence physique, etc. Dans une économie participaliste, un tel ajustement suppose deux étapes :
—1— À l’échelle du lieu de travail, le niveau d’effort de chaque travailleur sera évalué par ceux qui sont le mieux placés pour le faire de manière aussi informée que possible
et équitable. Les travailleurs pourront choisir parmi différentes approches possibles − puisqu’il n’existe pas de méthode miracle. Chaque travailleur peut recevoir une note très précise, comme à l’école, sur une échelle rigoureusement graduée… Dans d’autres cas, on considérera par défaut un niveau d’effort moyen et les écarts par rapport à la norme ne seront pris en compte que de façon exceptionnelle, sur une échelle ne comportant que quelques grades. Dans tous les cas, cette évaluation suppose l’accord sur les barèmes qui doivent refléter rigoureusement la variation de l’effort des travailleurs. (Plus loin, lorsque nous expliquerons comment l’application du système des ensembles équilibrés de tâches à l’organisation du travail peut permettre d’éliminer la structure de classes et créer les conditions d’une véritable autogestion, nous verrons comment ce système a pour effet secondaire de rendre beaucoup plus facile l’évaluation de l’effort et du sacrifice.)
—2— Il faudra également établir une péréquation des masses salariales entre les différentes unités de production, ce qui créera une base objective à la mesure du taux d’effort. Supposons, pour simplifier, que deux conseils de travailleurs fabriquent le même produit. Si leurs facteurs de production (matières premières, bâtiments, matériel, compétences humaines, etc.) et la somme des efforts mis en œuvre sont identiques, on doit s’attendre, avec une marge d’erreur raisonnable, au même niveau de production. Dans une telle économie, une administration devra tenir un inventaire fiable des ressources de chaque conseil de travailleur constituant une unité de production, sans
oublier de prendre en compte les compétences spécifiques des travailleurs : si l’unité A dispose de 20% de ressources de plus que l’unité B, A est censée produire 20% plus que
B (à taux d’effort constant). Chaque unité doit atteindre un certain quota de production, déterminé au cours du processus général de planification auquel elle participe, comme nous le verrons dans les chapitres suivants. Si l’une de ces usines ne produit que 80% de sa moyenne escomptée, les différences liées aux facteurs de production ayant déjà été intégrées, cette contre-performance ne peut être imputable qu’au critère restant − l’effort −, et le taux de salaire de chaque travailleur doit être diminué de 20%.
Si, toutes choses égales par ailleurs, une unité atteint 120% de la production escomptée, l’effort que cela représente conduit à augmenter le taux de salaire des travailleurs de 20%. C’est une solution possible, mais il y en a d’autres. Une économie participaliste peut choisir parmi les possibilités qui permettent d’assurer la production souhaitée en fonction des valeurs qui lui sont propres.
Selon la méthode retenue, on peut bien sûr s’attendre à certaines crispations quand le temps viendra de réévaluer les facteurs de production d’une unité et de fixer son quota. Mais à partir du moment où les critères utilisés pour déterminer les objectifs à atteindre sont fixés par ceux qui, dans un secteur économique donné, sont indubitablement le plus qualifiés pour le faire − c’est-à-dire les travailleurs eux-mêmes ou bien les représentants de leur choix −, le processus est tout à fait démocratique et parfaitement défendable.
Encore une fois, l’approche développée ci-dessus n’est qu’un exemple parmi d’autres et pas « la » bonne méthode. Une économie participaliste peut choisir d’autres options, de même que, au sein d’une telle économie, la procédure peut varier d’un secteur ou d’une entreprise à l’autre. Il se pourrait, par exemple, que certaines structures souhaitent un très grand degré de précision de l’évaluation pour fixer la rémunération. D’autres se contenteraient peut-être (et c’est ce qu’espère personnellement l’auteur) de rémunérer le temps de travail par défaut, choisissant d’ignorer les variations mineures d’effort entre deux différents ensembles équilibrés des tâches et n’utilisant des barèmes pour corriger des écarts à la moyenne que dans des cas exceptionnels. Par contre, le dénominateur commun de l’économie participaliste, c’est l’acceptation du principe de la rémunération en fonction de l’effort et du sacrifice et la nécessité de sa mise en œuvre en parfaite cohérence avec les autres principes fondamentaux que sont la division du travail en ensembles équilibrés de tâches, la démocratie de conseils, l’autogestion, etc.
Rémunérer un travailleur en fonction de l’effort et du sacrifice est fondamentalement un moyen de l’encourager à accomplir des tâches désagréables. Que se passe-t-il si je préfére rester à la maison et, par exemple, passer mes journées à écrire de la poésie ? Quel revenu me garantit-on ?
Si vous n’écrivez que pour votre propre satisfaction, aucun. Si vous choisissez de faire quelque chose qui n’apporte rien aux autres, cela revient à dire que la société devrait vous prendre en charge pour la seule raison que vous en avez décidé ainsi. C’est moralement injustifiable et revient donc à se comporter en passager clandestin.
Imaginez une cinquantaine de personnes naufragées sur une île déserte. Ils doivent lutter pour survivre et le travail ne manque pas. Parallèlement, les possibilités de prendre
du bon temps sont nombreuses − promenades sur la plage, baignade, jeux, siestes, etc. Si quelqu’un décide, tout à coup, qu’il refuse de faire la cuisine, d’entretenir les abris ou quoi que ce soit de fatigant, est-il de la responsabilité des autres de le nourrir du fruit de leur travail ? Bien sûr que non. Supposons maintenant que quelqu’un ait été blessé lors du naufrage et soit dans l’incapacité de travailler. Est-il normal de nourrir cette personne ? Bien sûr que oui. Tels sont les principes du participalisme, des principes tout bêtement humains.
Ne serait-il pas plus juste d’autoriser quelqu’un à travailler moins que la moyenne − voire à ne rien faire du tout si c’est ce qu’il souhaite − en lui assurant un revenu malgré tout ? De tels individus ne seraient certainement pas très nombreux et l’idée d’exiger un travail en contrepartie d’un revenu évoque une forme moraliste de travaux forcés.
Cette question soulève de nombreux malentendus et quelques problèmes bien réels.
Tout d’abord, dans une économie participaliste, rien ne peut être assimilé aux « travaux forcés » au vrai sens du terme. Ce point clarifié, si le problème subsiste dans les esprits, c’est que le lien entre l’effort et le sacrifice et la rémunération doit être considéré dans toute sa subtilité. À défaut, on passe à côté de conséquences importantes.
Rappelons d’abord que dans n’importe quel système économique, quand on prend rétrospectivement en compte les résultats annuels, on constate qu’une certaine quantité de choses a été produite. Plus précisément, cette production se compose de différents produits qui ont été distribués à différentes populations dans des proportions variables et à l’origine desquels on trouve des gens qui ont consenti tels ou tels efforts, dans des conditions de production telles ou telles, avec diverses conséquences sur leur vie… On peut donc se demander ce qui fait que, dans une économie déterminée, parmi tous les possibles imaginables, c’est cette combinaison particulière à laquelle on est parvenu. La réponse résultera toujours d’une combinaison entre des dynamiques économiques et les choix des acteurs en mesure d’influer sur la production. Une économie tournée vers l’avenir nécessite donc des institutions économiques qui garantissent de façon durable une production en accord avec les exigences humaines, sociales, individuelles et morales. Ceci étant dit, pour couper court à la critique, supposons une économie participaliste, reposant sur les principes suivants :
—1— chacun reçoit une quantité moyenne de biens et de services de son choix fixée par la société. Ceux qui ont des besoins supplémentaires particuliers (comme les soins médicaux) les voient satisfaits de droit, en leur qualité de citoyens ;
—2— toute personne valide a la responsabilité de prendre en charge un ensemble équilibré de tâches générant la production moyenne de son choix et nécessitant une durée de travail conforme à la norme socialement définie. Si les circonstances le permettent, chacun peut cependant décider de travailler plus (ou moins) et recevoir, proportionnellement, plus (ou moins) que le revenu social moyen ;
—3— ce qui doit être produit et dans quelles quantités, les tâches et procédures à mettre en œuvre, etc., doivent être décidés dans le cadre de la planification participaliste (que nous aborderons plus loin).
Ces trois points sont le fondement d’une économie participaliste. A partir d’ici nous pouvons revenir à la question posée qui tend à introduire l’un des deux principes supplémentaires suivants :
—4a— toute personne a le droit de décider, quelle qu’en soit la raison et dans les proportions de son choix, de travailler moins que la moyenne sociale tout en percevant le revenu moyen ;
—4b— il existe un revenu, dit « de subsistance », que toute personne qui refuse de travailler quoique valide, perçoit de droit.
On peut faire un calcul coûts-avantages des conséquences de la décision d’ajouter l’un de ces deux principes ou toute autre option qui a pour effet une désindexation du revenu sur l’effort et le sacrifice. Pour ce faire, il faut prendre en compte tous les aspects de la question, et ne pas se contenter d’examiner si les gens qui travaillent moins en percevant le revenu moyen s’en trouvent mieux, mais examiner les conséquences pour le reste de la population, les relations sociales, la pertinence des choix effectués dans le cadre de la planification participaliste, etc. Il faut donc interroger nos principes et nous demander si les changements proposés sont conformes à ces valeurs, au vu des conséquences pour les acteurs impliqués, la production, la répartition, la consommation et les institutions économiques.
Les valeurs de l’économie participaliste sont la solidarité, l’équité (sur le plan matériel et des conditions de vie et de travail), l’autogestion et la diversité des opinions et des
pratiques, les opinions pouvant différer sur leur importance relative. Dès lors, le questionnement devient : l’ajout de l’un de ces principes renforce-t-il une ou plusieurs de ces valeurs ? en affaiblit-il d’autres ? quel est l’impact sur la répartition, la consommation, la façon dont les décisions sont prises ou la composition du produit social ? qu’est-ce qui pèse le plus dans la balance ?
Ce type de changements ne me paraît pas porteur d’améliorations et me semble même néfaste à de nombreux points de vue. L’équité est affectée dès lors que l’oisiveté est récompensée au même titre que l’effort et le sacrifice. La solidarité est affaiblie à cause du ressentiment vis-à-vis de ceux qui ne travaillent pas. En donnant un poids aux non-travailleurs, on vide en partie l’autogestion de son sens. Ces conclusions deviennent évidentes dès lors qu’on ne se focalise plus seulement sur les conséquences immédiates − le fait de pouvoir s’affranchir des tâches qu’on préfère éviter − pour prendre en compte l’impact sur l’ensemble des relations sociales.
Pour finir, une dernière remarque. On peut aussi discuter de l’opportunité d’instaurer l’une de ces règles, non pas au moment du passage à l’économie participaliste mais seulement plusieurs générations après. La différence est considérable. Dans le premier cas, il faut prendre en compte la façon dont les classes telles qu’elles existent dans la société actuelle percevraient et adapteraient ce principe au moment même de son instauration. Dans le second cas, le problème se poserait différemment parce que les classes n’existeraient déjà plus.
Qu’advient-il du travail temporaire ou à temps partiel ? Est-ce compatible avec le participalisme ?
Dans une économie capitaliste, la quête du profit par les actionnaires exerce une pression à la baisse sur les salaires tout en exigeant une productivité du facteur travail toujours plus élevée. Toutes sortes de méthodes sont appliquées pour parvenir à cette fin : augmentation de la durée de la journée de travail, accélération des cadences, réduction des investissements dans les conditions de travail (confort, sécurité, etc.), impasse faite autant que possible sur l’assurance maladie et les congés payés. Ce qui nécessite également de diviser les travailleurs. L’une des recettes consiste à employer de la main-d’œuvre précaire (temps partiel, intérimaires, etc.) afin d’échapper aux normes et aux lois protégeant les employés à plein temps.
Dans une économie participaliste, rien de tout cela n’existe. Il n’y a pas de propriétaires d’entreprises et personne ne recherche le profit. Il n’existe pas de pression du marché ou autre pour encourager l’exploitation directe ou indirecte des travailleurs. Mais pour bien comprendre tout cela, il est nécessaire d’avoir une meilleure vision d’ensemble du système.